TD 1 : De l’Humanisme aux Lumières : Cours d’introduction adele.pdlg@parisnante
TD 1 : De l’Humanisme aux Lumières : Cours d’introduction adele.pdlg@parisnanterre.fr Devoirs le 25 octobre et le 6 décembre = commentaires de textes guidés par des questions 27 septembre = absence Deux oeuvres au programme : 1) Les Essais, Montaigne, livre III, chapitre 5,8,9 et 13 2) Diderot, Jacques le Fataliste Oeuvres qui soulèvent question anthropologiques, philosophiques, religieuses Montaigne : maire de Bordeaux qui se retire en 1572 sur la terre de Montaigne pour composer l’oeuvre de sa vie, les Essais, qui l’occupent jusqu’à sa mort en 1592. Montaigne est avant tout un penseur bien qu’il n’ait pas composé de Pensées comme Pascal. Pascal connaissait bien Montaigne = il célèbre Montaigne qui est le penseur de la contradiction, il appelle Montaigne “l’incomparable auteur de l’art de conférer” Pascal célèbre le Montaigne sceptique, mais de l’autre côté il ne supporte le Montaigne qui parle du “Moi”. Pascal écrit à propos de Montaigne “le sot projet qu’il a eu de se peindre” Montaigne parle de son corps et de sa maladie, de sa sexualité, du moment où il va aux toilettes… Il se peint dans toute sa forme naïve (=naturelle) 1. Penser et peser l’Homme Projet de Montaigne : Livre I, Chapitre I, “Au lecteur” => Paradoxe : énonce deux vérités qui ne vont pas ensemble. Il dit qu’il n’écrit pas pour un lecteur mais le chapitre s’adresse “Au lecteur”. Cette affirmation est une exigence méthodologique qu’il se donne à lui-même : manière de s’imposer une contrainte intellectuelle => tout dire librement, être absolument honnête mais d’abord envers lui-même. Il encadre son travail d’introspection, voire de confession… => Révolution anthropologique : il s’agit de proposer un nouveau projet de l’observation de l’être humain (métaphore peinture). C’est un travail d’objectivation (ob-jectum = l’objet, ce qui est posé devant moi) de lui-même = se dédouble pour s’observer. Cette entreprise se voit par métaphore de la peinture et le dédoublement de la première personne => il y a le “Je” et le “Moi” qui parle (phénomène de scission) = “car c’est moi que je peins” Montaigne va essayer de peser ce moi et de l’évaluer => c’est le propre d’un essai (exagium, latin = signifie pesage). Ce “Moi” ne vaut pas grand chose, Montaigne le définit comme “un sujet si frivole et si vain”. Il pèse son Moi et estime qu’il ne vaut rien. Coup de fusil philosophique en direction d’un certain humanisme du début de la Renaissance qui considérait que l’être humain était supérieur en vertu de son intelligence, son esprit. C’est une provocation à l’encontre de ce courant humaniste. Ce n’est pas parce qu’il est vain, qu’il n’est pas merveilleux à observer, il reste fascinant. Au fondement de la pensée de Montaigne = idée d’une vanité très profonde qui doit le conduire à une certaine éthique. J’ai conscience que je ne suis rien, comment dois-je me comporter? => Projet éthique important qui doit passer par la connaissance de soi en premier lieu, pour ensuite agir convenablement avec les autres et dans le monde. Texte 2 : Essais, III, 9, De la vanité Utilisation deuxième personne permet de se mettre à distance. Passe par une altérité fictive pour mieux se connaître. Jeux de paradoxe dans chaque affirmation. Aucune définition ontologique de l’être humain. Montaigne est un penseur de la diversité. Il s’oppose au dogmatisme, refuse la définition, les étiquettes et les catégories. Il convient pour Montaigne d’observer les êtres humains avec une méthode empirique => empirisme = ce qui passe par l’expérience, par le fait d’avoir vécu. Montaigne est en ce sens moraliste, il observe les mœurs des personnages. Son intention ne réside pas dans le désir de se changer soi ou les autres mais de parvenir à une juste appréciation de soi et des autres. Il veut parvenir à une vérité nue de ce qu’il est vraiment, à une forme de dépouillement. => “ma forme naïve” (naïveté = naturel) Ce choix de naïveté = choix courageux de dire la vérité, de ne pas mentir à propos de sa propre personne, de ne pas se déguiser. Montaigne qui proteste une manière d’être et de questionner, il n’y a pas de doctrine. Il y a toute une pédagogie de la part de Montaigne. “J’aime qu’on me haïsse, déplaire est mon vice”, Cyrano de Bergerac 2. “Intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels” : la forme des Essais a) Il ne dit pas l’être humain dans son essence mais dans sa forme. Il fait une équivalence entre le corps et l’esprit. b) L’être humain ne peut pas se penser comme une entité désincarnée. On est toujours sous l’emprise du corps d’une manière ou d’une autre. Texte 3 : Essais, III, 5 = Expérience qui montre qu’on ne peut pas dissocier les deux. Montaigne essaie de dissocier le corps et l’esprit. Il émet une injonction à son esprit de contrer la vieillesse de celui-ci, tandis que son corps vieillit. Son esprit le trompe = il n’y a point de gaîté dans l’esprit, s’il n’y en a pas dans le corps. Essaie de penser aux dames (lien avec Catulle), à Sénèque… = il conclut une sorte d’association du corps et de l’esprit, presque contre lui-même. Jeu d’observation, de mise à distance = personnification de l’esprit “c’est un traître" et du corps “son compagnon”. Il met à distance son Moi, et les identifie comme des entités distinctes de lui. Met en avant le “privilège de l’esprit” face au corps néanmoins. Par l’écriture : les jeux de dédoublement, métaphores et personnification = outil d’introspection qui permet d’exprimer le Moi. Dans le texte : son écriture progresse de façon assez vive, on apprend à penser, observer des contradictions au gré des expériences… 3. Comment lire les Essais? Comment lire un écrivain qui s’y refuse? Montaigne est un écrivain qui se refuse à être écrivain parce qu'à l’époque écrivain est une condition avilissante (être écrivain c’est devoir écrire pour gagner sa vie). Montaigne est un gentilhomme noble qui a une certaine conscience de lui-même. Il doit se poser comme étant libre d’écrire. Les Essais sont l’oeuvre d’une vie, commence à écrire à 38 ans (se retire du Parlement Bordeaux pour aller sur ses terres de Montaigne) Apparition du premier tome des Essais en 1580 (Livre I et II) ➢ Nouvelle édition en 1588 qui ajoute le Livre III, qui date de la fin de la vie de Montaigne. ➢ Il reprend son texte tout au long de sa vie, le corrige etc. Texte 4 - Essais, livre III, 9 Ne célèbre pas son propre travail “quelque emblème surnuméraire” + métaphore de la marqueterie = idée de couches successives. => Volonté de ne pas passer pour un écrivain, celui qui n’a pas de dessein d’écriture, celui qui est entièrement libre dans son écriture. La métaphore de la marqueterie évoque aussi la progression argumentative des essais. Passe d’une idée/thème à l’autre par le fait de passer du littéral au figuré, passe du jeu au nous, par des analogies… Les Essais nous amènent à penser contre nous-même = penser à tout et son contraire. Dans l’ensemble donne le sentiment que les Essais ont un mouvement comme détraqué. On a l’impression que ça va tjs quelque part, mais on sait pas trop comment on y est arrivés. Pour la semaine prochaine => Réaliser un petit commentaire à partir de questions III, 13, p. 469-470 uploads/Litterature/ de-l-x27-humanisme-aux-lumieres.pdf
Documents similaires






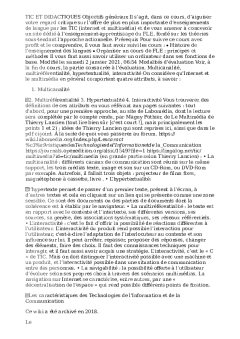



-
86
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 12, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1108MB


