LE SUICIDE ET SES VICISSITUDES Slavoj Žižek in Geneviève Morel, Clinique du sui
LE SUICIDE ET SES VICISSITUDES Slavoj Žižek in Geneviève Morel, Clinique du suicide Érès | « Des Travaux et des Jours » 2004 | pages 181 à 193 ISBN 9782749200804 DOI 10.3917/eres.morel.2004.01.0181 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/clinique-du-suicide---page-181.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Érès. © Érès. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) k¡?†·ƒ|ƒ~¡?¡‡?†¡†?¶ƒ|ƒ††ƒ‡·~¡† ? ?? "‒!†?…?c¡†?s‒\¶\·‚?¡‡?~¡†?i›·‒†? QOOSNP? fi\£¡†?PWP?Ÿ?PXR hrrm? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL `‒‡ƒ|“¡?~ƒ†fi›‹ƒ‘“¡?¡‹?“ƒ£‹¡?Ÿ?“F\~‒¡††¡Y ⁄‡‡fiYNN•••M|\ƒ‒‹Mƒ‹¢›N|“ƒ‹ƒfl·¡L~·L†·ƒ|ƒ~¡LLXVWQVSXQOOWOSLfi\£¡LPWPM⁄‡« LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL o›·‒?|ƒ‡¡‒?|¡‡?\‒‡ƒ|“¡?Y ??Ak¡?†·ƒ|ƒ~¡?¡‡?†¡†?¶ƒ|ƒ††ƒ‡·~¡†AK?c¡†?s‒\¶\·‚?¡‡?~¡†?i›·‒†K??QOOSNP??fiM?PWPLPXRM LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL cƒ†‡‒ƒ‘·‡ƒ›‹?"“¡|‡‒›‹ƒfl·¡?b\ƒ‒‹Mƒ‹¢›?fi›·‒?"‒!†M Å?"‒!†M?s›·†?~‒›ƒ‡†?‒"†¡‒¶"†?fi›·‒?‡›·†?fi\„†M k\ ‒¡fi‒›~·|‡ƒ›‹ ›· ‒¡fi‒"†¡‹‡\‡ƒ›‹ ~¡ |¡‡ \‒‡ƒ|“¡K ‹›‡\««¡‹‡ fi\‒ fi⁄›‡›|›fiƒ¡K ‹F¡†‡ \·‡›‒ƒ†"¡ fl·¡ ~\‹† “¡† “ƒ«ƒ‡¡† ~¡† |›‹~ƒ‡ƒ›‹† £"‹"‒\“¡† ~F·‡ƒ“ƒ†\‡ƒ›‹ ~· †ƒ‡¡ ›·K “¡ |\† "|⁄"\‹‡K ~¡† |›‹~ƒ‡ƒ›‹† £"‹"‒\“¡† ~¡ “\ “ƒ|¡‹|¡ †›·†|‒ƒ‡¡ fi\‒ ¶›‡‒¡ "‡\‘“ƒ††¡«¡‹‡M s›·‡¡ \·‡‒¡ ‒¡fi‒›~·|‡ƒ›‹ ›· ‒¡fi‒"†¡‹‡\‡ƒ›‹K ¡‹ ‡›·‡ ›· fi\‒‡ƒ¡K †›·† fl·¡“fl·¡ ¢›‒«¡ ¡‡ ~¡ fl·¡“fl·¡ «\‹ƒ!‒¡ fl·¡ |¡ †›ƒ‡K ¡†‡ ƒ‹‡¡‒~ƒ‡¡ †\·¢ \||›‒~ fi‒"\“\‘“¡ ¡‡ "|‒ƒ‡ ~¡ “F"~ƒ‡¡·‒K ¡‹ ~¡⁄›‒† ~¡† |\† fi‒"¶·† fi\‒ “\ “"£ƒ†“\‡ƒ›‹ ¡‹ ¶ƒ£·¡·‒ ¡‹ e‒\‹|¡M h“ ¡†‡ fi‒"|ƒ†" fl·¡ †›‹ †‡›|¤\£¡ ~\‹† ·‹¡ ‘\†¡ ~¡ ~›‹‹"¡† ¡†‡ "£\“¡«¡‹‡ ƒ‹‡¡‒~ƒ‡M¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) 4 LE SUICIDE EST-IL UN ACTE ? © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) Slavoj Zizek Le suicide et ses vicissitudes 1 Aujourd’hui, on peut être dépendant de tout : de l’alcool ou de la drogue, mais aussi de la nourriture, de la cigarette, du sexe, du travail, etc. Cette universalisation de la dépendance témoigne de la précarité absolue de la position subjective contemporaine : en l’absence de structures stables et prédéterminées, tout doit sans cesse être renégocié. Le suicide aussi. Dans Le mythe de Sisyphe, ouvrage par ailleurs tristement dépassé, Albert Camus signale avec raison que le suicide reste le seul problème véritable- ment philosophique. Se pose toutefois la question : à quel moment ce sta- tut est-il atteint ? Seule la société réflexive moderne permet d’arriver à ce point, quand la vie « ne va plus de soi », telle une catégorie « non mar- quée » (pour reprendre le concept de Jakobson 2), mais qui est « marquée » et doit être motivée (ce qui explique que l’euthanasie serait devenue tolé- 1. Traduction de l’anglais par Annie Bourgois. 2. R. Jakobson, « Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe » (1957), dans Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 185. « La signification générale d’une caté- gorie marquée réside en ceci qu’elle affirme la présence d’une certaine propriété (positive ou néga- tive) A ; la signification générale de la catégorie non marquée correspondante n’avance rien concer- nant la présence de A, et est employée principalement, mais non exclusivement, pour indiquer l’absence de A […] ; l’opposition des deux termes peut être interprétée comme « affirmation de A » / « pas d’affirmation de A. » © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) rable). Avant la modernité, on considérait que le suicide témoignait d’un dysfonctionnement pathologique, d’un désespoir, d’une détresse. Avec l’avènement de la réflexivité, le suicide est perçu comme un acte existentiel, le résultat d’une décision pure, irréductible à toute souffrance objective ou pathologie psychique. C’est l’autre face de la conception de Durkheim, qui réduit le suicide à un simple fait social pouvant être quantifié et prédit : l’objectivation et la quantification du suicide, ainsi que sa transformation en un pur acte existentiel, sont deux approches étroitement corrélées. Ce contexte éclaire notre lecture de Train de Nuit, un roman de Mar- tin Amis centré sur la tentative de « pathologiser » un suicide. La fille d’un haut fonctionnaire de police, jeune et apparemment heureuse, se tue. L’hé- roïne (une inspectrice de police), mandatée par le père pour percer le mys- tère de ce suicide, ne tarde pas à découvrir que les indices laissés par la morte (un amant de passage, sa dépendance à la drogue, etc.) sont faux et qu’en fait la jeune fille s’est tuée sans raison précise. Toutefois, comprenant que serait intolérable pour le père le malaise purement existentiel de sa fille, l’inspectrice dresse, dans son rapport final, le tableau trompeur d’une femme s’adonnant à la drogue et multipliant les aventures sexuelles. Ce tableau, où l’acte suicidaire est attribué à des causes claires, est plus sup- portable qu’un acte aux causes insondables. UNE HORREUR AU-DELÀ DU TRAGIQUE : LE PROCÈS DE BOUKHARINE Un tel acte est tout aussi intolérable au totalitarisme politique. Lacan l’a remarqué, l’absence de tragique pur de la condition humaine moderne rend celle-ci encore plus terrifiante. En dépit des horreurs du Goulag et de l’Holocauste, le tragique a indéniablement disparu depuis l’avènement du capitalisme. Ni les victimes des camps de concentration, ni celles des pro- cès-spectacles du stalinisme ne se trouvaient dans une situation tragique, au sens strict du terme ; leur situation était d’autant plus horrible qu’elle offrait aussi des aspects comiques, ou du moins ridicules. Cette horreur était si radicale qu’aucune sublimation n’était possible, et c’est singulière- ment la raison pour laquelle on ne peut l’approcher que par le biais de l’imitation parodique. Le discours stalinien nous offre peut-être l’exemple le plus patent de cette obscénité comique de l’horreur au-delà du tragique. La résonance kafkaïenne du rire étrange qui saisit l’auditoire, le 23 février 1937, pen- dant le dernier discours de Boukharine devant le Comité central, résulte de la discordance totale entre le sérieux de l’orateur et la réaction des Clinique du suicide 184 © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) © Érès | Téléchargé le 18/02/2023 sur www.cairn.info via Université Paris - Cité (IP: 195.220.128.226) membres du Comité. Boukharine évoque son suicide éventuel et les rai- sons pour lesquelles il a décidé d’y renoncer : ne pas nuire au parti et plu- tôt poursuivre jusqu’à son terme sa grève de la faim : « Boukharine : Je ne vais pas me tirer une balle, parce que les gens diront que je me suis tué pour nuire au parti. Mais, si je meurs, disons, d’une maladie, alors qu’est-ce que vous perdrez ? (rires) Des voix : Chantage ! Voroshilov : Canaille ! Ferme ta gueule ! Ignoble ! Comment oses-tu parler comme ça ? Boukharine : Comprenez-moi, c’est très dur pour moi de continuer à vivre. Staline : Et pour nous, alors ? Voroshilov : Non mais, vous l’entendez ? “Je ne vais pas me tuer, mais je vais mourir !” Boukharine : Ça vous est facile de parler de moi. Qu’avez-vous à perdre, après tout ? Écoutez, si je suis un saboteur, un fils de pute, pour- quoi m’épargner ? Je ne revendique rien. Je vous explique simplement ce que j’ai dans la tête, ce que je subis. Si, d’une manière ou d’une autre, cela devait entraîner quelque préjudice politique, fût-ce minime, alors je renoncerais, je ferais ce que vous me dites (rires). Pourquoi riez-vous ? Il n’y a vraiment pas de quoi 3… » Ne retrouvons-nous pas là, projetée dans la réalité, l’inquiétante logique de l’interrogation de Joseph K. dans Le procès ? « “Bon”, dit le juge d’instruction en feuilletant son calepin. Et, se tournant vers K., il ajouta sur le ton de la constatation : “Vous êtes donc artisan-peintre ? – Non, dit K., je suis le premier fondé de pouvoir dans une grande banque.” Cette réponse fut accueillie à droite par un rire si communicatif que même K. se mit à rire. Les gens s’appuyaient des deux mains sur leurs genoux et se tordaient, comme en proie à une forte quinte de toux 4. » Dans l’affaire Boukharine, la discordance qui provoquait le rire était radicale : du point de vue des staliniens, le suicide était dépourvu de toute authenticité subjective, il était tout simplement instrumentalisé, réduit à n’être qu’une des formes les plus sournoises du complot contre-révolu- tionnaire. Molotov fut très explicite le 4 décembre 1936 : « Le suicide de Le suicide et ses vicissitudes 185 3. Arch J. Getty et V. Naumov Oleg, The Road to Terror, uploads/Litterature/ eres-morel-2004-01-0181 1 .pdf
Documents similaires








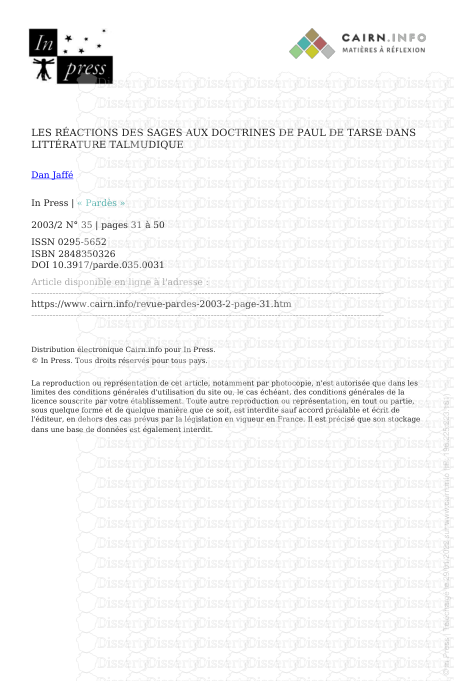

-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 11, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6096MB


