JACQUES SADOUL Histoire de la science-fiction moderne (1911-1975) Tome II Éditi
JACQUES SADOUL Histoire de la science-fiction moderne (1911-1975) Tome II Édition augmentée par l’auteur © Éditions Albin Michel, 1973 Domaine français (1905-1975) 1 HIER… (1905-1949) Les précurseurs de la science-fiction évoqués au cours de l’Introduction(1) de cet ouvrage ont donné dans notre pays une descendance bien différente de celle d’outre-Atlantique. D’une certaine manière, on pourrait même prétendre que la science-fiction moderne, telle que nous l’avons définie, n’a commencé en France que dans les années 50 à l’imitation des auteurs américains. Ce serait à la fois injuste et faux ; injuste car l’anticipation scientifique française d’avant-guerre fut une des plus riches du monde ; et faux car certains de ses membres, Maurice Renard en particulier, eurent une influence non négligeable sur les auteurs américains. Dans ce chapitre, nous allons donc passer en revue les textes parus avant le déferlement anglo-saxon des années 50. L’histoire de la S-F française, durant cette période, va se présenter fort différemment de celle d’Angleterre ou d’outre-Atlantique. En effet, il n’y eut pas dans notre pays de revues totalement spécialisées pour réunir les auteurs et créer un mouvement cohérent. Certes, des journaux comme Le Journal des Voyages, puis, à une échelle moindre, Je sais tout et Sciences et Voyages, ont fréquemment publié des feuilletons d’anticipation. Mais ils ont toujours été mélangés à des récits d’aventures ou d’exploration. Ce sont donc des auteurs isolés qui, au hasard des publications, ont poursuivi individuellement la tradition de Jules Verne, l’ont éventuellement enrichie et ont créé une forme originale de littérature d’anticipation dont les derniers feux s’éteignirent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps ignorée dans notre pays, cette littérature a fait l’objet depuis 1950 de nombreuses études, un peu par réaction contre la science-fiction américaine, supposée connue. La lecture du présent livre aura montré sans peine qu’en fait, seules quinze années de cette S-F d’outre-Atlantique, les années 40 à 55, étaient réellement connues dans notre pays. La première étude, due à Jean-Jacques Bridenne, parut en 1950 et a pour titre La littérature française d’imagination scientifique. Ce fut ensuite la revue Fiction qui consacra de nombreux articles à l’étude des auteurs de la période d’avant-guerre, articles dus à Jean-Jacques Bridenne lui-même, Jacques van Herp, Jean-Louis Bouquet, Pierre Versins, etc. Nous allons retrouver immédiatement ce dernier nom puisque, en 1972, Versins publia une Encyclopédie de l’Utopie, des Voyages extraordinaires et de la Science-fiction, énorme volume de près de mille pages. L’auteur y traite abondamment des auteurs de l’Antiquité et des siècles passés, et fait une recension très complète de tous les écrivains d’expression française, présents ou passés. En revanche, la S-F américaine est volontairement négligée, par exemple Restif de la Bretonne, qui écrivait à la fin du XVIIIe siècle, a droit à dix-huit colonnes, Robida à neuf colonnes, van Vogt à une, Nat Schachner n’est même pas cité. Certes, en raison des dimensions de l’Encyclopédie, Versins consacre sans doute autant de lignes que moi à la S-F made in U.S.A., mais il donne constamment la primauté aux précurseurs européens. C’est pourquoi je mentionne seulement cet ouvrage, par ailleurs remarquable, au chapitre consacré aux romans scientifiques français d’avant- guerre. La collection Ailleurs et Demain classique a édité Sur l’autre face du monde et autres romans scientifiques de Sciences et Voyages, qui comporte, outre une longue introduction de Gérard Klein sur la S-F française d’avant-guerre, une étude détaillée de Jacques van Herp sur les romans publiés par Sciences et Voyages. Ce même auteur prépare en ce moment un ouvrage sur la S-F intitulé Panorama de la Science-fiction(2), et il m’a fait part de son intention de choisir de préférence ses exemples parmi les auteurs d’expression française qu’il estime injustement méconnus par rapport aux Anglo-Saxons. J’ai sans doute le défaut de ne pas être assez chauvin, mais je ne vois pas l’utilité de m’agenouiller pieusement devant l’œuvre de Jean de la Hire, sous prétexte que le hasard l’a fait naître français, alors que presque n’importe quel écrivain américain est beaucoup plus intéressant. Ceci posé, je m’empresse de dire que de nombreux auteurs d’expression française, depuis J.-H. Rosny aîné jusqu’à René Barjavel, ont écrit des ouvrages qui soutiennent, et de loin, la comparaison avec leurs collègues d’outre-Atlantique et que, par suite, si l’anticipation scientifique française ne justifie pas la vénération béate que lui portent certains nostalgiques, elle mérite, en revanche, d’être mieux connue. Et il est, par exemple, très regrettable de constater que trois historiens de la S- F, tels que Sam Moskowitz, Brian Aldiss et Alexei Panshin l’ignorent presque totalement. J’ai décidé de donner comme point de départ à cette étude l’année 1905 qui est celle de la mort de Jules Verne et de la rédaction de sa dernière œuvre L’éternel Adam. Cette nouvelle ne parut en librairie que cinq ans plus tard, en 1910, incluse dans le recueil intitulé Hier et Demain. L’éternel Adam raconte une fin du monde très pessimiste, contrastant avec l’esprit général de l’œuvre de Verne, toujours tourné vers l’optimisme, l’esprit d’entreprise, la confiance dans l’avenir. Certains sont même allés jusqu’à supposer qu’à la fin de sa vie Verne en était venu à douter de la science. En effet, cet écrivain ainsi que nombre de ses successeurs paraissent avoir estimé que la société de leur époque ne pourrait supporter le choc causé par des inventions trop nouvelles, ou ne résisterait pas à un cataclysme naturel, ce qui, dans les deux hypothèses, entraînerait immanquablement le soulèvement des masses populaires contre l’ordre établi, en un mot, la révolution. Ces deux éventualités sont particulièrement bien illustrées par le roman de Rosny aîné, La force mystérieuse, et par celui de Maurice Leblanc, Le formidable événement. Dans le cas de Jules Verne, je ne pense pas que L’éternel Adam traduise une remise en question de toutes ses conceptions passées. Cet écrivain, même s’il s’est présenté aux élections municipales d’Amiens sur une liste de gauche (ce qui est loin d’être établi, d’ailleurs) était profondément attaché à l’ordre bourgeois établi, mais en pressentait la fragilité. Dès 1905, les signes avant-coureurs de la guerre de 14 sont déjà évidents et c’est sans doute ce qui poussa Verne à écrire cette méditation désabusée qu’est L’éternel Adam : « Au reste, il n’en fallut pas plus pour que l’optimisme de Sofr fût irrémédiablement bouleversé. Si le manuscrit ne présentait aucun détail technique, il abondait en indications générales et prouvait d’une manière péremptoire que l’humanité s’était jadis avancée plus avant sur la route de la vérité qu’elle ne l’avait fait depuis : tout y était, dans ce récit, les notions que possédait Sofr et d’autres qu’il n’aurait même pas osé imaginer – jusqu’à l’explication de ce nom d’Hedom sur lequel tant de vaines polémiques s’étaient engagées. Hedom, c’était la déformation d’Edam, lui-même déformation d’Adam, lequel Adam n’était peut-être que la déformation de quelque mot plus ancien. (…) Et peut-être, après tout, les contemporains du rédacteur de ce récit n’avaient-ils pas inventé davantage ! Peut- être n’avaient-ils fait que refaire, eux aussi, le chemin parcouru par d’autres humanités, venues avant eux sur Terre. » Inutile de préciser que la civilisation dont la mort est racontée par notre lointain descendant Sofr est la nôtre. Jules Verne a certainement douté de la continuité indéfinie du progrès scientifique ; en revanche, rien ne permet de penser qu’il ait cessé de croire en la science, contrairement aux jeunes auteurs américains et britanniques contemporains. Et il semble que, chez les auteurs d’anticipation scientifique française d’avant-guerre, ce soient les conséquences sociales des découvertes scientifiques qui sont redoutées et non les possibilités d’apocalypse contenues dans la science elle-même. L’œuvre de Robida se situe pour la majeure partie au XIXe siècle, bien que ce dessinateur et écrivain, né en 1848, ne soit décédé qu’en 1926. Son chef- d’œuvre est peut-être Le XXe siècle, paru en 1882 et consacré à des scènes de la vie quotidienne des années 1950. Mais je ne veux pas remonter trop loin dans le temps et je me contenterai de citer L’Horloge des siècles publié en 1902, et donc presque dans les limites de ce chapitre ! Une situation cataclysmique y commence de la façon la plus banale : un homme qui a perdu une dent la sent repousser ! Un phénomène cosmique inconnu a amené la Terre à tourner à l’envers et le temps s’est mis à reculer. Les vieillards s’acheminent doucement vers leur jeunesse et les épouses acariâtres redeviennent de douces jeunes filles ! Au début donc, les choses ne vont pas si mal, mais lorsque les morts commencent à renaître, lorsque les sociétés doivent rendre aux actionnaires leur capital, etc., la société est ébranlée et menace de s’effondrer. Robida ne conclut pas et s’arrête assez brutalement lorsque le temps a régressé jusqu’à l’époque de Waterloo. Il est intéressant de noter que le cataclysme est intervenu alors même qu’un immense mouvement revendicatif, d’ordre social, allait triompher dans les pays industrialisés. Là, contrairement aux ouvrages de Rosny ou de Leblanc, ce n’est pas le cataclysme qui provoque la révolution sociale, mais au contraire qui l’empêche de réussir. Avant d’abandonner Albert Robida, disons que vous uploads/Litterature/ histoire-de-la-science-fiction-2.pdf
Documents similaires




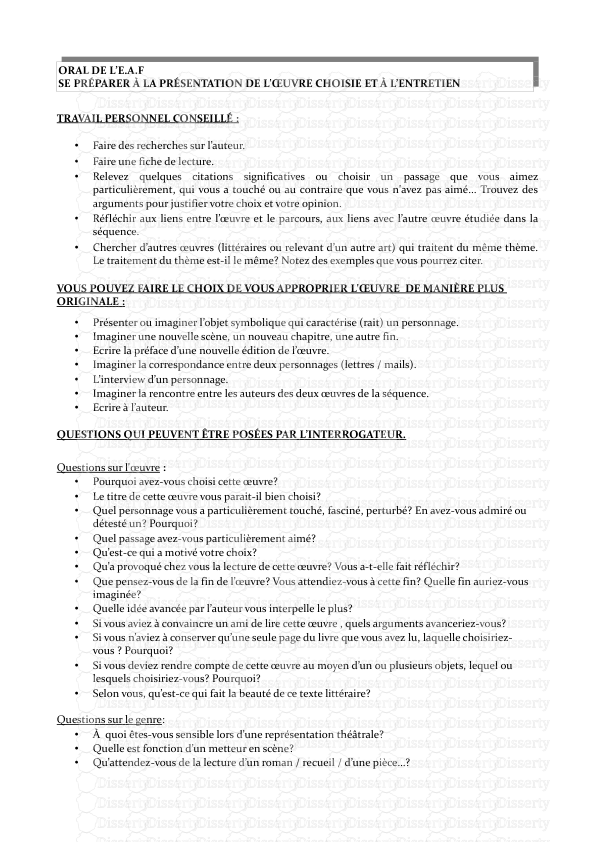





-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 02, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5800MB


