Centre Universitaire Belhadj BOUCHAÏB Ain-Temouchent Institut des lettres et la
Centre Universitaire Belhadj BOUCHAÏB Ain-Temouchent Institut des lettres et langues étrangères Département des lettres et langue française Travail personnel n°… Matière : histoire des idées Option : Littérature et civilisation Sous la direction de Elaboré et présenté par : Dr Bouterfas Belabbes Mme Himoun.L Année Universitaire : 2019-2020 1 Commentaire Les métamorphoses du sens, les séries de rectifications constituent des filiations, des enchaînements de courants d’idées que Sylvère Monod, dans son introduction au livre de Pierre Vitoux sur l’histoire des idées en Grande-Bretagne avait considéré comme l’objet d’étude privilégié de l’histoire des idées8. La tâche de l’historien des idées est donc de travailler sur ces rectifications du sens et il est important de signaler aussi que cela ne peut se comprendre que dans un contexte de crise des interprétations dominantes, de « conflit des interprétations » en quelque sorte. Mais alors, comment décrire sa finalité? L’histoire des idées exprimerait-elle un relativisme absolu quant à la prétention des idées à atteindre la vérité ou peut-on prétendre qu’elle consiste plus en un relativisme discriminant parmi des idées ou des systèmes de pensée proches dans le temps ou dans leur facture épistémologique? Plus encore, dans la mesure où l’histoire des idées est susceptible d’effectuer également des rectifications de sens, ne peut-on pas exiger de sa méthode qu’elle soit aussi soumise à des ré-interprétations possibles, épousant à l’instar de la science la condition d’être un « processus contingent » garant de son objectivité? C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de se diriger vers des auteurs qui ont cherché à théoriser l’histoire des idées, et de prendre deux exemples encadrant presque un siècle de réflexion sur cette question dans les pays anglo-saxons afin de montrer que leur difficultés à constituer une méthode, loin d’avaliser l’idée de l’inconsistance méthodologique de l’histoire des idées chère à Foucault, renseignent utilement sur la direction dans laquelle il faut la penser. 2 L’histoire des idées L’histoire des idées est loin de faire l’unanimité, la critique de l’objectivité de l’histoire demeure un exercice délicat où plusieurs courants dominants s’opposent, cependant l’idée même que l’histoire progresse via des métamorphoses du sens et des séries de rectifications, lui confère une réflexivité consciente, et rétrospectivement le statut de science dans la mesure où elle admet que ses vérités ne sont pas établies et acceptent la réfutation. Il n’est nullement aisé de trouver un cheminement logique, naturel, qui « coulerait de source » pour l’histoire des idées, à cause notamment de la dissension qui l’a de tout temps accompagné, et nonobstant la transversalité, très en vogue ces derniers temps. Adoptée par la recherche, elle essuie encore un manque cruel de reconnaissance et une absence de statut en tant que discipline à part entière. Une sensibilité bien française, influencée notamment par la critique faite par Michel Foucault dans son livre « Archéologie du savoir » qui semble être à l’origine de cette incurie vis-à-vis de l’histoire des idées qui ne sait plus où la situer entre la philosophie, l’histoire, la sociologie, la littérature et la psychologie, pour la déposséder en définitive de son véritable statut. Le peu de considération dont l’histoire des idées a hérité en France contraste avec son franc succès outre-Manche (Grande-Bretagne) où elle jouit d’une reconnaissance certaine. Même son de cloches aux Etats-Unis, où l’on peut trouver beaucoup d’articles, travaux, ouvrages qui lui ont été consacrés. Une attention toute particulière semble être accordée au fait que, l’histoire des idées n’est ni celle de la philosophie ni celle des mentalités, on la considère comme unique de par son évolution ponctuée de méthodologies controversées. Dans ces circonstances , nous tenterons de répondre au premier volet de la problématique posée : l’histoire des idées exprimerait-elle un relativisme absolu quant à la prétention des idées à atteindre la vérité ? c’est en tous les cas ce que semble soutenir les anti-fondationnalistes tel que Michel Foucault qui le déclare, dans son recueil, l’archéologie du savoir (1969) : « pas facile de caractériser une discipline comme l’histoire des idées » qu’il qualifie comme objets incertains aux frontières mal définies. Bien entendu Foucault n’est pas le seul à avoir cette opinion de l’histoire des idées, il rapporte surtout ce que certains en pensaient à la fin du dix-neuvième siècle : que l’histoire des idées est surtout l’histoire de phénomènes marginaux, science non catégorisée, elle s’explique par le ou les discours, son problème se situe dans un contexte d’une métamorphose moderne de l’histoire globale où il met en exergue le document historique, qui au fil du temps, s’est transformé en un véritable monument, . Il lui oppose « son archéologie », qu’il présente comme une nouvelle façon d’écrire l’histoire (y compris celle des idées) à qui il attribue une portée plus universelle, elle se distingue en quatre points : 3 La définition de l’histoire par des moyens philosophiques, la notion prépondérante de la discontinuité, elle omet le moment de l’histoire où l’individu et le social s’inversent, la vérité qu’elle veut établir est celle du discours pas celle de l’histoire. Autre rives, autre pensée, Arthur O.Lovejoy, cocréateur en 1923 du club des histoire des idées « history of ideas club » à la John Hopkins university avec George Boas. A la différence de Foucault, Lovejoy accorde énormément d’importance à l’histoire des idées qu’il voit comme une entreprise interdisciplinaire (philosophie, littérature, sciences, savoir canonique, croyances collectives etc…) de manière générale, il étudie l’évolution d’une idée en se penchant sur toute la culture qui l’englobe, et c’est en ce sens qu’un de ses thèmes privilégiés en abordant la question est celui de la libre circulation qu’on doit octroyer à l’idée pour outrepasser les frontières de la linguistique et s’accomplir. Un second thème caractérise au mieux l’approche de Lovejoy : « l’unit-Idea » qu’on peut traduire par « idée unitaires » ou « concept individuel », selon laquelle les idées se combinent et se différencient en des modes de pensées, à des époques différentes, qu’il incombe à l’historien des idées de déceler, de décrire, d’analyser et de comprendre. A la lumière de ce qui précède, la vision de Lovejoy converge vers l’idée traditionnelle qui veut qu’un sens évolue, se métamorphose à la suite d’innombrables rectifications, reprises, récessions successives sous de nouvelles formes. Le rôle de l’historien des idées, selon ce théoricien , consistait à utiliser ces « idées unitaires » afin d’extraire l’idée de base de tout travail ou mouvement philosophique. Plusieurs auteurs ont contesté l’un ou l’autre, mais d’autres ont trouvé une troisième voie pour expliquer la « logique de l’histoire des idées » entre le relativisme absolu et le déterminisme absolu, c’est le cas de Mark Bévir, qui la définit comme « étude des significations générées par les cultures selon une perspective historique », il estime qu’elle doit bénéficier d’une grammaire de concepts, une modélisation formelle qui lui attribuerait « un processus contingent » et donc lui ouvrir la possibilité d’une réfutation, falsification attestant ainsi de son caractère scientifique. Bévir semble se contenter de statuer l’histoire idée, mais rien ne laisse transparaître qu’il eut voulu développer une méthode normative axée sur la grammaire des concepts. Quentin Skinner s’est attaqué à la question, en s’opposant aux « unit-ideas » de Lovejoy, en affirmant que « la réification des doctrines » a des conséquences négatives. Historien des fondements de la pensée politique moderne, qui se base sur l’importance du contexte dans lequel un texte politique a été produit, en transposant cette théorie à l’histoire des idées, il souligne que les idées doivent être appréhendées dans leurs contextes respectifs. C’est ainsi qu’il dénonce fortement les bricolages historiques et autres anachronismes dans l’histoire traditionnelle anglosaxonne. Aux termes de cette lecture des histoires des idées, nous nous rendons compte de sa prééminence, dans un monde de plus en plus complexe, elle permet d’échapper aux diktats des différents paradigmes de par son antidogmatisme entrouvrant notre pré carré sur d’autres idées susceptibles de nous aider à mieux saisir les situations paradoxales ou éristiques. 4 La France a longtemps boudé cette discipline, néanmoins elle a tout à gagner en lui accordant une plus grande importance, de par sa valeur médiatrice, elle plaide utilement pour un recouvrement de connaissance si tant est qu’elle soit délimitée dans son champ d’action pour respecter les autres disciplines avec lesquelles elle s’entremêle et s’imbrique inévitablement. Bibliographie 5 Philip Piener Wiener (éd.), Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, New York, Scribner, 1973. Angenot Marc, L’histoire des idées : problématique, objets, concepts, méthodes, enjeux, débats, Presse Universitaire de Liège, Liège, 2014. Mandelbaum Maurice, The history of ideas, intellectual history, and the history of philosophy, dans Burns Robert M., Historiography. Critical Concepts in Historical Studies, Vol. III, Routledge, London & New-York, 2006. (en) Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being : A Study of the History of an Idea, 1936 Donald R. Kelley, « Ideas, History of » dans Daniel R. Woolf (en), A Global Encyclopedia of Historical Writing, New-York & London, Garland, 1998. Mark Bevir, The Logic of the History of Ideas, Cambridge: CUP, 1999. uploads/Litterature/ histoire-des-idees.pdf
Documents similaires


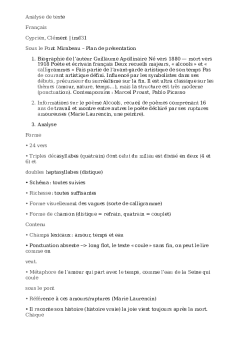
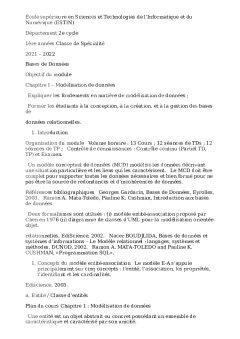






-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 25, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1232MB


