Histoire de l’éducation 120 | 2008 Le cours magistral XVe-XXe siècles Fabriquer
Histoire de l’éducation 120 | 2008 Le cours magistral XVe-XXe siècles Fabriquer et recevoir un cours magistral Les cours de mécanique appliquée de Jean-Victor Poncelet à l’École de l’Artillerie et du Génie et à la Sorbonne, 1825-1848 The Manufacture and Reception of a Lecture. The Lectures on Mechanics Delivered by Jean-Victor Poncelet (1825-1848) Ausarbeitung und Rezeption einer Vorlesung. Der Mechanikunterricht des Professors Jean-Victor Poncelet (1825-1848) Elaborar y recibir una clase ex cátedra. Las clases de mecánica impartidas por Jean-Victor Poncelet (1825-1848) Konstantinos Chatzis Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/histoire-education/1837 DOI : 10.4000/histoire-education.1837 ISSN : 2102-5452 Éditeur ENS Éditions Édition imprimée Date de publication : 1 septembre 2008 Pagination : 113-138 ISBN : 978-2-7342-1132-7 ISSN : 0221-6280 Référence électronique Konstantinos Chatzis, « Les cours de mécanique appliquée de Jean-Victor Poncelet à l’École de l’Artillerie et du Génie et à la Sorbonne, 1825-1848 », Histoire de l’éducation [En ligne], 120 | 2008, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 21 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/histoire- education/1837 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoire-education.1837 © Tous droits réservés Histoire de l’éducation | n° 120 | octobre-décembre 2008 | 113-138 Fabriquer et recevoir un cours magistral Les cours de mécanique appliquée de Jean-Victor Poncelet à l’École de l’Artillerie et du Génie et à la Sorbonne, 1825-1848 Konstantinos CHATZIS Jean-Victor Poncelet (1788-1867), polytechnicien de la promotion 1807 (X-1807), ingénieur militaire du corps du Génie, entame au milieu des années 1820 une longue carrière de professeur de mécanique. De 1825 à l’an- née de son élection à l’Académie des sciences, en 1834, il dispense un cours de machines devant les élèves de l’École de l’Artillerie et du Génie de Metz avant d’occuper jusqu’en 1848 la chaire de mécanique physique et expérimentale à la Sorbonne, créée spécialement pour lui en décembre 1837. Ce sont ces deux prestations didactiques de Poncelet qui seront analysées ici dans une perspective particulière, qui envisage le cours magistral comme un objet, « fabriqué » d’abord, « mis sur le marché » ensuite et « consommé » par les divers publics d’auditeurs et de lecteurs qui l’ont reçu 1 (faute de place, le 1 Nous avons décidé de regrouper au sein d’un seul « pôle », à côté de celui de la « fabrication », les deux moments de la « mise sur le marché » et de la « consommation » (réception) de l’objet « cours magistral ». La principale raison est que, dans les faits, une seule réalité peut relever de deux mo- ments : par exemple, en décidant d’incorporer dans ses propres travaux publiés des extraits d’un cours magistral fait par un collègue, un auteur réserve un accueil positif au cours en question (moment de la réception) tout en devenant un vecteur supplémentaire de sa « mise sur le marché ». Il en va de même de la traduction de la publication originale d’un cours : l’opération témoigne de l’accueil du cours à l’étranger et constitue en même temps un nouveau vecteur pour sa diffusion. Inutile de le préciser, les trois moments de la vie d’un cours magistral, à savoir sa « fabrication », d’un côté, sa « mise sur le marché » et sa « consommation », de l’autre, peuvent entretenir entre eux des relations de rétroaction : ainsi le professeur peut être amené à re-fabriquer son cours à la lumière des réactions enregistrées de la part de ses divers publics. L’objet « cours magistral » entame alors un nouveau cycle de « fabrication, mise sur le marché, consommation ». 114 Konstantinos CHATZIS contenu proprement dit du cours sera mis provisoirement entre parenthèses). Filons cette métaphore économique 2. Fabriquer : La fabrication d’un « objet » implique un processus de produc- tion, activité impliquant en général plusieurs acteurs. Il en va ainsi du cours magistral. S’il occupe une place déterminante dans la confection de son cours, le professeur agit rarement de façon solitaire et dans l’isolement. Pour fixer le contenu de son enseignement, il emprunte à des auteurs, passés et contem- porains, tout en se faisant souvent aider de multiples façons par des « aides de camp » variés : des collaborateurs qui se livrent à des expériences sur des sujets pour lesquels le professeur manque de données ou qui tiennent même parfois la plume à sa place dans la rédaction de certaines parties, voire de la totalité, des leçons… Le professeur est aussi aux prises avec les représentants de l’institu- tion au sein de laquelle il donne son enseignement : toujours commanditaires du cours, ces derniers s’érigent souvent en prescripteurs, qu’il s’agisse des matières à enseigner ou des méthodes pédagogiques à mettre en œuvre. Loin d’être l’enregistreur passif de la parole professorale, l’élève, enfin, n’en participe pas moins à la production du cours : par l’intermédiaire des représentations que le professeur se fait de ses besoins et de ses capacités de compréhension, il conditionne, en grande partie, sinon le fond de l’enseignement, à coup sûr la forme précise que celui-ci doit emprunter ; par ses performances en matière d’assimilation de la parole professorale, il peut pousser le professeur à expéri- menter de nouveaux dispositifs pédagogiques 3. Mettre sur le marché et consommer : Fabriqué, le cours magistral est « mis sur le marché » selon des voies diverses, avant d’être « consommé » par les 2 Notons ici que des historiens des sciences et des historiens du livre ont aussi fait appel à des voca- bulaires relevant de la science économique. Ainsi, Franck Achard parle, à propos de la publication du fameux traité de Maxwell sur l’électricité et le magnétisme, d’« offre » (la théorie de Maxwell ar- rivée à sa maturité) et de « demande » (l’existence de lecteurs susceptibles de lire le livre) dans « La publication du Treatise on electricity and magnetism de James Clerk Maxwell », Revue de synthèse, 4e série, n° 4, oct.-déc. 1998, p. 511-544, en particulier p. 514. Karen Wood emploie, à propos des travaux de Sir William Hamilton (1730-1803), l’expression de “preparation, production, distribution and consumption” : cf. « Making and circulating knowledge through Sir Wiliam Hamilton’s Campi Phlegraei », British Journal for the History of Sciences, vol. 39, n° 1, mars 2006, p. 67-96 (p. 67). On trouve, sous la plume de Marina Frasca-Spada et Nick Jardine, l’expression “production, distribution and consumption of books” dans leur introduction de Books and the Sciences in History, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 9. Sur la chaîne « production, circulation et réception » des formes symboliques en général, voir aussi les réflexions de Peter Burke, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Paris, Éditions du Seuil, 1995 (1re éd. anglaise 1992). 3 Sur la rétroaction du « récepteur » sur l’ « émetteur », voir les réflexions que Robert Darnton pro- pose au sujet de l’histoire du livre dans son ouvrage The Kiss of Lamourette : Reflections in Cultural History, New York/Londres, W.W. Norton & Co., 1990, p. 107-135. Les cours de mécanique appliquée de Poncelet, 1825-1848 115 différents publics qui vont le recevoir. La parole du professeur atteint déjà un premier cercle restreint de « clients », formé de tous ceux qui assistent physi- quement au cours. Ce premier espace de réception du cours peut être élargi, parfois de façon spectaculaire, grâce au pouvoir de l’écrit. Il arrive que le cours professé soit publié du vivant de l’auteur, parfois sans son autorisation, ou à titre posthume. Mais, comme le cas de Poncelet le montre amplement, même s’il n’a jamais été édité, un cours peut être acheminé vers de larges publics qui n’ont jamais entendu la voix du professeur. Parfois, les notes prises par les auditeurs se transforment en documents publiés. Celles qu’a rédigées l’enseignant pour son usage personnel peuvent aussi être prêtées et copiées, en totalité ou en partie, et circuler au long de ses réseaux de sociabilité ; les destinataires de ces notes sont susceptibles, alors, d’en publier des morceaux choisis. Arrive enfin le moment de la « consommation » du cours magistral, à savoir celui de sa réception et de son utilisation par ses différents publics, qu’ils soient contemporains du professeur ou d’une époque postérieure : élèves, collègues, professionnels, voire l’« opinion publique » – telle qu’elle s’exprime dans la presse non spécialisée, par exemple –, reçoivent et utilisent un même cours en fonction de leurs propres « champ d’expérience » et « horizon d’attente » 4. Si les deux premiers moments dans le cycle de vie d’un cours magistral, sa « fabrication » et sa « mise sur le marché », ont des bornes temporelles plus ou moins circonscrites – il arrive un temps où le cours trouve sa forme plus ou moins stabilisée et a épuisé les canaux possibles qui l’amènent au « marché » –, l’acte de sa « consommation » peut théoriquement, en revanche, se perpé- tuer pendant des périodes de temps indéfinies. Où arrêter alors l’analyse de la réception d’un cours ? Heureusement pour l’historien, c’est l’histoire elle- même qui répond le plus souvent à sa place : tôt ou tard – et plutôt tôt pour uploads/Litterature/ histoire-education-1837.pdf
Documents similaires


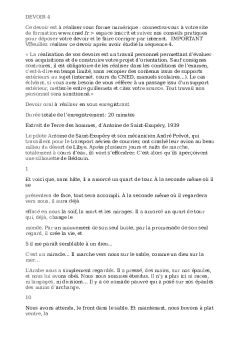







-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2727MB


