Médiévales Langues, Textes, Histoire 52 | printemps 2007 Le livre de science, d
Médiévales Langues, Textes, Histoire 52 | printemps 2007 Le livre de science, du copiste à l'imprimeur La tradition alchimique latine (XIIIe-XVe siècle) et le corpus alchimique du pseudo-Arnaud de Villeneuve Antoine Calvet Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/medievales/2003 DOI : 10.4000/medievales.2003 ISSN : 1777-5892 Éditeur Presses universitaires de Vincennes Édition imprimée Date de publication : 1 juin 2007 Pagination : 39-54 ISBN : 978-2-84292-202-3 ISSN : 0751-2708 Référence électronique Antoine Calvet, « La tradition alchimique latine (XIIIe-XVe siècle) et le corpus alchimique du pseudo- Arnaud de Villeneuve », Médiévales [En ligne], 52 | printemps 2007, mis en ligne le 06 septembre 2009, consulté le 20 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/medievales/2003 ; DOI : 10.4000/ medievales.2003 Tous droits réservés Médiévales 52, printemps 2007, p. 39-54 Antoine CALVET LA TRADITION ALCHIMIQUE LATINE (XIIIe-XVe SIÈCLE) ET LE CORPUS ALCHIMIQUE DU PSEUDO-ARNAUD DE VILLENEUVE L’histoire de la tradition alchimique médiévale commence avec les traduc- tions en latin de textes arabes. Elle est relativement bien connue, s’inscrivant dans le mouvement des grandes traductions de la philosophie arabe entrepris au XIIe siècle à Tolède. Les traducteurs les plus célèbres comme Hugues de Santalla (vers 1140-1150), Robert de Chester (1144), Gérard de Crémone († vers 1187) participèrent à ce travail. Vers 1200, l’Anglais Alfred de Sareshel donna en latin quelques chapitres de la Météorologie du Shifa’ d’Avicenne qu’il crut bon d’ajouter à la version arabo-latine du livre III des Météorolo- giques d’Aristote. Ce texte, connu plus tard sous le nom de De congelatione et conglutinatione lapidum 1, marqua profondément l’histoire de l’alchimie latine 2. La période des traductions d’arabe en latin s’achève vers la fin du XIIe siècle. Les plus grands classiques de l’alchimie arabe comme les textes de Razi ou de Jâbîr ibn-Hayyan sont alors passés en Occident, exerçant une influence 1. AVICENNE, De congelatione et conglutinatione lapidum being sections of the Kitâb al- Shifa’, E. J. HOLMYARD, D. C. MANDEVILLE éd., Paris, 1927, p. 45-55. Le ms. Paris, BnF, lat. 14005, d’origine allemande et datable du début du XVe siècle (1re main jusqu’au fo 140vo), entiè- rement revu et annoté par une main du XVIe siècle, contenant des classiques de l’alchimie comme le Liber de compositione alkimiæ de Morienus, la préface et le prologue à ce dernier de Robert de Chester, des synonymies (lexiques), des énigmes alchimiques (Allegoria Merlini), la relation de voyage de Leonard de Mauperg (avec des recettes signées) ; ce manuscrit, dans sa dernière partie (3e main plus tardive), transmet le Tractatus de mineralibus Avicennæ aux fo 146vo-164. Sur ce manuscrit, outre J. CORBETT, Catalogue des manuscrits alchimiques latins, manuscrits des bibliothèques publiques de Paris antérieurs au XVIIe siècle, Bruxelles, 1939, I, no 52, p. 175, voir R. LEMAY, « L’authenticité de la Préface de Robert de Chester à sa traduction du Morienus », Chrysopœia, 4, 1990-1991, p. 3-34, et D. KAHN, « Littérature et alchimie au Moyen A ˆ ge », Micrologus, III, 1995 : Le crisi dell’alchimia, p. 227-262, ici p. 244-252, p. 257-262 (éd. de l’Allegoria Merlini). 2. Cf. W. R. NEWMAN, The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber, Leyde, 1991, p. 1-56. 40 A. CALVET capitale, comme en témoigne leur présence constante, sous forme d’extraits, dans les textes d’alchimie latine. Ces derniers apparaissent dès le début du XIIIe siècle dans le sillage des travaux de Michel Scot, ou dans celui plus important d’Albert sur les métaux ou des réflexions d’un Roger Bacon sur la Longue vie rendue possible, selon ce dernier, par l’alchimie. Le corpus d’alchimie latine le plus significatif de cette période est à n’en pas douter celui du pseudo-Geber (alias Paul de Tarente) qui tourne la page d’une cer- taine alchimie arabe dominée par les théories du pseudo-Avicenne. Car si ces traités dépendent en partie de l’alchimie léguée par les Arabes, ils déve- loppent également de nouvelles thèses plus spécifiquement influencées par l’enseignement scolastique, par exemple pour obvier à l’autorité d’Avicenne qui, dans le Sciant artifices (extrait du De congelatione), circulant dans le monde latin sous le nom d’Aristote, déniait à l’alchimiste le pouvoir de trans- former les métaux sinon en revenant à la « matière première ». A ` l’aube du XIVe siècle, la situation des textes alchimiques latins se présente ainsi. D’une part, des textes arabo-latins transmettant des pratiques alchi- miques importantes (le De anima in arte alchimiæ du pseudo-Avicenne, le Livre des 70 de Jâbîr), mais aussi des textes d’esprit plus philosophique et plus poétique comme la Turba philosophorum et la Tabula chemica ; d’autre part, des traités en latin payant leur dette à l’alchimie arabe, la citant abon- damment, mais qui, en butte aux arguments opposés par les négateurs de l’alchimie 3, s’estimaient tenus d’élaborer à leur tour des théories savantes et puissamment argumentées. Il en est ainsi des travaux du pseudo-Geber et de ceux qui s’en inspirent comme le pseudo-Albert (Semita recta). Or, dès les premières décennies du XIVe siècle, la production des textes alchimiques aug- mente considérablement. Les deux plus importants corpus sont faussement attribués respectivement au philosophe et mystique Raymond Lulle († 1315) et au médecin Arnaud de Villeneuve († 1311). L’étude de ce dernier corpus constitue une véritable plongée dans un maquis de textes n’ayant parfois que peu de rapports entre eux. C’est leur histoire, compliquée, tortueuse que nous nous proposons de retracer dans les paragraphes qui suivent. Le nom d’Arnaud de Villeneuve apparaît en tant qu’auteur d’alchimica dès les premières décennies du XIVe siècle, peu de temps après sa mort. Durant tout ce siècle, des textes alchimiques, sans nom d’auteur connu, lui sont attribués. Tous ces textes sont des apocryphes. Rien en effet dans son œuvre authentique ne permet de légitimer un seul de ces écrits. Le médecin Arnaud de Villeneuve ne cite qu’à de très rares occasions l’alchimie, même médicale, et jamais de manière favorable. L’objet de cet article est de montrer comment ces textes qui ne sont pas des textes universitaires se transmettent et dans quelle mesure ils forment un ensemble que fédère le nom du légendaire Arnaud de Villeneuve. Dans un premier temps, nous tenterons d’en examiner la tradition manuscrite, puis de 3. Ibid., p. 1-47. ID., Promethean Ambitions, Alchemy and the Quest to Perfect Nature, Chicago, 2004, p. 34-114. LA TRADITION ALCHIMIQUE LATINE 41 présenter le corpus en l’analysant, enfin de suivre ses évolutions au Moyen A ˆ ge et à la Renaissance, en faisant notamment le point sur ses rapports avec le corpus pseudo-lullien. La tradition manuscrite Difficultés On tire de l’étude de ce corpus alchimique une première impression : l’extrême difficulté à le définir. En effet, il ne suffit pas de relever à l’aveugle les titres des alchimica attribués au maître catalan pour déterminer ensuite à partir d’une liste la nature du corpus ; il faut regarder dans le détail à quoi correspond chacun des intitulés. Il nous est apparu, par exemple, que, comme les titres donnés par les scribes varient d’une version à l’autre, un même texte pouvait circuler sous diffé- rentes formes. C’est ainsi que le Flos florum, l’une des principales œuvres du corpus, se décline sous sept formes différentes, soit plus longues, soit plus courtes que la forme la plus couramment citée, celle qu’édita le Genevois Manget en 1702 dans sa Bibliotheca chemica curiosa 4. Il est possible que ce texte, se présentant comme un courrier scientifique adressé à différentes personnalités, l’ait été sous ces différentes formes, recevant ensuite des appel- lations diverses : Semita semitæ, Flos florum, Errores alchimiæ, etc. L’étude comparée de bibliographies comme celle transmise par le manus- crit du Vatican, Barb. 273 (XVIe s.), celles de Nazari (1564) 5 et de Borel (1654) 6, révèle combien les bibliographes finissent par noter des incipits et des titres n’indiquant en fait que des états d’un même texte. De là une liste gonflée de titres et de références qui ne sont que des doublons. Par exemple, Barb. 273 signale par deux fois le De secretis naturæ, le Novum Testamen- tum, etc. Nazari le corrige (se limitant à 20 titres contre 24 dans le répertoire de Barb. 273), mais il continue de compter comme un ouvrage singulier chacun des chapitres d’une œuvre (Rosa Novella 1, Rosa Novella 2). Borel reprend Nazari et l’augmente de ses propres relevés. Aucun ne voit par exemple que le Flos florum et le Tractatus perfecti magistri sont le même texte. Depuis la Renaissance, les éditeurs des Opera omnia d’Arnaud, Thomas Murchi et Symphorien Champier, conscients du phénomène, estimèrent que si Arnaud de Villeneuve avait effectivement écrit des livres alchimiques, on 4. A. CALVET et S. MATTON, « Quelques versions du Flos florum du pseudo-Arnaud de Villeneuve », Chrysopœia, 6, 1997-1999, p. 207-271. 5. Voir sa liste de travaux pseudo-arnaldiens : G. B. NAZARI, Della trasmutatione metal- lica sogni tre, Brescia, 1599. 6. P. BOREL, Bibliotheca chimica seu catalogus librorum philosophorum hermeticorum, Heidelberg, 1656 (1re éd., Paris, 1654), repr. Hildesheim, 1969, p. 28-30. 42 A. CALVET lui avait trop généreusement attribué des titres 7. Un texte aussi essentiel que le Rosarius, un traité invariablement considéré comme une pièce maîtresse du corpus, aux yeux d’un Libavius, entre autres, uploads/Litterature/ calvet-antoine-la-tradition-alchimique-latine-xiiie-xve-siecles-et-le-corpus-alchimique-du-pseudo-arnaud-de-villeneuve 1 .pdf
Documents similaires






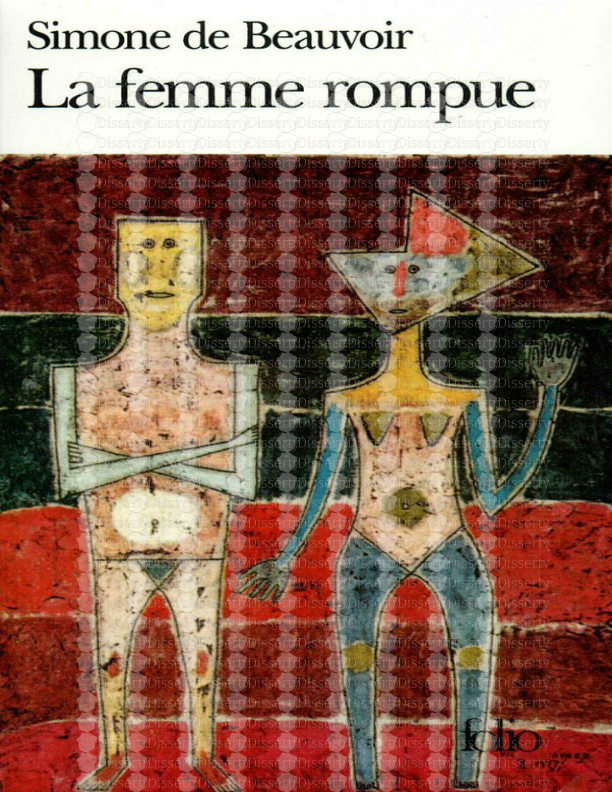



-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 09, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1690MB


