Angèle Kremer Marietti LA DÉMESURE CHEZ NIETZSCHE : HYBRIS OU SUBLIME ? (Une pr
Angèle Kremer Marietti LA DÉMESURE CHEZ NIETZSCHE : HYBRIS OU SUBLIME ? (Une première forme de cet article a paru dans la Revue Internationale de Philosophie Pénale et de Criminologie de l’Acte, N° 5-6 – 1994, pp. 69-84.) 1. L’opposition Apollon-Dionysos dans la Naissance de la tragédie Nous posons pour acquis dès le départ de la symbolique nietzschéenne le symbole de la démesure avec Dionysos et le symbole de la mesure avec Apollon. Rappelons qu'Apollon, le dieu de la justice, de l'ordre, de la beauté, de la musique et de tous les arts, le maître de la lyre, est aussi le maître des oracles, le dieu de Delphes où il a son sanctuaire. Ainsi que l'a établi la Naissance de la tragédie, première oeuvre publiée par Nietzsche - fin 1871, avec le millésime 1872 - l'antithèse mesure/démesure nous renvoie à l'antithèse Apollon/Dionysos. Cette opposition entre Apollon et Dionysos a d'abord été posée par Plutarque (46-120 ap. J.-C.) parfaitement connu de Nietzsche ; elle a été reprise par Michelet dans la Bible de l'humanité (1864). Cette opposition renvoie à l'opposition ordre/désordre, justice/hybris, en outre, à celle de la forme ou de la "belle apparence" et de la force, voire de l'informe ou du difforme. Nous pouvons retrouver également en elle l'antithèse du beau et du sublime, telle que Kant (1) l'avait déjà reconnue, ou celle entre nature et culture, chère à Rousseau. Nous pouvons y reconnaître également l'opposition entre la loi et la violence. En termes de métaphore, Dionysos est le torrent endigué par Apollon, "sublime" étant la maîtrise artistique de l'horrible (selon la section 7 de la Naissance de la tragédie ). Au moment où il écrit la Naissance de la tragédie, Nietzsche a l'intention d'être un philologue de qualité, doublé, il est vrai, d'un philosophe qui réfléchit sur les faits de civilisation. Année par année, il le prouve par ses cours à l'université de Bâle. Avec le bref intermède de la guerre de 70, à laquelle - et bien qu'il se soit désormais déclaré comme apatride - il prend part du 11 août au 2 septembre, date de son hospitalisation pour dysenterie et diphtérie, Nietzsche s'est, depuis le 19 avril 1869, consacré, à ses cours sur l'histoire des philosophies préplatoniciennes et sur Hésiode. Sa leçon inaugurale à l’université eut lieu le 28 mai : elle portait sur Homère. Le 18 janvier 1870, il fit une conférence sur le Drame musical grec ; il a aussi, dans l'hiver 1870, traité de la métrique et de la rythmique grecques et probablement de Prométhée d'Eschyle et d'Oedipe roi de Sophocle. Dans le semestre d'été 1871, il introduisit ses étudiants à l'étude de la philologie classique et, le semestre suivant, à la philosophie de Platon. Nietzsche écrivit encore des textes préparatoires à l'oeuvre de la Naissance de la tragédie ; outre les deux conférences citées, il produisit à la même époque deux textes : la Conception dionysiaque du monde et la Tragédie et les esprits libres. Le cours de 1870 sur l'Oedipe-roi de Sophocle ouvrait aux problèmes philologiques et esthétiques. Socrate et la tragédie (1871) est déjà un écrit destiné à faire partie intégrante de la Naissance de la tragédie. La rédaction d'autres textes, comme l'Etat grec et Origine et but de la tragédie contribueront à alimenter le fond de l'oeuvre de 1872. 2. Le principe dionysiaque Avec la mise au jour du principe dionysiaque, Nietzsche a fait une double découverte : d'une part, il a rectifié et élargi la conception qu'on se faisait des Grecs à son époque ; entre autres, celle de Winckelmann (1717-1768) qui avait canonisé l'art grec. En effet, on voyait les Grecs empreints d'une sérénité purement apollinienne, et Nietzsche les montre, au contraire, cachant sous cette sérénité un véritable abîme dionysiaque. Dionysos est donc, après Apollon, la seconde dimension des Grecs anciens : à côté de la mesure apollinienne, il signifie ni plus ni moins que la démesure grecque. Mais il est clair que Dionysos ne concerne pas seulement les Grecs ; avec cette entité il s'agit en fait d'une vérité universelle : la démesure humaine (2). Et telle est la seconde découverte de Nietzsche. Ainsi, Nietzsche découvre en même temps une double vérité radicale, concernant les Grecs en particulier et l'humanité en général, et qui n'est autre que la démesure. A cette démesure il rattachera la volonté de puissance qui constitue l'objet de ce qu'il désigne dans Par delà le bien et le mal comme étant une "psychologie des profondeurs". L'idée du contraste apollinien/dionysien est d'abord immédiatement posée sur un plan esthétique : la tragédie attique, selon Nietzsche, l'un des accomplissements de l'art dorien, fait la synthèse de ces deux notions antithétiques et complémentaires, puisque la tragédie "naît" de l'opposition des entités que représentent les termes d' Apollon et de Dionysos. Nietzsche pense aussi ce contraste comme "métaphysique", mais dans un sens qui lui est propre (alors qu'il critique par ailleurs le concept de métaphysique) : ce contraste est "métaphysique" parce qu'il éclaire le rapport secret de choses qui n'avaient jamais été mises en confrontation : par exemple, l'opéra et la révolution. Dans la Préface de la Naissance de la tragédie, dédiée à Richard Wagner, Nietzsche affirme l'art comme étant "la tâche la plus haute et l'activité essentiellement métaphysique de cette vie". C'est là une formule qu'il partageait, à l’époque, avec Wagner lorsque ce dernier séjournait à Tribschen avec Cosima. Un fragment de 1888 permet de mieux comprendre ce que Nietzsche veut dire, c'est ainsi qu'il précise le "dionysiaque" dans toute l'ampleur de sa complexité : "Le mot 'dionysiaque' exprime un besoin d'unité, un dépassement de la personne, de la banalité quotidienne, de la société, de la réalité, franchissant l'abîme de l'éphémère; l'épanchement d'une âme passionnée et douloureusement débordante en des états de conscience plus indistincts, plus pleins et plus légers; un acquiescement extasié à la propriété générale qu'a la Vie d'être la même sous tous les changements, également puissante, également énivrante; la grande sympathie panthéiste de joie et de souffrance, qui approuve et sanctifie jusqu'aux caractères les plus redoutables et les plus déconcertants de la Vie: l'éternelle volonté de génération, de fécondation, de Retour: le sentiment d'unité embrassant la nécessité de la création et celle de la destruction" (traduction Quinot). Autrement dit, "dionysiaque" concerne le processus universel apparu comme le châtiment de l'hybris, dans la référence de Nietzsche à la philosophie héraclitéenne. Dans la Naissance de la tragédie, il est question, en effet, de l'Un-primordial, une notion qui concerne le chaos antérieur à tout cosmos, avant même que n'opérât le principe d'individuation, une réalité et une notion qui se trouvent déjà chez Schopenhauer dans le Monde comme volonté et comme représentation : elle apparaît au livre II, section 23, dans laquelle Schopenhauer affirme que la pluralité en fait partie, conditionnée qu’elle est dans l'espace et dans le temps. Au livre III, section 43, de l’œuvre de Schopenhauer, le principium individuationis est présenté comme l'équivalent du principe de raison suffisante ; à la section 51 du même livre, il est la forme du phénomène. Pour Nietzsche, qui commence par utiliser ce principe dans une citation empruntée à Schopenhauer (extraite du livre IV, section 63 du Monde comme volonté et comme représentation), cette expression est rapportée à Apollon qui, pour Nietzsche, représente l'image divine et splendide du principe d'individuation selon l'aptitude d'Apollon à délimiter les contours des êtres, tandis que Dionysos au contraire les confond. En 1888, Nietzsche estime que sa perception et aussi son interprétation du phénomène dionysiaque constituent la première nouveauté de la Naissance de la tragédie. Et il n'a pas tort. L'autre nouveauté étant, d'après lui, son interprétation du socratisme, à partir d'un Socrate vu comme "le décadent typique". La voie nouvelle qui s'ouvre ainsi est celle de la vérité radicale, et c'est aussi celle de la grande transvaluation éthique, esthétique et épistémologique, dont Nietzsche fait la promesse. Cette grande transvaluation devait réaliser sa systématisation dans le grand livre de la Volonté de puissance qui, comme on sait, ne vit pas le jour. En 1886, Nietzsche a prévu l'un des nombreux plans pour cette œuvre ; il est ainsi formulé: "La volonté de puissance.Essai de transmutation de toutes les valeurs (en quatre livres). Livre premier : Le danger des dangers. (Représentation du nihilisme comme conséquence nécessaire des jugements de valeur actuels). Des puissances prodigieuses sont déchaînées, mais elles se contredisent: se détruisant mutuellement). Dans la collectivité démocratique, où chacun est spécialiste, le but fait défaut: cette classe est le sens du multiple dépérissement des individus en autant de fonctions. Livre second : Critique des valeurs (de la logique, etc.). Montrer partout la dysharmonie entre l'idéal et ses conditions (par exemple la sincérité chez les chrétiens qui sont constamment contraints à mentir). Livre troisième : Le problème du législateur (là, l'histoire de la solitude). Lier à nouveau les puissances déchaînées, afin qu'elles ne se détruisent plus réciproquement. Ouvrir les yeux pour la réelle augmentation de la puissance ! Livre quatrième : Le marteau. Comment les hommes, qui évaluent à l'inverse, doivent-ils être constitués ? Des hommes uploads/Litterature/ kremer-marietti-la-de-mesure-chez-nietzsche 1 .pdf
Documents similaires

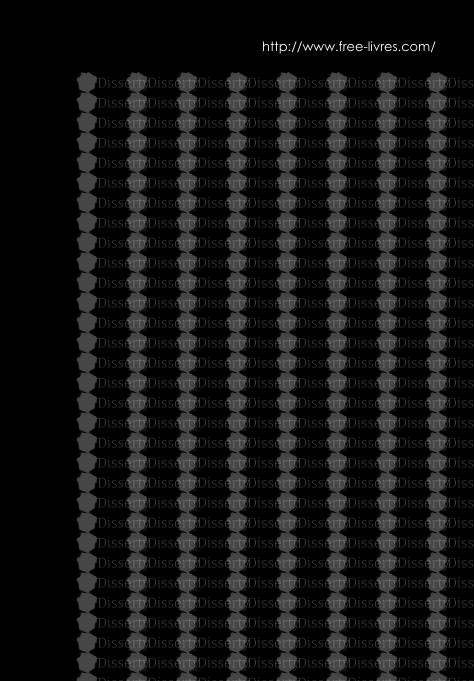








-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 10, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1715MB


