Document généré le 12 déc. 2018 11:28 Québec français La lecture subjective Gér
Document généré le 12 déc. 2018 11:28 Québec français La lecture subjective Gérard Langlade La littérature québécoise de 1970 à nos jours Numéro 145, printemps 2007 URI : id.erudit.org/iderudit/47315ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les Publications Québec français ISSN 0316-2052 (imprimé) 1923-5119 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Langlade, G. (2007). La lecture subjective. Québec français, (145), 71–73. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. [https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique- dutilisation/] Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org Tous droits réservés © Les Publications Québec français, 2007 Intégrer les compétences en français au secondaire DIDACTIQUE La lecture subjective par Gérard Langlade* 1 * . 1 E n plaçant au premier plan l'activité du sujet lecteur (pour tous les mots en italiques, voir glossaire p. 72), les recherches sur la lecture littéraire invitent à repenser la nature des exercices traditionnels pratiqués en classe de français et à redéfinir leur rôle dans la formation des lecteurs. Cette ambition de susciter, de fixer et d'exploiter les expériences de lecture subjective des élè- ves - qui constitue une des voies d'accès à la compétence « réagir et apprécier des œuvres littéraires » - conduit à un changement sen- sible de paradigme didactique. La lecture subjective, une définition Par « lecture subjective », nous entendons la façon dont un texte littéraire affecte - émotions, sentiments, jugements - un lec- teur empirique. Ce dernier s'attache plus aux retentissements individuels que suscite une œuvre sur lui-même qu'à la description ana- lytique des catégories textuelles, génériques et stylistiques de celle-ci. La lecture subjective concerne en effet le processus interaction- nel, la relation dynamique à travers lesquels le lecteur réagit, répond et réplique aux sol- licitations d'une œuvre en puisant dans sa personnalité profonde, sa culture intime, son imaginaire. Le contenu fictionnel des œuvres est tou- jours investi, transformé, singularisé par T« activité fictionnalisante » des lecteurs : images produites en « complément » de l'œuvre (concrétisation imageante), liens de causalité établis entre les événements ou les actions des personnages (cohérence mimé- tique), scénarios fantasmatiques activés par le texte (activité fantasmatique), jugements portés sur l'action et la motivation des per- sonnages (réaction axiologique). Ce dialogue interfictionnel entre la fiction textualisée par l'œuvre et la textualisation des apports fic- tionnels de la subjectivité du lecteur produit le « texte singulier du lecteur », « ce trajet de lecture tissé de la combinaison fluctuante de la chaîne d'une vie avec la trame des énon- cés qui seul mériterait d'être appelé texte1 ». L'élaboration et l'exploitation de ce « texte du lecteur » sont au centre d'une interven- tion didactique qui entend développer la compétence esthétique des élèves, c'est-à- dire l'aptitude à réagir face à une œuvre et à en apprécier les effets. Sens et portée de l'intervention didactique Premier objectif : rendre possible et stimu- ler l'activité de lecture des élèves en propo- sant des œuvres qui suscitent des réactions personnelles - émotionnelles, affectives, cognitives - et des lectures plurielles. Mieux vaut privilégier les œuvres qui s'attachent à dçs enjeux humains - éthiques, fantasmati- ques, etc. - que celles qui jouent sur les codes littéraires (textes à énigme, à « pièges ») ou sur les références intertextuelles. Deuxième objectif : concevoir un accom- pagnement didactique de l'engagement du sujet lecteur dans l'œuvre. Il ne suffit pas de donner à lire un texte fort aux élèves pour faire émerger de riches expériences de lecture. Pour autant, le questionnement ne prend pas appui sur le texte considéré pour lui-même mais sur la lecture subjec- tive réalisée par l'enseignant. Ce qui fonde l'expertise de ce dernier n'est pas tant, alors, sa connaissance de la littérature, de son his- toire, de ses codes, de ses rituels que son aptitude à réfléchir à sa lecture, à en cerner la singularité, à en mesurer les enjeux per- sonnels. Conscient de sa propre expérience de lecture, l'enseignant peut concevoir un questionnement qui, tout en prenant appui sur une lecture singulière, s'ouvre, par la mobilisation d'autres imaginaires indivi- duels, à la diversité des singularisations possibles. Il suffit par ailleurs d'un léger déplacement du questionnement concernant les person- nages pour passer d'une description analy- tique de l'œuvre à la prise en compte d'une implication dans l'œuvre. Au lieu de deman- der « quel est le personnage principal ? » ou « quelle est la fonction des personnages dans le schéma actantiel ? », on interroge les élèves sur les personnages qui les touchent, qu'ils aiment, qu'ils détestent, etc., sur le jugement moral qu'ils portent sur leurs actions ou encore sur l'attitude qu'ils auraient adoptée s'ils avaient été à leur place. Cette stratégie d'implication s'avère d'une grande fécondité, car elle renvoie les œuvres à la complexité de leurs imaginaires et à la profondeur de leurs interrogations axiologiques et méta- physiques. PRINTEMPS 2007 | Québecfrançais 145 I 71 Des activités orales et écrites à refonder Les exercices canoniques qui privilégient l'analyse textuelle et la distance reflexive immédiate dans l'approche des œuvres lit- téraires, comme la lecture analytique ou le commentaire littéraire, semblent peu adap- tées pour prendre en compte les réalisations lectorales singulières des élèves. En lecture analytique, le repérage des éléments textuels est commandé par une méthodologie qui s'impose de l'extérieur au lecteur - identification discursive, marques génériques, ancrage esthétique, etc. -, alors qu'en lecture subjective, les aspérités du texte qui accrochent son attention proviennent de la relation originale qui se crée entre lui et l'œuvre. « Le travail de sélection s'exerce sur des unités textuelles, que le lecteur investit particulièrement par la pensée et la rêverie2 ». Mais comment gérer, en classe, la diversité des lectures subjectives ? Comment avoir recours à la subjectivité des lecteurs sans être confronté aux « débordements » sub- jectifs des élèves ? Sans doute est-il malaisé, pour un professeur, formé dans un tout autre contexte, d'accepter des lectures qui peuvent lui apparaître comme de véritables transgres- sions. Cependant, il faut admettre que tout lecteur actif est de fait un lecteur transgres- sif qui s'écarte volontiers du jeu de rôle écrit pour lui et qui, loin de toujours respecter les règles prescrites, se livre volontiers au « bra- connage » fictionnel, au détournement d'ob- jets de fiction. De nouveaux types de productions orales et écrites, mais aussi gestuelles, iconiques, voire musicales, voient le jour dans les clas- ses qui mettent en pratique une approche subjective des œuvres. Des activités comme les journaux de lecture et les autobiographies de lecteurs sont théorisées par des chercheu- res comme Manon Hébert ou Annie Rouxel. Ces activités permettent de fixer dans le cours d'une lecture ce qui fait événement, c'est-à- dire ce qui naît de la rencontre plus ou moins imprévisible entre les propositions fiction- nelles d'une œuvre et l'implication subjective d'un lecteur empirique. « Pour qu'un livre nous touche, il faut sans doute qu'il établisse entre notre expérience et celle de la fiction - entre deux imaginations, la nôtre et celle qui se déploie sur la page - un lien fait de coïnci- dences3 ». Mimer les réactions d'un person- nage, dessiner les « images » produites par une lecture4, exprimer ses affects (joie, tris- tesse, colère, peur, etc.) en les associant à des pièces musicales ou à des sonorités, autant de moyens de permettre aux lecteurs, particuliè- rement aux plus jeunes, de rendre compte de façon créative d'une expérience de lecture. Il ne faut pas se cacher que la nature même de ces productions rend leur exploi- tation didactique difficile. En enregistrant les réactions du lecteur interpellé par tel ou tel élément, le journal de lecture produit une fragmentation des œuvres lues. « Lecteur, je suis négligemment une intrigue combinée avec soin, en me laissant distraire par des détails et des pensées fortuites5 ». À cela s'ajoute le caractère allusif des remarques, pareilles à des notes rapides prises dans un carnet. Il est ainsi difficile de passer de ces traces qui gardent témoignage de l'activité du lecteur à une perspective analytique et reflexive. Qui plus est, il y a bien souvent des ruptures, des disjonctions, entre les affects du lecteur issus pour une large part de l'his- toire du sujet lecteur et les effets textuels qui relèvent de la poétique. Dans ce qu'elle a d'essentiel et d'intime, dans ce qui affecte en profondeur ou engage l'identité, l'expé- rience d'une lecture se dérobe pour partie à la conscience du sujet. Cependant, ces difficultés à objectiver le produit d'une lecture ne préjugent en rien de sa valeur formative et éducative. L'émer- gence des affects, même confuse, permet au lecteur d'inscrire ceux-ci dans des imaginai- res collectifs et d'« apprivoiser ses peurs, de construire et de réparer son monde intérieur, de trouver des réponses aux questions qui les hantent, d'apprendre ce que d'autres uploads/Litterature/ langlade-lecture-subjective.pdf
Documents similaires








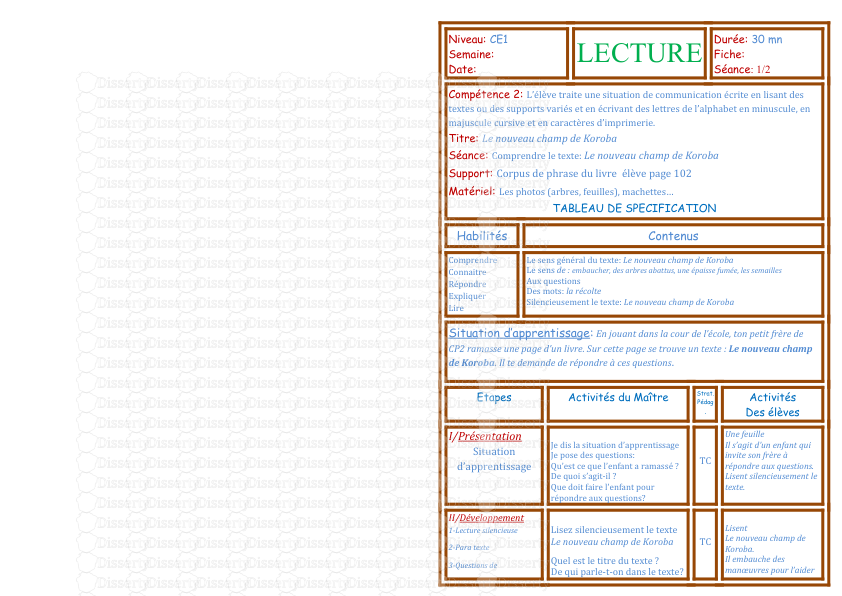

-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 25, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6966MB


