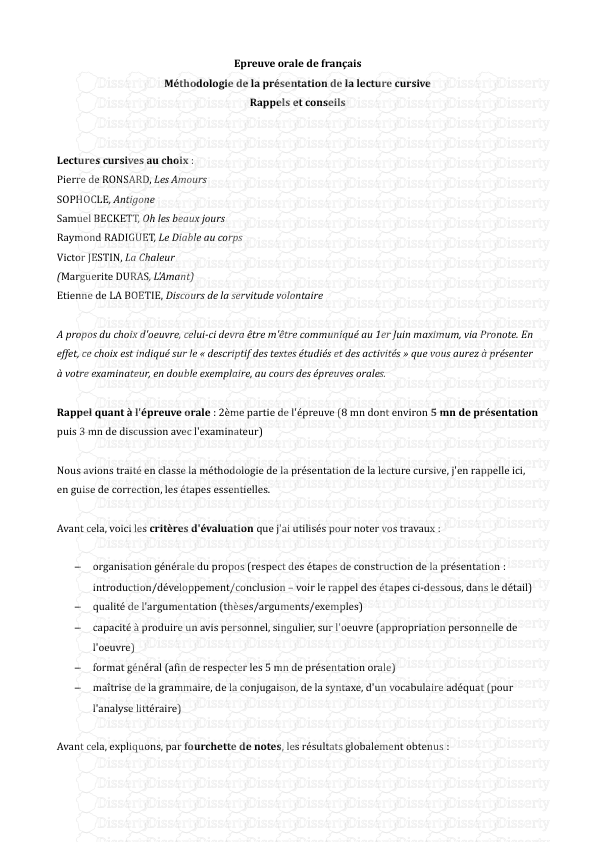Epreuve orale de français Méthodologie de la présentation de la lecture cursive
Epreuve orale de français Méthodologie de la présentation de la lecture cursive Rappels et conseils Lectures cursives au choix : Pierre de RONSARD, Les Amours SOPHOCLE, Antigone Samuel BECKETT, Oh les beaux jours Raymond RADIGUET, Le Diable au corps Victor JESTIN, La Chaleur (Marguerite DURAS, L'Amant) Etienne de LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire A propos du choix d'oeuvre, celui-ci devra être m'être communiqué au 1er Juin maximum, via Pronote. En effet, ce choix est indiqué sur le « descriptif des textes étudiés et des activités » que vous aurez à présenter à votre examinateur, en double exemplaire, au cours des épreuves orales. Rappel quant à l'épreuve orale : 2ème partie de l'épreuve (8 mn dont environ 5 mn de présentation puis 3 mn de discussion avec l'examinateur) Nous avions traité en classe la méthodologie de la présentation de la lecture cursive, j'en rappelle ici, en guise de correction, les étapes essentielles. Avant cela, voici les critères d'évaluation que j'ai utilisés pour noter vos travaux : – organisation générale du propos (respect des étapes de construction de la présentation : introduction/développement/conclusion – voir le rappel des étapes ci-dessous, dans le détail) – qualité de l'argumentation (thèses/arguments/exemples) – capacité à produire un avis personnel, singulier, sur l'oeuvre (appropriation personnelle de l'oeuvre) – format général (afin de respecter les 5 mn de présentation orale) – maîtrise de la grammaire, de la conjugaison, de la syntaxe, d'un vocabulaire adéquat (pour l'analyse littéraire) Avant cela, expliquons, par fourchette de notes, les résultats globalement obtenus : – « devoir non rendu » : risqué, risqué de ne pas s'entraîner à la présentation de la lecture cursive sachant que, même si les notes obtenues au cours de la période de confinement n'entrent pas en tant que telles en ligne de compte concernant l'évaluation globale de votre année, les épreuves orales sont a priori maintenues, donc... – « devoir non noté » : les consignes de travail n'ont pas été respectées : ex : choix de l'oeuvre (La Princesse de Clèves est une œuvre intégrale, et non une lecture cursive dans le cadre du programme de français de Première... Donc vous ne pouvez pas présenter cette œuvre dans le cadre de la deuxième partie de l'épreuve orale...) – notes en dessous de 10 : propos trop court, trop bref, ne permettant pas de réaliser une présentation de 5 mn, et/ou superficialité du propos tenu (trop simple, trop peu étayé) – 10-12 : contenu globalement correct, l'histoire est comprise mais le sujet est insuffisamment problématisé, la présentation ressemble plutôt à un résumé de texte qu'à une véritable analyse de sa visée et de sa portée – 13-14 : contenu satisfaisant, tentative de problématisation intéressante et pertinente. Quelques éléments auraient mérité développement ou précision supplémentaire – 15 et plus : pertinence du propos, singularité du regard porté sur le texte, on est contents. Rappels méthodologiques : Organisation de la présentation : 1. Introduction : – brève présentation de l'auteur, du mouvement littéraire auquel appartient éventuellement l'ouvrage (ex : Classicisme, s'agissant de l'oeuvre de MOLIERE), de la période à laquelle l'ouvrage a été écrit, résumé de l'intrigue – problématique générale de l'oeuvre sous forme de question (genre/visée/portée) – annonce du plan d'étude 2. Développement : A. Visée et portée de l'oeuvre Ici, il est particulièrement important de maîtriser le vocabulaire de l'analyse littéraire. Bien qu'il ne s'agisse pas en tant que tel d'un commentaire de texte ou d'une dissertation, un vocabulaire spécifique à l'analyse est requis, et attendu par l'examinateur. Rappel : dans la « visée », on peut faire référence au genre, au style propre à l'auteur, à sa façon d'écrire donc et de transmettre des idées, un message, sa capacité à créer une atmosphère particulière. Ici, c'est la question de la singularité de l'auteur qui prime (originalité dans le style, originalité dans le propos...). On peut ici faire référence à d'autres auteurs, en guise de « comparaison » (ex : CAMUS pour Victor JESTIN). Quant à la portée, il s'agit de parler des dimensions intemporelles et universelles de l'oeuvre, choses qui permettent d'introduire d'ailleurs la deuxième partie de votre développement : votre appropriation de l'oeuvre, soit la façon particulière dont vous vous êtes saisis de l'oeuvre (en quoi l'oeuvre résonne-t-elle en vous?). Pour rappel, on entend par « dimensions intemporelles et universelles » ce qui, dans l'oeuvre, permet d'expliquer sa réception, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. B. Appropriation personnelle de l'oeuvre De nombreux biais sont possibles pour ce faire : ex : rencontre avec Victor JESTIN, projets pédagogiques en lien avec la lecture de l'oeuvre... Autrement dit, il s'agit ici de dire ce en quoi l'oeuvre vous a « parlé ». Cette dimension de votre étude est proche de la question des dimensions universelles et intemporelles déjà traitées. Mais ici, vous êtes censé parler de vous, en tout cas, de la réception que vous avez faite de l'ouvrage : le lyrisme affleure, il s'agit de le manier avec subtilité et mesure, mais il affleure. Je ne saurais me substituer à vos impressions de lecture, aussi je ne saurai corriger cette partie de votre étude. En tout cas, il s'agit de singulariser votre propos, de faire entendre votre voix. 3. Conclusion : – réponse à la problématique générale de l'ouvrage et reprise des éléments traités dans le développement – ouverture : autres auteurs en lien et/ou autres questions en lien avec l'ouvrage étudié uploads/Litterature/ methodologie-presentation-lecture-cursive-oral-de-francais.pdf
Documents similaires










-
157
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 09, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0619MB