143 Mémoire de fille d’Annie Ernaux : une nouvelle grammaire de l’être Delphine
143 Mémoire de fille d’Annie Ernaux : une nouvelle grammaire de l’être Delphine Gachet1 In 2016 Annie Ernaux published Mémoire de fille [Girlhood Memory], by which she extended and appar- ently concluded her biographical itinerary initiated by Place (1983) and to which The Years (2008) gave a new twist. In this last novel, Ernaux provides a missing piece in the puzzle of her life, the trauma of a summer's night in 1958. This paper is an investigation of this final autobiographical statement, demonstrat- ing how the strands of the individual story are interwoven with those of the first and third person narrative, of the ‘I’ and the ‘she’. Also, we shall ascertain how, resorting simultaneously to the words of others, hence the use of other pronouns, can broaden the horizons of an individual biography and serve as testimony to a period, that of the late 1950s in France. Not A Girl’s Memory, but Girlhood Memory. En 2016 Annie Ernaux publie Mémoire de fille, prolongeant et, semble-t-il, parachevant le parcours auto- biographique initié avec La Place (1983) et auquel Les Années (2008) avait donné un tour nouveau. Dans ce dernier roman, Ernaux donne la pièce manquante du puzzle de sa vie : le traumatisme d’une nuit de l’été 1958, qu’elle n’a pas réussi à évoquer jusqu’ici. Cette communication s’interrogera donc sur ce dernier geste autobiographique montrant comment l’histoire individuelle se tisse des fils entremêlés de la narration à la première et à la troisième personne, du ‘je’ et du ‘elle’. Nous nous demanderons aussi comment, simultanément, le recours à la parole des autres – et, par- tant, l’utilisation des autres pronoms – peut élargir les frontières de l’autobiographie singulière au témoi- gnage d'une époque, la fin des années 1950 en France. Non pas Mémoire d’une fille mais bien Mémoire de fille. 1. Une autre pièce au puzzle autobiographique En 2016 Annie Ernaux publie Mémoire de fille2, prolongeant et, semble-t-il, parachevant le parcours autobiographique initié avec La Place (1983) et auquel Les Années (2008) avait donné 1 Maître de conférences, Université Bordeaux – Montaigne. 2 Annie ERNAUX, Mémoire de fille, Paris, Gallimard, 2016. Mne mos y ne , o l a c os truz ion e d el s ens o n° 1 1 144 un tour nouveau. Dans ce dernier roman, elle donne la pièce manquante du puzzle de sa vie : le traumatisme d’une nuit de l’été 1958, qu’elle n’a pas réussi à évoquer jusqu’ici. Cette communication s’interrogera donc sur ce dernier geste autobiographique montrant com- ment l’histoire individuelle se tisse des fils entremêlés de la narration à la première et à la troi- sième personne, du ‘je’ et du ‘elle’, mais s’empare aussi de la voix des ‘autres’. 2. L’invention de l’« auto-socio biographie » Annie Ernaux est l’une des voix majeures de la littérature contemporaine en France. Son œuvre, commencée au début des années 70, s’est étoffée au fil des années et compte actuelle- ment dix-sept titres entre romans, textes autobiographiques et journaux. En investissant le genre littéraire de l'autobiographie, Ernaux l’a renouvelé au point de forger pour désigner son œuvre le néologisme d’« auto-socio-biographie »3. Ses trois premières œuvres pourtant relevaient de la fiction. Si, dans Les Armoires vides (1974), Ce qu’ils disent ou rien (1977), La Femme gelée (1981), les personnages mis en scène rappellent par bien des traits la figure de l’auteur ou de certains de ses proches, la dimension fic- tionnelle était revendiquée par l’inscription dans le genre romanesque. Cette volontaire mise à distance de soi-même par la création d’un personnage romanesque peut, rétrospectivement, être perçue comme une première étape, nécessaire mais forcément provisoire, dans le cheminement qui conduira l’écrivaine à trouver sa voie/voix. Sans doute, au moment de se lancer dans l’écriture, l’adoption de la forme romanesque s’est-elle faite de façon spontanée, le roman s’imposant à l’écrivaine débutante comme le genre littéraire le plus massivement représenté dans la littérature, celui avec lequel ses lectures l’avaient le plus familiarisée. Mais sans doute aussi le concevait-elle déjà comme un moyen pour parler d’elle-même, un moyen détourné pour dire ce qui, jusque-là, était du registre de l’indicible. Car, dès son tout premier roman, c’est dans la sphère de l’intime le plus douloureux, mais aussi le plus « honteux » qu’Ernaux s’aventure : créer Denise Lesure, protagoniste principale des Armoires vides, lui permet de raconter, en fai- sant parler son personnage à la première personne, l’un des événements les plus traumatiques de 3 Terme forgé pour qualifier son livre La Place (1983). À ce sujet, voir Fabrice THUMEREL, « Littérature et so- ciologie : La Honte ou comment réformer l’autobiographie », dans Id., Le Champ littéraire français au XXe siècle : éléments pour une sociologie de la littérature, Paris, Armand Colin, 2002, « U », pp. 83-101. Del ph ine G ac he t : Mé mo ire de fi l le d’ An ni e Erna ux : une no uv el le gra mma ire de l ’ê tre 145 sa propre vie : son avortement : « Ma mère a appris mon avortement en lisant Les Armoires vides ; j’ai bien fait d’indiquer ‘roman’, sinon ç’aurait été très violent pour elle »4. Lorsqu’elle entreprend de consacrer un livre à la figure de son père disparu, Annie Ernaux se rend compte que la fiction romanesque s’avère insuffisante, inadéquate à son projet. Elle aban- donne donc la fiction pour s’engager résolument dans l’écriture (auto)biographique : depuis lors, son œuvre est composée d’une série de textes autobiographiques. Elle s’en explique ainsi : Je me suis lancée avec le « je » et je me suis aperçue que je ne pouvais plus revenir en arrière, que le « je » me convenait. […] Avec La Place, s’accomplit le saut vers un « je » pleinement assumé, à cause de l’impossibilité pour moi de parler de mon père sans que ce soit un récit vrai. Seule la vérité était digne de la vie de mon père, de cette séparation entre lui et moi : le roman aurait été une trahison supplémentaire5. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d’une vie soumise à la nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire quelque chose de « passionnant », ou d’« émouvant »6. La place (1983), première œuvre de cette nouvelle orientation littéraire, rencontrera un très fort succès auprès du public comme de la critique, et sera couronnée par le prix Renaudot. Ce texte est considéré aujourd’hui non seulement comme un ouvrage clef dans la production d’Annie Ernaux mais également comme une des œuvres majeures du genre autobiographique de la fin du siècle dernier. Les nombreux textes qui suivront s’attacheront à exploiter le matériau autobiographique selon la même perspective et à travailler l’écriture pour qu’elle soit la plus « plate », la plus neutre possible, faisant également de ce style qui veut écarter tout esthétisme, toute sophistication la marque de l’œuvre ernausien dans sa globalité. Récemment, Les Années, texte paru en 2008, marque non pas un tournant mais un fléchisse- ment dans la trajectoire de l’œuvre. C’est en effet la dimension sociographique qui semble y primer sur la dimension autobiographique : le projet est de restituer ces « années », années qui sont celles dans lesquelles s’inscrit la vie de l’auteur mais qui sont aussi, complètement ou pour 4 A. ERNAUX, entretien publié dans le Magazine littéraire, n° 567, mai 2016. 5 A. ERNAUX, « Écrire, écrire, pourquoi ? », Entretien avec Raphaëlle Rérolle, Éditions de la Bibliothèque pu- blique d’information / Centre Pompidou, 2010, p. 3. 6 A. ERNAUX, La Place, Paris, Gallimard, 2010, p. 18. Mne mos y ne , o l a c os truz ion e d el s ens o n° 1 1 146 partie, celles de ses lecteurs. C’est donc une fresque de la société française des années 50 jusqu’à nos jours qu’Ernaux ambitionne ici de dessiner. On remarquera donc que le ‘je’, où, par le pacte autobiographique tel que l’a défini Philippe Lejeune7, se rejoignent auteur, narrateur et person- nage, est beaucoup moins présent dans cet ouvrage. Annie Ernaux a dit avoir justement voulu éviter ce pronom personnel de la première personne au profit d’un ‘nous’ ou d’un ‘on’ qui, tout en incluant le ‘je’, le déborde pour englober l'ensemble de la Société française de cette époque : « Aucun ‘je’ dans ce qu’elle voit comme une sorte d’autobiographie impersonnelle – mais ‘on’ et ‘nous’ – comme si, à son tour, elle faisait le récit des jours d’avant »8. Les Années, en ce sens, pouvait se donner à lire comme un point d'orgue du cheminement de l’auteur, culminant dans cette forme nouvelle d’une autobiographie où paradoxalement le ‘je’ s’efface, où l’individuel se dilue dans le collectif. Il est selon l’aveu même de son auteure un « roman total » : le livre qu’elle devait écrire avant de clore son œuvre. Mais il n’en est pas pour autant le dernier ; bien au contraire, l’écriture des Années a fait ressurgir uploads/Litterature/ mhgregoire-96691mnemosyne11-143-156-gachet.pdf
Documents similaires








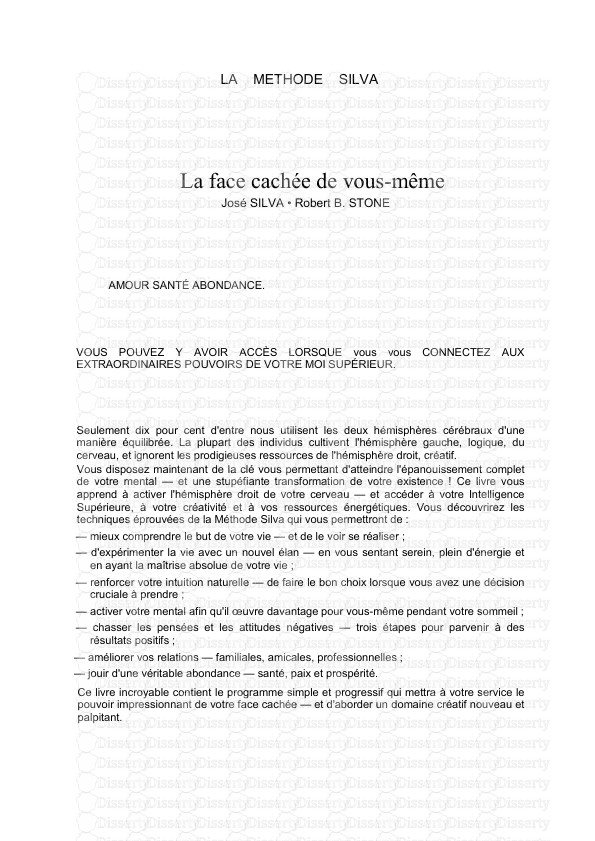

-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2350MB


