LES PAYS LOINTAINS DE LA LECTURE Michèle Petit Presses Universitaires de France
LES PAYS LOINTAINS DE LA LECTURE Michèle Petit Presses Universitaires de France | « Ethnologie française » 2004/4 Vol. 34 | pages 609 à 615 ISSN 0046-2616 ISBN 9782130541769 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2004-4-page-609.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France. © Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 05/01/2021 sur www.cairn.info (IP: 190.244.143.58) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 05/01/2021 sur www.cairn.info (IP: 190.244.143.58) Les pays lointains de la lecture Michèle Petit CNRS – LADYSS RÉSUMÉ C’est à un éloge du lointain que pourrait conduire l’attention portée aux pratiques de lectures dans des lieux où lire ne va pas de soi. En effet, c’est par le biais de l’ouverture sur un ailleurs, un autre espace que celui du quotidien, que lecteurs et lectrices peuvent, de façon toute personnelle, enrichir tel ou tel registre de leur imaginaire. Cette problématique n’est pas sans contradiction avec l’engouement de géographes pour le local et leur valorisation du proche. Mots-clefs : Lecture. Lointain. Individualisation. Exclusion. Ségrégation spatiale. Michèle Petit CNRS – LADYSS 191, rue Saint-Jacques 75005 Paris petitmic@univ-paris1.fr « Votre bonheur est dans l’espace et dans l’agitation », disait Mme de Lambert 1. Mon bonheur doit être dans l’espace, qui m’a poussée à demeurer en la compagnie de géographes, quand le mouvement de mes travaux me portait très loin de leurs thématiques, apparemment du moins. Depuis douze ans, je travaille en effet sur la lecture et le rapport aux livres, et les déplacements de tous ordres, réels ou symboliques, qui leur sont liés. Pour la plupart, ces recherches portent sur des lieux où la distance sociale et culturelle aux livres et aux supports écrits de l’information est redoublée d’un éloignement géographique – qu’il s’agisse, en France, de régions rura- les ou de quartiers populaires situés en périphérie urbaine, ou, en Amérique latine, d’espaces en crise. Je m’y suis lancée dans le sillage de Michel de Cer- teau 2, qui voyait dans la lecture une pérégrination dans un système imposé ou encore un « art du braconnage », et insistait sur l’activité des lecteurs qui s’approprient ou détournent les textes lus : « C’était l’idée-force des Lumières que le livre est l’éducateur privilégié du peuple. Le lecteur passait pour l’effet du livre. Aujourd’hui il se détache de ces livres dont on supposait qu’il était seulement l’ombre portée. Voici que l’ombre se délie, prend son relief, acquiert une indé- pendance » [1982 : 66-67]. C’est donc du côté des lec- teurs que je me suis située, en tentant d’approcher leurs manières singulières de lire, de s’approprier, de se repré- senter des textes écrits, et les recompositions qui peu- vent en découler. Ce qui appelait une méthodologie : l’analyse de l’expérience singulière de ces lecteurs, telle qu’ils la restituent lors d’un entretien oral, aussi ouvert et libre que possible ; ou telle qu’ils la transposent dans un texte écrit – pouvant aller de l’autobiographie à l’autofiction. Il n’est guère d’autre biais pour tenter d’approcher en particulier ces pensées que les lectures font venir, ces sensations éprouvées, ces liens noués par chacun, à l’insu des institutions : aucun élément objec- tivable n’est là d’un grand secours. Avec des collègues, j’ai notamment réalisé et analysé une cinquantaine d’entretiens approfondis en milieu rural [Ladefroux, Petit, 1993], puis quatre-vingt-dix entretiens dans des quartiers populaires, avec des ado- lescents et des jeunes adultes, âgés de quinze à une trentaine d’années, qui avaient fréquenté une bibliothè- que municipale [Petit, Balley, Ladefroux, 1997] : des jeunes présentant des parcours différenciés, qui n’étaient sans doute pas « représentatifs » de l’ensemble de ceux vivant dans ces quartiers, mais dont les trajectoires n’étaient pas non plus exceptionnelles, loin de là. L’importance accordée par nos interlocuteurs au rôle de la lecture dans la construction de soi [Petit, 2002] a rendu indispensable le détour par une discipline mieux armée que l’anthropologie ou la sociologie pour analy- ser les processus singuliers par lesquels celle-ci s’opère. En termes d’emprunts, c’est donc du côté de la psycha- nalyse que je me suis aventurée : pour « entendre » l’expérience de lecteurs et de lectrices, apprécier, en Ethnologie française, XXXIV , 2004, 4, p. 609-615 © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 05/01/2021 sur www.cairn.info (IP: 190.244.143.58) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 05/01/2021 sur www.cairn.info (IP: 190.244.143.58) particulier, les réagencements symboliques, langagiers, auxquels la rencontre avec des textes écrits peut donner lieu, cette science fournit quelques concepts très éclairants. Dans la fréquentation des géographes, il m’a semblé trouver un ancrage dans le réel, un rappel quotidien de l’attention à accorder à l’expérience des lieux, à la pra- tique du terrain, à l’analyse du contexte. Leur proximité m’a probablement aussi permis, toutefois, de repérer le jeu de différents espaces de référence dans cette construction d’une identité personnelle, et en particulier le rôle de l’ailleurs et du lointain qui en participe – me conduisant à interroger, en retour, l’engouement de géographes pour le « local », leur valorisation du proche. C’est à restituer ce mouvement que cet article s’attache : à faire apparaître qu’à côté des échanges de concepts ou de méthodes, des chassés-croisés de thématiques, il est des promiscuités heuristiques dont on parle trop rarement. • « Cet espace-là, c’est aussi lui... » « Pour moi, un livre, c’est des images, c’est un tableau, c’est un univers, un espace dans lequel on peut évoluer », dit Ridha. Et Rosalie : « La bibliothèque, les livres, c’était le bonheur, la découverte qu’il y avait un ailleurs, un monde, plus loin, où je pourrais vivre. Quelquefois il y a eu de l’argent à la maison, mais le monde n’existait pas. Le plus loin où on allait, c’était chez mémé, en vacances, au bout du département. Sans la bibliothèque, je serais devenue folle, avec mon père qui criait, qui faisait souffrir ma mère. La bibliothèque me permettait de respirer, elle m’a sauvé la vie. » Ou Daoud : « Quand on est en banlieue, on doit avoir des études mauvaises, on doit avoir un sale boulot, il y a tout un tas d’événements qui vous font aller dans un certain sens. Moi j’ai su esquiver ce sens-là, être anticonformiste, aller ailleurs, c’est ça ma place... (Ceux qui traînent), ils font ce que la société attend d’eux qu’ils fassent, c’est tout. Ils sont violents, ils sont vulgaires, ils sont incultivés. Ils disent : “Moi je vis en banlieue, je suis comme ça”, et j’ai été comme eux. Le fait d’avoir des bibliothèques comme celle-là m’a permis d’entrer, de venir, de rencontrer d’autres gens. Une bibliothèque sert à ça... J’ai choisi ma vie et eux ne l’ont pas choisie. » Très vite, lors de ces entretiens, la fréquence des méta- phores spatiales auxquelles nos interlocuteurs recou- raient a retenu mon attention, revenant tout au long de mes recherches, comme dans de nombreux souvenirs de lecture transcrits par des écrivains ou des scientifi- ques, lus en contrepoint. Par exemple, les remarques de Daoud venaient en écho à ce qu’avait écrit Richard Hoggart : « J’avais besoin de découvrir quelque chose par moi- même, de bifurquer en quelque sorte de la voie tracée, de faire mes propres découvertes, de trouver mes propres espaces d’enthousiasme en dehors de ce que les professeurs offraient et au-delà de ce dont parlait la quasi-totalité de mes camarades. Cette voie passait par la bibliothèque municipale... » [1991 : 228]. Camus, quant à lui, disait de la misère qu’elle était « une forteresse sans pont-levis » et de la bibliothèque muni- cipale : « Ce que contenaient les livres au fond importait peu. Ce qui importait était ce qu’ils ressentaient d’abord en entrant dans la bibliothèque, où ils ne voyaient pas les murs de livres noirs mais un espace et des horizons multiples qui, dès le pas de la porte, les enlevaient à la vie étroite du quartier » [1994 : 227]. L’essentiel est là, peut-être : la découverte qu’il existe autre chose, un espace « en dehors », « au-delà », un ail- leurs, et donc qu’il est possible de sortir, devenir autre chose, prendre une part active à son destin, plutôt que d’être seulement l’objet des discours et des décisions des autres. Pour bien des jeunes filles vivant dans des quar- tiers relégués en particulier, c’est une sortie de l’espace domestique, une échappée, là où une territorialisation accrue conforte le repli communautaire et le contrôle mutuel, là uploads/Litterature/ michele-petit-ethn-044-0609.pdf
Documents similaires
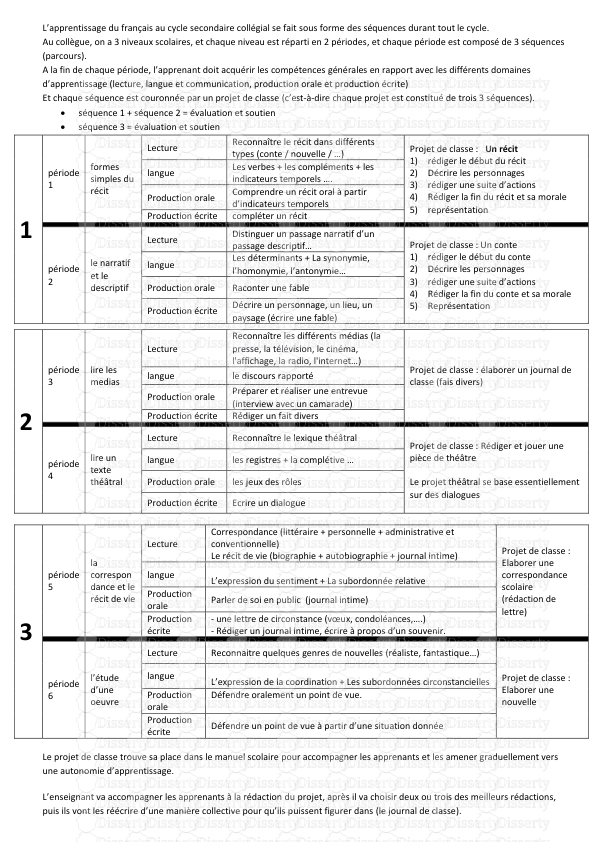









-
169
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 22, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3744MB


