Pierre MICHEL MIRBEAU ET MAUPASSANT Amicales pendant de longues années, les rel
Pierre MICHEL MIRBEAU ET MAUPASSANT Amicales pendant de longues années, les relations entre Octave Mirbeau et Guy de Maupassant se sont peu à peu dégradées, et la complicité de leurs débuts littéraires s’est vite muée en un abîme d’incompréhension réciproque, lors même qu’ils étaient suffisamment lucides et sensibles pour s’apprécier et pour porter sur leurs œuvres respectives des jugements empreints d’un grand discernement. Ce sont ces relations intermittentes que je vais évoquer et essayer d’expliquer, en me plaçant du point de vue de Mirbeau : c’est aux spécialistes de Maupassant qu’il reviendra de proposer un éclairage du point de vue de l’auteur du Horla1. BOHÉME Nous ne savons pas précisément quand ont commencé les relations entre ces deux Normands, également ambitieux et avides de plaisirs, “montés” à Paris avec la volonté bien arrêtée de s’émanciper de leurs milieux d’origine, de s’épanouir tous azimuts et de faire leur chemin sans rien sacrifier de leurs plaisirs ni de leurs aspirations. Mais longue et ardue est la route qui mène à la célébrité et à la richesse, et il leur a fallu à tous deux, pendant de longues années, connaître l’amertume de boulots indignes de leurs talents et médiocrement rémunérés : cependant que Guy se morfondait dans un terne et mortifère bureau, d’où il ne songeait qu’à s’évader, fût-ce par des moyens que 1 Sur la diversité des tempéraments des deux écrivains, et les convergences et « dissensions » dans leur approche du monde, je renvoie à l’article de Samuel Lair, « Guy de Maupassant et Octave Mirbeau : le clos et l’ouvert », Cahiers Octave Mirbeau, n° 3, 1996, pp. 15-29 (accessible sur Internet : http://start5g.ovh.net/~mirbeau/darticlesfrancais/Lair-OM%20et%20maupassant.pdf). réprouvent la morale et les lois de la République, Octave, lui, était confronté à l’humiliante nécessité de se vendre au plus offrant et de faire, tout à la fois ou successivement, le domestique2 (comme secrétaire particulier de Dugué de la Fauconnerie, puis d’Arthur Meyer), le trottoir3 (comme journaliste à tout faire, condamné à prostituer sa plume au service de ses directeurs et/ou commanditaires) et le nègre4 (en écrivant des volumes de contes et de romans, des essais et des comédies, pour le compte de fruits secs, mais fortunés et assoiffés de gloriole littéraire5), sans parvenir pour autant à la célébrité avant octobre 1882 et le scandale de son retentissant pamphlet contre la cabotinocratie et la société du spectacle6. Nous ne disposons malheureusement que de peu de données biographiques sur Mirbeau, au cours de ces ingrates années de formation, où il doit faire ses preuves et ses classes : les lettres intimes et les témoignages sont rares, la plus grande partie de sa production journalistique ne paraît pas sous son nom, et il subsiste par conséquent de nombreuses zones d’ombre. Deux épisodes sont néanmoins fort bien attestés, que nous signalerons pour mémoire sans nous y attarder : la participation du jeune Mirbeau, le 13 avril 1875, dans l’atelier du peintre Maurice Leloir, à la farce obscène et « absolument lubrique » de Maupassant, À la feuille de rose, maison turque, où il interprétait le rôle de Monsieur Beauflanquet, bourgeois de province et jeune marié égaré avec Madame dans un bordel ; et le fameux dîner chez Trapp, le 31 mai, 1877, où six jeunes écrivains autoproclamés – parmi lesquels Mirbeau était le seul à n’avoir encore à son actif officiel ni œuvres publiées, ni projets avoués – rendaient hommage à Flaubert, Goncourt et Zola, histoire de se faire mousser médiatiquement, au contact des trois maîtres qu’ils s’étaient judicieusement choisis. Du peu que l’on sait des relations de nos deux compères à l’époque, il ressort qu’ils fréquentaient la même bohème littéraire, notamment le milieu de La République des Lettres de Catulle Mendès, qu’ils devaient bien souvent se contenter des « inexprimables cuisines » de la mère Machiny7, qu’ils aspiraient pareillement à la reconnaissance de leurs prestigieux aînés et qu’ils ne s’interdisaient aucune frasque ni aucune provocation. Cette fraternité spirituelle implicite est confirmée par le tutoiement qui, chez Mirbeau, est tout à fait exceptionnel8 : ainsi n’a-t-il, curieusement, jamais tutoyé son confident de vingt ans et ancien complice des Grimaces Paul Hervieu, ni a fortiori les « grands dieux de [son] cœur » qu’étaient Claude Monet, Camille Pissarro et Auguste Rodin. Mais cette distance respectueuse qu’il entendait conserver avec ses amis les plus tendrement aimés 2 Mirbeau développera la comparaison entre les deux types de domesticité dans un roman posthume et inachevé, Un gentilhomme (recueilli dans le tome III de mon édition critique de son Œuvre romanesque, Buchet/Chastel – Société Octave Mirbeau, 2001 ; http://www.scribd.com/doc/3825199/Octave-Mirbeau-Un- gentilhomme). 3 Mirbeau a développé le parallélisme entre les deux formes de prostitution déjà dans ses Grimaces du 29 septembre 1883 : « Le journaliste se vend à qui le paye. Il est devenu une machine à louanges et à éreintement, comme la fille publique machine à plaisir ; seulement celle-ci ne livre que sa chair, tandis que celui-là livre toute son âme. Il bat son quart dans ses colonnes étroites – son trottoir à lui « (article recueilli dans ses Combats littéraires, L’Âge d’Homme, Lausanne, 2006, p. 78). 4 Voir notre article « Quelques réflexions sur la négritude », Cahiers Octave Mirbeau, n° 12, 2005, pp. 4- 34 (http://www.scribd.com/doc/2363537/Pierre-Michel-Quelques-reflexions-sur-la-negritude-). 5 Mirbeau s’en plaint amèrement dans un des premiers contes signés de son nom, « Un raté », paru dans Paris-Journal le 19 juin 1882 (il est recueilli dans notre édition de ses Contes cruels, Librairie Séguier, 1990, tome II, p. 426 ; http://www.scribd.com/doc/8419113/Octave-Mirbeau-Un-rate-). 6 Octave Mirbeau, « Le Comédien », Le Figaro, 26 octobre 1882 (recueilli dans les Combats politiques de Mirbeau, Librairie Séguier, 1990, pp. 43-50 ; http://www.scribd.com/doc/2243220/Octave-Mirbeau-Le- Comedien-). 7 Elle tenait une « infâme gargote » au coin de la rue Coustou et de la rue Puget. 8 Les trois seuls autres confrères qu’il ait jamais tutoyés, Léon Hennique, Paul Alexis et Émile Bergerat, sont aussi des compagnons de vieille date, qui ont partagé peu ou prou ses années de bohème. et admirés révèle aussi, par opposition, que ses relations avec son compagnon de bohème ne se situaient pas sur le même registre. Peut-être même le ver était-il déjà dans le fruit de cette camaraderie, qui ne lui était pas coutumière et qui devait lui paraître trop vulgaire. Pour l’heure, ce commun refus des tabous et ce goût pour la transgression vont de nouveau les rapprocher, lorsque Guy est victime, en janvier 1880, de poursuites judiciaires – sous prétexte d’outrage à la tartuffienne morale publique et religieuse... – pour une nouvelle en vers, « Une fille », jugée soudainement contraire aux bonnes mœurs, près de quatre ans après une première publication qui n’avait soulevé aucun scandale, sous le titre de « Au bord de l’eau ». Hostile à « ces mesures violentes qui atteignent la liberté littéraire » et qui lui inspirent « une haine vigoureuse », comme il l’écrivait quatre ans plus tôt9, Octave, à la demande de son ami, servira tout naturellement d’intercesseur auprès de son patron Arthur Meyer, pour permettre à Gustave Flaubert de s’élever, dans Le Gaulois du 21 février 1880, contre les poursuites engagées à l’encontre de son protégé et de contribuer d’une manière décisive au non- lieu prononcé peu après. Dans les années qui suivent, Mirbeau ne manquera jamais de rendre hommage au talent de son jeune camarade. Ainsi, le 13 mars 1883, écrit-il que « le public, abruti par les lectures stupides et malsaines » est devenu inapte « à distinguer entre l'œuvre puissante, toute parfumée d'art, de Guy de Maupassant, et une œuvre immonde, tout empuantie d'ordures10 ». Quelques mois plus tard, dans son article nécrologique sur Tourgueniev, il donnera au passage un nouveau coup de chapeau à « M. Guy de Maupassant, ce conteur robuste et fécond, qui mêle avec tant d’art l’observation le plus cruelle aux sensibilités les plus délicates11 ». L’hommage est développé deux ans plus tard, lorsque paraît Bel-Ami : M. Guy de Maupassant vient de publier un livre très remarquable et qui ne manque pas de courage. Bel-Ami, tel est son titre, un titre court, mais qui en dit long. L’auteur d’Une vie n’avait pas encore donné de son talent robuste une preuve aussi décisive, une démonstration aussi brillante. Je n’entends pas faire la critique de ce bel ouvrage, je veux seulement dire que M. Guy de Maupassant n’était jamais entré plus profondément dans la psychologie humaine et qu’il a écrit là quelques pages admirables, d’un art très puissant et définitif. C’est donc un vrai régal de lettres que ce livre [...] . 12 Néanmoins, dès l’époque des Grimaces, il convient de relever une première et significative réserve, lorsque Maupassant a accepté de préfacer un recueil de Maizeroy, une des bêtes noires de Mirbeau, et qui sera par ailleurs un des modèles de Bel-Ami : 9 Octave Mirbeau, « Chronique de Paris », L’Ordre de Paris, 11 novembre 1876 (Combats littéraires, p. 44 ; http://www.scribd.com/doc/2338346/Octave-Mirbeau-Chronique-de-Paris-11111876). Malheureusement pour sa réputation future de justicier, tout autre sera son attitude dans l’odieux et stupide article du 24 décembre 1884, « La uploads/Litterature/ pierre-michel-mirbeau-et-maupassant.pdf
Documents similaires







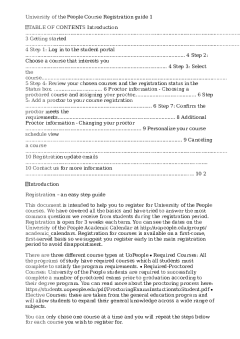


-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 11, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3220MB


