Questions de communication 26 | 2014 La pornographie et ses discours La psychan
Questions de communication 26 | 2014 La pornographie et ses discours La psychanalyse à l’épreuve de l’« indécent » The Psychoanalysis with Test of Indecent Éric Bidaud Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9280 DOI : 10.4000/questionsdecommunication.9280 ISSN : 2259-8901 Éditeur Presses universitaires de Lorraine Édition imprimée Date de publication : 31 décembre 2014 Pagination : 165-175 ISBN : 978-2-8143-0233-4 ISSN : 1633-5961 Référence électronique Éric Bidaud, « La psychanalyse à l’épreuve de l’« indécent » », Questions de communication [En ligne], 26 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2016, consulté le 19 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/questionsdecommunication/9280 ; DOI : 10.4000/ questionsdecommunication.9280 Tous droits réservés 165 questions de communication, 2014, 26, 165-176 > DOSSIER ÉRIC BIDAUD Unité transversale de recherche psychogenèse et psychopathologie Université Paris 13 F-93430 eric.r.bidaud@wanadoo.fr LA PSYCHANALYSE À L’ÉPREUVE DE L’« INDÉCENT » Résumé. — Dans sa déinition du champ du « sexuel », Sigmund Freud tenait compte dans un même ensemble de l’opposition des sexes, de la jouissance sexuelle, de la fonction de la procréation et du « caractère indécent d’une série d’actes et d’objets qui doivent rester cachés ». Ce rapport à l’« indécent » s’exprime dans le plaisir du voir et de l’être vu, mais aussi du dire et de l’être entendu, et participe du registre du sexuel infantile qui pourra trouver, à l’âge adulte, de multiples voies d’expression. Nous conviendrons que la psychanalyse « contemporaine » s’est peu intéressée à cet aspect de l’« indécent » : au champ du pornographique (étymologiquement des écritures prostitutionnelles) et moins encore au « porno », ces néo-espaces de l’expression pulsionnelle du voir et de l’entendre. Le discours psychanalytique soit a encouragé une approche péjorative et normative, soit s’est centré sur la question du lien addictif à la pornographie, donc à une certaine psychopathologie du regard. Nous montrons les prémisses d’une autre voie de recherche à partir de l’hypothèse selon laquelle le « porno », cet objet ordinaire de l’espace internet, participe du passage adolescent en lien avec l’irruption du « sexuel pubertaire ». Nous dirons que la sexualité qui s’invente et doit s’inventer chez le jeune adulte, et bien au-delà, doit prendre masque dans les sens qu’il convient de donner à ce mot : parure et parade, jeu du vrai et du faux... Ainsi est-ce sur la scène masquée, théâtralisé du « porno » que s’improvisent les mouvements de la sexualité qui, en quelque sorte, se socialisent. Mots clés. — Psychanalyse, pornographie, adolescence, obscène, visage. 166 dossier É. Bidaud D ans sa déinition du champ du « sexuel », Sigmund Freud (1915-1917 : 314) tenait compte dans un même ensemble de l’opposition des sexes, de la jouissance sexuelle, de la fonction de la procréation et du « caractère indécent d’une série d’actes et d’objets qui doivent rester cachés ». Ce rapport à l’« indécent » (ou l’« inconvénant » selon la dernière traduction) s’exprime dans le plaisir du voir et de l’être vu, mais aussi du dire et de l’être entendu, et participe du registre du sexuel infantile qui pourra trouver, à l’âge adulte, de multiples voies d’expression, contribuant même à l’évolution de l’objet sexuel vers la beauté. L’évolution de l’objet sexuel vers la beauté est liée à la dissimulation progressive de cette partie du corps (les organes génitaux) qui soutient la curiosité sexuelle, en reliant donc la beauté, premièrement, à la notion de voilement et, secondairement, à celle de détournement en l’orientant du côté de l’art. Le beau naîtrait de l’instant où il est possible de détacher l’intérêt exclusif à l’endroit des parties génitales pour le déplacer vers « certains signes sexuels secondaires ». Ainsi le beau participe-t-il d’un mouvement de voilement de ce qui est l’objet premier de l’excitation sexuelle, lequel est donc chassé du registre du beau. Sigmund Freud écrit (1905a : 67) : « Il me paraît incontestable que le concept du “beau” a ses racines dans le terrain de l’excitation sexuelle et qu’il désigne à l’origine ce qui est sexuellement stimulant. Ceci est en relation avec le fait que nous ne pouvons jamais proprement trouver “belles” les parties génitales elles-mêmes, dont la vue provoque l’excitation sexuelle la plus intense ». Aussi pourrions-nous avancer que la « laideur » des organes génitaux est non pas le négatif de la beauté, mais, en tant qu’origine oubliée (rejetée) de celle-ci, sa vérité. Derrière la beauté, se dissimule l’indécent, étymologiquement ce qui n’est pas présentable, la face honteuse du sexuel infantile. Le plaisir de regarder et de montrer (associé à la composante cruelle de la pulsion sexuelle) s’afirme tout au long de la petite enfance en tant que tendance autonome : « Les petits enfants dont l’attention est attirée un jour sur leurs propres parties génitales – le plus souvent par le biais de la masturbation – ont coutume de franchir le pas suivant sans intervention extérieure et de développer un vif intérêt pour les parties génitales de leur compagnon de jeu. Comme l’occasion de satisfaire ce genre de curiosité ne se présente la plupart du temps qu’au moment de la satisfaction des deux besoins excrémentiels, ces enfants deviennent des voyeurs, d’ardents spectateurs de l’évacuation d’urine ou de matières fécales des autres » (ibid. : 120). Avec l’entrée en jeu du refoulement, ce plaisir subira un recul, mais subsistera dans les jeux ordinaires de l’érotisme dit préliminaire de la sexualité adulte en tant que « curiosité » dirigée vers les parties génitales de l’objet convoité. En ce sens, la perversion infantile donne sa direction à l’expression de la sexualité dans ses voies les plus communes, c’est pourquoi les sexualités ne peuvent être dites normales que pour autant qu’elles sont empreintes d’un infantilisme pervers commun à tous : « Aucun bien-portant ne laisse probablement de joindre au but sexuel normal un supplément quelconque, qu’on peut qualiier de pervers, et ce trait général sufit en lui-même à dénoncer l’absurdité d’un emploi réprobateur du terme de perversion » (ibid. : 73). 167 dossier La psychanalyse à l’épreuve de l’« indécent » Par le plaisir scopique, s’éveille l’ordinaire de l’excitation libidinale sur le mode du regard actif dirigé sur l’objet, mais aussi sur le mode passif, le possible de « l’exhib », le « show de l’indécent ». Comme métaphore du sexuel, le dieu Priape a tous les attributs de l’obscène antique et de l’indécence rieuse. Il est représenté par un corps d’enfant affublé d’un membre viril disproportionné toujours exhibé. Il est la sexualité en excès, transgressant les valeurs de la bienséance, de la retenue et de la pudeur : « À force de montrer ce qui doit être voilé, d’exhiber sans arrêt ce qu’il faut camouler, Priape incarne cette laideur caractéristique de l’inconvenance. Son comportement trop visible est alors taxé de turpis. Ce terme fait partie du lexique latin de la laideur morale et physique, souvent révélée par la vue, qui exprime également l’indécence, l’obscénité, ce qui est sans charme et cause la répulsion » (Olender, 1986 : 384). Par sa nature « offensante », il est la visibilité du refoulé de la sexualité infantile. Ce dieu indécent est la igure effrayante et honteuse du champ obligé du fantasme et, en ce sens, ne cesse d’appeler le regard, d’entraîner vers les lieux fascinants de sa séduction dérangeante. C’est sous cet aspect du « dérangeant » qu’émerge la possibilité du rire et de la dérision que suscitent l’obscénité et l’impudeur1. Les pudeurs de la psychanalyse contemporaine La psychanalyse, qui s’est peu intéressée à la question, a montré une position que nous qualiierons d’embarrassée par rapport à la « scène pornographique ». Plus occupée à « démontrer » les dangers de l’extension du « porno » sur la scène libre du web, la psychanalyse a souvent fait le choix (et pris le risque) d’une position normative ou péjorative, ou encore s’est centrée sur la question du lien addictif à la pornographie, donc d’une certaine psychopathologie du regard en insistant sur une scène « désaffectée » coupée de la fonction élaborative du fantasme (Estellon, 2014). Avec inesse, Patrick Lacoste (1998 : 653) écrit : « La rélexion psychanalytique n’a peut-être pas encore pris la mesure de ses propres théorisations de l’image, de l’imaginaire et de la fonction du regard, comme si “l’image” la portait à des excursions toujours trop lointaines ». Dans le phénomène « porno », Gérard Bonnet (2003 : 16) voit l’émergence « d’un iceberg obscène, qui veut que les adultes aujourd’hui agressent les personnes les plus sensibles en leur inligeant la vision de leur sexualité génitale de la façon la plus triviale et la plus directe possible. L’impact des images pornographiques sur les plus jeunes n’est pas un effet secondaire, c’est le but inconsciemment recherché ». Ainsi, avant d’être un phénomène de voyeurisme de masse, la pornographie s’afirmerait-elle dans sa dimension d’emprise comme un exhibitionnisme pervers, une « pédophilie à l’échelle planétaire » des adultes soutiens de cette industrie. « T ous ceux qui 1 Il est à souligner que S. Freud (1905b : 372) ne fait que passer sur ce rapport entre le rire et uploads/Litterature/ questionsdecommunication-9280.pdf
Documents similaires









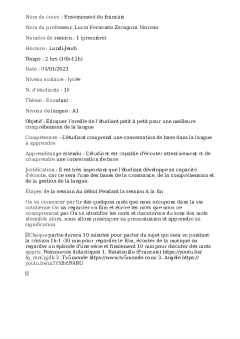
-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2142MB


