Études photographiques 3 | Novembre 1997 Frontières de l'image/Le territoire et
Études photographiques 3 | Novembre 1997 Frontières de l'image/Le territoire et le document " Ce qui est donné à voir, ce que nous pouvons montrer " Georges Perec, Robert Bober et la rue Vilin Christian Delage et Vincent Guigueno Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/290 ISSN : 1777-5302 Éditeur Société française de photographie Édition imprimée Date de publication : 1 novembre 1997 ISSN : 1270-9050 Référence électronique Christian Delage et Vincent Guigueno, « " Ce qui est donné à voir, ce que nous pouvons montrer " », Études photographiques [En ligne], 3 | Novembre 1997, mis en ligne le 19 novembre 2002, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/290 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. Propriété intellectuelle " Ce qui est donné à voir, ce que nous pouvons montrer " Georges Perec, Robert Bober et la rue Vilin Christian Delage et Vincent Guigueno 1 En 1992, dix ans après la mort de son ami Georges Perec, le cinéaste Robert Bober entreprend la réalisation d'un film intitulé En remontant la rue Vilin. Cette rue, dont seule une partie était désormais visible dans le nouveau jardin de Belleville, appartenait au paysage autobiographique de Georges Perec, qui l'avait lui-même arpentée une première fois, en 1946, avec sa tante, puis en 1961 ou en 1962, sans que ce retour réussisse à provoquer en lui un souvenir précis. Un jour de 1969, il s'était arrêté devant le numéro 24, où il savait qu'il avait vécu, en compagnie de ses parents, les six premières années de sa vie (fig. 1. Christine Lipinska, Georges Perec devant le n° 24 de la rue Vilin, 1971). Il resta cependant sur le seuil de la porte. La démarche qui l'avait ramené à ce point de départ ne s'était pas faite spontanément. Il avait fallu l'astreinte d'un travail d'écriture, fondé sur des procédures d'appropriation de la rue Vilin partagées entre le réel et le souvenir, et sur la révélation douloureuse de l'absence de son propre passé. Perec avait également voulu inscrire ses déambulations dans un cadre photographique, en faisant appel à des amis ou à des professionnels saisissant en sa compagnie, selon leur inspiration, les petits événements quotidiens d'une rue promise à la démolition. 2 Grâce à la complicité qui les a unis, Bober a pu inscrire ce double rapport photographique et littéraire aux lieux dans un film mêlant des images animées, des images fixes et des textes écrits. En remontant la rue Vilin est en effet conçu à partir des "archives" que Georges Perec avait lui-même constituées et montre un cinéaste aux prises avec une histoire fragmentée, nécessitant le rassemblement des pièces d'un puzzle conçu de manière inachevée. Analysant ce film aujourd'hui, nous sommes [p. 121] également confrontés à ces traces parvenues jusqu'à nous, et au désir de re-raconter cette histoire : en quoi les outils du photographe, du cinéaste et de l'écrivain, réunis dans un récit qui les mêle sans masquer leur hétérogénéité, peuvent-ils nous aider à comprendre la manière dont Perec a porté son expérience au langage et la reconfiguration opérée par Robert Bober ? " Ce qui est donné à voir, ce que nous pouvons montrer " Études photographiques, 3 | Novembre 1997 1 Le seuil de l'Histoire 3 Dès 1976, en réalisant Réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise (qui allait provoquer la rencontre avec Georges Perec) Bober avait tenté la démarche de se filmer "retournant" dans un lieu où ses parents avaient habité, mais où il n'avait cependant jamais vécu. Puisqu'il ne pouvait pas avoir de souvenirs personnels autres que ceux transmis oralement ou sauvegardés par des traces, il avait rassemblé, avant de partir, une documentation semblable aux sources que convoque l'historien : des prospectus, des cartes postales, qui devaient lui permettre de reconnaître la rue où se trouvait la maison à Radom ; des photographies de Roman Vischniac ; des portraits de famille ; des livres, W ou le souvenir d'enfance, de Georges Perec ; une mémoire orale, celle de son père. Dans la chambre d'hôtel où il séjourne pendant le tournage, Bober filme ces éléments d'un souvenir construit, réécoute au magnétophone le témoignage de son père, tente d'embrasser d'un seul regard les photographies qu'il a accrochées sur le mur. Il cherche ainsi, de manière volontaire, à "défataliser" le retour vers un passé dont il sait bien la fragilité, voire la vacuité, en l'actualisant, en le réifiant dans le présent : " Ce lieu existait, il était intact, des gens y vivaient, à peu près dans les mêmes conditions que celles qu'avaient connues mon père et mes grands-parents. Comme je n'y avais jamais vécu, j'étais poussé par la curiosité, le souhait de me trouver un peu dans l'enfance de mon père, en croyant la connaître alors que je savais très bien que je ne la connaissais pas1. " Si Bober, à la différence de Perec, n'a pas connu de rupture personnelle dans la transmission entre générations, pour autant il avait le besoin, le désir de se projeter dans un temps passé antérieur à sa propre vie et contemporaine des premières années de la vie de son père. 4 Parmi tous ces documents dont l'unicité comme la mise en collection semblent former une preuve du réel, du fait survenu, la photographie occupe une place singulière. À la différence de l'objet-film, elle peut en effet fixer un moment du temps, un instant arrêté, en n'obligeant pas [p. 122] après coup à le prendre en compte dans une reconstruction, une médiation narrative. La tentation de composer une histoire globale peut néanmoins exister : ajoutés les uns aux autres, dans un certain type de cadrage et de succession, des clichés peuvent donner l'illusion de l'effectuation linéaire d'un événement. Cependant, la perception d'une séquence dans la continuité de son déploiement n'engage pas forcément une vérité interprétative. Dans la représentation offerte, il y a d'abord un transfert du passé vers le présent : " Quelque chose qui était présent et ne l'est plus est maintenant re présenté, expose Louis Marin à propos de l'"être de l'image". À la place de quelque chose qui est présent ailleurs, voici présent un donné, ici : image ? Au lieu de la représentation, donc, il est un absent dans le temps ou l'espace ou plutôt un autre, et une substitution s'opère d'un autre de cet autre, à sa place2. " Dans le plein apparent d'une photographie se trouve ainsi énoncée une absence qui rend difficile son appropriation, même et surtout quand elle concerne la partie la plus privée de la vie d'un individu. 5 Pendant l'été 1970, Georges Perec, avançant dans son travail préparatoire à la mise en forme de W ou le souvenir d'enfance, se trouva plusieurs fois en difficulté et, en un réflexe presque instinctif, se replongea dans l'album de photographies familiales. Mais ce fut pour s'obliger à l'exercice de décrire une à une les sept photographies qu'il avait ainsi extraites : [p. 123] 6 " Par où commencer ? Presque en désespoir de cause, j'ai fini par trouver au milieu de mes dossiers un album de photos dont j'ai extrait les sept plus anciennes. Je les ai " Ce qui est donné à voir, ce que nous pouvons montrer " Études photographiques, 3 | Novembre 1997 2 examinées longuement, grossissant même quelques détails à l'aide d'un compte-fils, puis je suis allé regarder de l'athlétisme à la télévision3. " 7 Que ce soit dans le tourment d'une expérience intime ou dans le regard porté sur l'autre, il s'agit bien de définir une forme d'empathie qui évite l'artifice du pur jeu d'écriture comme la complaisance à l'égard de soi. Ce n'est pas un hasard si le livre de chevet de Robert Bober au moment du tournage de son film à Radom était Louons maintenant les grands hommes. En 1936, James Agee et Walker Evans avaient reçu du magazine américain Fortune la commande d'" un compte rendu photographique et verbal des conditions de vie faites, dans le milieu des métayers blancs, à une famille type représentative ". Toute la difficulté, dans cette aventure commune d'un écrivain et d'un photographe au moins pendant le mois qu'ils passèrent ensemble dans l'Alabama , vint du statut respectif de l'écriture et de la photographie dans ce qui allait finalement aboutir à un livre. Mus par des préoccupations sociales autant qu'esthétiques, les auteurs se heurtèrent de front au problème du réalisme en art. Dans l'introduction, Agee s'exprima de manière nette : " Par-dessus tout : pour l'amour de Dieu, ne pensez pas à ceci comme à de l'Art ", s'écrie- t-il à l'intention des lecteurs4. La justesse de l'attention portée à ces métayers dans la mise en récit de leur existence tient dans le respect de ce que Agee qualifie ailleurs de " cérémonie de l'innocence5 ". Si la réalité n'est pas représentable en tant que telle, sans l'aide d'une médiation, il faut la révéler, en se tenant cependant au plus près de la vérité des personnages ou des situations observés, tant dans le mot que dans l'image, et davantage encore dans le croisement des deux. uploads/Litterature/ quot-ce-qui-est-donne-a-voir-ce-que-nous-pouvons-montrer-quot-georges-perec-robert-bober-et-la-rue-vilin.pdf
Documents similaires









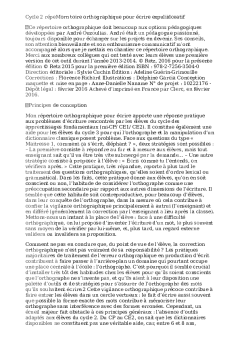
-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 08, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2476MB


