Romanica Cracoviensia 11 / 2011 Joanna Górnikiewicz Université Jagellonne de Cr
Romanica Cracoviensia 11 / 2011 Joanna Górnikiewicz Université Jagellonne de Cracovie SUR LES TRACES DE BOY – JULIAN ROGOZIŃSKI, TRADUCTEUR DE PROUST Jusqu’à la seconde moitié des années 30’, les lecteurs polonais, désireux de goûter à l’écriture proustienne, devaient lire A la recherche du temps perdu 1 en version origi- nale ou se contenter de courts et rares extraits parus en polonais dans des magazines littéraires ou culturels (voir Górnikiewicz 2011a,b). Ceux qui ont pu lire Proust dans le texte ont cependant tous pointé du doigt les traits caractéristiques de son écriture, originale et riche mais en même temps étrangère au génie de la langue française et, selon certains critiques, quasi impossible à rendre dans une autre langue (Lutosławski 1925 : 4–5). En novembre 1936, arrivèrent dans les librairies les deux premiers tomes de Du côté de chez Swann traduits par celui pour qui, en traduction, rien n’était impossible, une légende vivante, le traducteur par excellence (Skibińska 2011) – Tade- usz Boy-Żeleński. Entre 1936–1939, ce dernier traduisit l’ensemble du cycle. Malheu- reusement, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale empêche la publication des deux derniers volumes (Albertine disparue et Le Temps retrouvé). L’auteur de la traduction polonaise meurt fusillé par les Nazis avec les autres professeurs de l’Université de Lvov en 1941 et les manuscrits des parties manquantes brûlent dans l’incendie de son appartement pendant l’insurrection de Varsovie en 1944 (Winklowa 1998 : 190). Après la guerre, les lecteurs polonais devront encore patienter quinze ans avant de pouvoir lire le cycle entier. Vers la fin des années 50’, les maisons d’édition sont finalement autorisées à élargir le choix des titres et un éditeur de première importance – le PIW, dirigé à l’époque par Irena Szymańska, grande admiratrice de Proust (Szymańska 2001 : 14, 42), se décide à éditer l’ensemble du cycle A la recherche du temps perdu : les cinq premiers tomes seront publiés dans la traduction existante et les deux derniers forcément dans de nouvelles traductions (et ils seront les seuls à être retraduits dans leur intégralité quarante ans plus tard). C’est probablement pour une raison bien prosaïque (une question de délais) que deux traducteurs se chargèrent de terminer la mission de Boy-Żeleński. Deux fortes personnalités qui avaient tout de même plusieurs points communs : ils appartenaient à la même généra- tion, la première qui, après plus d’un siècle de captivité, pouvait enfin jouir des mêmes privilèges que les jeunes gens des autres pays européens (éducation, divertissements) et avaient une formation et des connaissances en littérature française comparables… 1 Dans la version originale, A la recherche du temps perdu est publié entre 1913–1927 en partie à titre posthume (Proust meurt le 18 novembre 1922). Romanica Cracoviensia, vol. 11, pp. 154-166 Kraków 2012 Published online February 06, 2012 Sur les traces de Boy – Julian Rogoziński, traducteur de Proust 155 Dans la présente contribution, nous esquisserons le portrait de Julian Rogoziński – l’un de ceux qui ont osé reprendre le flambeau après Boy et nous répondrons à la question de savoir quand et dans quelles circonstances fut traduite la dernière partie du cycle 2. Julian Rogoziński (1912–1980) était le fils de Julian Teodor, directeur d’une fabrique de meubles et d’Anna née Kirchner, comptable de profession. Orphelin de père très jeune, il grandit dans la maison de ses grands parents paternels à Kielce où, en 1932, il obtint son baccalauréat 3. Dans sa jeunesse, il fut attiré par le septième art, qui à l’époque conférait une touche de fraîcheur à la création artistique, et apprécia particu- lièrement la cinématographie allemande à laquelle il accordait un rôle non négligeable dans la formation de ses goûts et préférences littéraires (J. Rogoziński dans Sobolew- ski 1975 : 4). Paradoxalement, c’est un film allemand qui lui fit connaître et aimer Balzac (Glanz und Elend der Kurtisanen de Manfred Noa, 1927 4, d’après Splendeurs et misères des courtisanes de Balzac, avec Paul Wegener, l’un de ses acteurs préférés, dans le rôle de Vautrin) 5. A partir de 1933, il étudia les lettres modernes polonaises et ensuite françaises (la philologie romane) à l’Université de Varsovie (il soutint son mémoire de maîtrise chez Julian Krzyżanowski à l’université clandestine sous l’occupation nazie 6). Rogoziński débuta comme traducteur de la poésie française en 1936 avec les traductions des poèmes de P. Soupault publiées dans la revue Nasz Wyraz. Dans les années 1938–1939, il travailla comme secrétaire dans la rédaction du bi-mensuel Ateneum et écrivit ses premières critiques littéraires. En 1939, avec Zbig- niew Bieńkowski, il publie Zeszyt Poezji Francuskiej (Cahier de Poésie française) avec ses traductions des poèmes d’Apollinaire, Cendrars, Jacob, Reverdy dont cer- taines entreront plus tard dans l’Anthologie de la poésie contemporaine française d’Adam Ważyk 7. Les années de la guerre furent consacrées au travail traductologique. Après la libération et une courte période passée au Service de la Culture de la Voïvodie de Kielce (Wojewódzki Urząd Kultury), Rogoziński fut nommé attaché culturel de l’Ambassade de la République Polonaise à Bruxelles. Le séjour se révéla fructueux car il put y nouer des relations d’amitié avec le monde littéraire (p. ex. avec Franz Hellens, voir Abe 1980 : 158). De retour en Pologne en 1947, il travailla au Ministère des Affaires Etrangères qu’il quitta quelques mois plus tard pour se consacrer entièrement à ses traductions et cette fois-ci, principalement pour des motifs économiques (J. Rogo- ziński dans M.Z. 1957 : 8), ses préférences vont vers la prose réaliste. En 1948, paraît le recueil de nouvelles Trois contes (Trzy opowieści) de Flaubert, une sorte de contre- -proposition face à une première traduction, très bien accueillie, de Wacław Rogowicz 2 Nie ma Albertyny (VI) 1960, le titre original Albertine disparue (La Fugitive) fut traduit par Maciej Żurowski. 3 Le baccalauréat au gymnase [école secondaire] M. Rej de Kielce, Roztworowski (éd.) (1988– –1989 : 466). Selon Rocznik Literacki (1980 : 747), il l’obtint dans un lycée français à Varsovie. 4 http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=BALZ_006_0395 (consulté en octobre 2010). 5 Dans sa jeunesse, il a également lu et admiré les traductions de Balzac par Boy. « Francuski dorobek… » (1967 : 6). 6 Selon Rocznik Literacki (1980 : 747), il n’a pas terminé ses études. 7 Ważyk (1947). L’anthologie contient 16 poèmes de 6 auteurs (Apollinaire, Jacob, Soupault, Supervielle, Cocteau, Valéry) dans la traduction de Rogoziński. Romanica Cracoviensia, vol. 11, pp. 154-166 Kraków 2012 Published online February 06, 2012 Joanna Górnikiewicz 156 (1914). Rogoziński fut très vite perçu comme le continuateur de l’œuvre de Boy (voir le titre significatif de l’article de J. Adamski, à l’époque directeur de la Rédaction de la Littérature Romane et ensuite celle de la Littérature Polonaise chez le PIW – « W ślady Boya » [Sur les traces de Boy]) et cela non seulement par le choix des titres et le nombre des traductions mais aussi par le fait que, avant leur réédition, il avait collationné les traductions de son grand prédécesseur avec les textes originaux. Voilà comment l’a caractérisé Ryszard Matuszewski (1980a : 360–361, trad. J.G. ; voir aussi idem 1980b) : Je pense que peu de lecteurs de ses excellents essais et traductions se rendent compte du fait qu’une fois recueillis et publiés ensemble, ceux-ci, sans craindre une disproportion quel- conque, pourraient être rapprochés du patrimoine laissé par Tadeusz Boy-Żeleński. Julek, avec dignité, a pris sur lui et continué la tâche entreprise par Boy non seulement en renouant avec son idée d’introduire dans la culture polonaise des oeuvres de Stendhal et de Balzac, de Diderot et de Voltaire, de Flaubert et de Proust, mais aussi en prenant le relais pour ce qui est de maintenir les contacts les plus étroits avec la littérature française, aussi bien classique que – et cela beaucoup plus souvent que n’a fait Boy – contemporaine. En effet, Rogoziński – qui au début se donna pour mission de continuer ce projet éditorial de grande envergure, connu sous le nom de Bibliothèque de Boy – a vite élargi les cadres imposés par son prédécesseur 8. Après quelques années consacrées aux grands réalistes français du XIXe (France, Vallès, Maupassant, Stendhal, Balzac), il se tourne vers les textes philosophiques du XVIIIe siècle (Diderot) pour remonter encore plus loin dans le temps avec les traductions des romans de Lesage et de Scarron (XVIIe s.) 9. En tant que continuateur de l’oeuvre de Boy, il se fait un nom et, dès que la situation politique le permet, il propose à des rédacteurs, metteurs en scène et éditeurs les titres de qualité qu’il a lui-même envie de traduire (Abe 1980 : 158). En 1956, vient Beckett (avec, pour commencer, En attendant Godot, dont des extraits sont publiés dans le Dialog, 1956, 1, p. 88–98, et mis en scène en 1957, par Jerzy Kreczmer au Teatr Współczesny de Varsovie) ensuite, Sartre, Vercors, Gide, Cendrars, Giono, Claudel, Ionesco, Sarraute... En même temps, il ne néglige pas la littérature plus ancienne Cyrano de Bergerac, Dumas, Marivaux, Voltaire... Pour la collection retro (fr. rétro) de la maison d’édition Czytelnik, il traduit Valéry, Larbaud, Huysmans, Rémy de Gourmont, Pierre Louÿs, les frères Goncourt... 10 Julian Rogoziński pouvait uploads/Litterature/ sur-les-traces-de-boy-gornikiewicz-rc-2011.pdf
Documents similaires


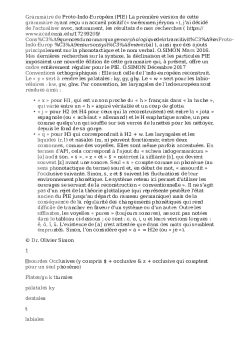







-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 06, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1794MB


