1. Donatien Alphonse François de Sade, Justine, ou les Malheurs de la vertu, t.
1. Donatien Alphonse François de Sade, Justine, ou les Malheurs de la vertu, t. I, en Hollande, chez les libraires associés, 1791, frontispice BNF, Réserve des livres rares, Enfer 501 Revue de la Bibliothèque nationale de France n° 50 2015 15 S oulever la question du libertinage, dans l’œuvre de Sade, relève au mieux du paradoxe, au pire de la dénégation : le bicentenaire de sa disparition ne vient-il pas de rappeler, au cœur de sa trajectoire de proscrit comme de l’anatomie des passions qui nour- rit l’ambition anthropologique de ses textes, la place décisive qu’y occupent l’hétérodoxie morale et les jouissances sexuelles ? Si l’histoire des études sadiennes, dont l’année 2014 fut l’occasion de retra- cer la riche et sinueuse archéologie 1, a progressive- ment dissocié ce libertinage de la pathologie pour lui restituer une place dans le paysage philosophique et esthétique des Lumières, il n’en reste pas moins le principe fondateur d’une cartographie littéraire scin- dée en deux territoires – œuvres signées ou « exoté- riques » vs œuvres clandestines ou « ésotériques 2 » –, chacun traversé par le tableau des plaisirs, s’écrivît-il à mots nus ou en phrases gazées. Une curieuse ambi- guïté persiste pourtant, qui engage moins l’existence avérée d’un libertinage sadien que la frontière entre masculin et féminin qui s’y dessine : alors qu’aucun protagoniste n’échappe à sa pratique ni à la fascina- tion qu’il exerce, les héroïnes se caractérisent au contraire par la diversité de leurs conduites et de leurs rôles. Victimes, spectatrices, esclaves ou maquerelles, l’éventail actanciel féminin contraste avec la trajec- toire uniforme des hommes, tous sectateurs du vice et dont les rares exceptions – songeons, dans Justine ou les Malheurs de la vertu, à Dubreuil, « jeune homme honnête et sensible 3 » qui tombe sincèrement amou- reux de l’infortunée, ou à « l’honnête M. de Corville 4 », juge éclairé qui l’épargne par compassion – corro- borent en négatif l’hypothèse d’une destinée scélérate des héros. Si l’homme, chez Sade, est libertin, la femme ne naît pas libertine, elle le devient. Elle choisit, plus précisément, ce qui constitue moins pour elle une essence qu’un possible. Sade et le féminin singulier Cette spécificité détermine à la fois une structure romanesque – le célèbre diptyque qui fictionnalise, au miroir des deux sœurs, la coexistence des « infortunes de la vertu » et des « prospérités du vice », ouvrant ainsi une double carrière aux jeunes filles – et une identité qui associe singulièrement, sous la plume de Sade, le féminin à la liberté. Affranchi de toute détermination, il incarnerait la promesse d’une existence plurielle, qui permette au sujet de se construire sans que l’auto- rité des sens ni celle de la machine aliènent sa volonté. Paradoxale de prime abord, cette valorisation, au 1 Voir notamment le catalogue de l’exposition du bicentenaire de la mort de Sade organisée à la Fondation Martin Bodmer à Genève, Sade. Un athée en amour, dir. Michel Delon, Paris, Albin Michel, 2014 et les récentes bibliographies qui accompagnent les deux éditions de Sade « homme de lettres » : Contes étranges, éd. M. Delon, Paris, Gallimard, 2014 et Contes libertins, éd. Stéphanie Genand, Paris, Garnier-Flammarion, 2014. Voir aussi le vol. XXXII des Romances studies, « Sade, l’inconnu ? », 2014, dirigé par Nicholas Cronk et Manuel Mühlbacher. 2 Ces deux notions ont été théorisées par M. Delon dans « De Thérèse philosophe à La Philosophie dans le boudoir, la place de la philosophie », Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 1983, nos 1-2, p. 76-88. 3 Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Justine ou les Malheurs de la vertu (1791), rééd. M. Delon, Œuvres, Paris, Gallimard, t. II, 1995, p. 352. Toutes les occurrences renverront à cette édition de référence. 4 Justine, p. 385. Stéphanie Genand Le libertinage existe-t-il au féminin ? Le cas Justine dans l’œuvre de Sade Revue de la Bibliothèque nationale de France n° 50 2015 16 Stéphanie Genand cœur de récentes publications qui ont interrogé la question des femmes dans l’œuvre sadienne 5, invite à penser autrement le rapport entre les sexes tel que la geste sororale de Justine et Juliette le dessine. Au schéma binaire qui oppose les victimes aux bour- reaux et les créatures vulnérables aux puissants – Gernande en résume la loi despotique : « Ainsi, ce bonheur que les deux sexes ne peuvent trouver l’un avec l’autre, ils le trouveront, l’un par son obéissance aveugle, l’autre par la plus entière énergie de sa domi- nation 6 » –, elle requiert de substituer une lecture qui déconstruise le rapport de force : et si Justine, « l’an- cienne femme, asservie [et] misérable 7 » diagnosti- quée par Apollinaire, était plus libre que Juliette ? Une telle interrogation engage, par-delà le caractère contrasté des héroïnes, la relation complexe entre féminité et libertinage. Dès lors que ce dernier ne constitue plus un destin mais un devenir, voire une option que les héroïnes peuvent refuser, la labilité de leurs trajectoires, où rien ne fige l’association du fémi- nin et du libertin, ne dénonce plus une fatalité ni une faiblesse. Aucune incompatibilité de nature, fût-elle d’organes ou d’imagination, n’exclut a priori l’héroïne d’un système de pensée et de jouissance dont elle décide seule d’épouser ou de transgresser la loi. C’est pourtant là, ressassé par les bourreaux que Justine croise sur sa route, le prétexte matérialiste qui prête aux femmes, comme le théorise Saint-Florent, « un physique entièrement dénué d’énergie 8 », les condam- nant à préférer les « voluptés morales » aux « chocs vigoureux 9 ». Mise en doute par l’architecture narra- tive, qui juxtapose à la prétendue sensibilité de Justine l’âme trempée de sa sœur, cette hypothèse constitue moins, à relire attentivement le texte, la doxa sadienne qu’une posture que la résistance jusqu’à l’invraisem- blance de la vertu invite à soupçonner : Justine n’in- carne-t‑elle pas le détachement sur lequel fonder la réflexivité constitutive du libertinage ? Ne faut-il pas, pour dire le désir et l’analyser, savoir, à son image, neutraliser les passions ? Telle est l’hypothèse que la présente contribution aimerait développer : lisant à rebours l’itinérance douloureuse de Justine, abstrac- tion faite des discours libertins et des postulats qui soulignent à l’envi l’ignorance de la jeune femme 10, elle voudrait y analyser les vertus de la sublimation. Justine ou la résistance Ces dernières s’illustrent, dès l’ouverture du récit, par l’accent mis sur la profondeur mystérieuse de Justine. Alors que le portrait de Juliette, provisoi- rement baptisée « Mme de Lorsange », brille par sa concision – chez elle « le caractère et l’esprit étaient, à fort peu de chose près, aussi formés qu’à trente ans 11 » –, sa sœur présente au contraire une âme « implexe 12 », pour reprendre la formule dont Sade use, dans l’Idée sur les romans, pour désigner les fables à multiples tiroirs. Dotée d’une sensibilité et d’une sincérité qui compromettent son inscription pro- grammée dans le jeu social, elle campe moins un per- sonnage déjà achevé, qui adopte sans coup férir le cynisme du jour, qu’une figure capable à la fois d’éprouver et de se détacher. Là réside l’une des clés de Justine, dotée « d’un caractère sombre et mélanco- lique 13 », qu’elle joint à la faculté de sentir celle de s’abstraire. Cette division, dont Jean Starobinski a montré, après Freud, qu’elle affectait le sujet d’une identité double, à la fois vivante et spectatrice de sa vie 14, juxtapose à l’expérience passive du monde – le fameux voyage immobile de Justine 15 – la faculté de ne jamais lui appartenir. Cette prédisposition pour l’écart, qui fait de Justine une femme des lisières et des forêts 16, s’accompagne d’une indifférence aux argu- ments captieux des mentors qui prétendent l’édu- quer : « On endurcit difficilement un bon cœur, il résiste aux raisonnements d’une mauvaise tête 17 », précise Sade, soulignant d’emblée le singulier « iso- lisme » d’un personnage à la fois sourd et aveugle aux noirceurs du réel. Loin de signer l’ingénuité d’une héroïne coupable de ne pas savoir déchiffrer les codes ni les situations, cette distance transforme Justine en 5 Voir notamment Anne Coudreuse et Stéphanie Genand (dir.), Sade et les femmes. Ailleurs et autrement, Itinéraires, 2013-2, Paris, L’Harmattan, 2014. Consultable en ligne sur Revues.org : http://itineraires.revues.org/629. 6 Justine, p. 303. 7 Guillaume Apollinaire, L’Œuvre du marquis de Sade, Paris, Bibliothèque des curieux, 1909, p. 18. 8 Justine, p. 316. 9 Ibidem, loc. cit. 10 La liste ne saurait être exhaustive des critiques et des éditeurs qui ont associé au personnage de Justine l’ignorance et la régression. Citons, à titre d’exemple, Jean Paulhan, pour qui « L’expérience ne lui apprend rien » (« La douteuse Justine ou les revanches de la pudeur » [1946], rééd. Les Infortunes de la vertu, Paris, Pauvert, 1959, t. I) ou Angela Carter, qui précise, dans sa célèbre étude, que « les souffrances de Justine ne possèdent aucune mystérieuse vertu et le martyre enduré par cette figure christique demeure absolument inutile » (La Femme sadienne, trad. Françoise Cartano, Paris, Veyrier, uploads/Litterature/02-r50-genand-020615-v01-2.pdf
Documents similaires
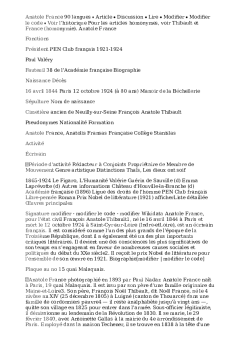









-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.8162MB


