ANTOINE CALVET, L’ALCHIMIE AU MOYEN ÂGE : XIIE-XVE SIÈCLES Geneviève Dumas Cent
ANTOINE CALVET, L’ALCHIMIE AU MOYEN ÂGE : XIIE-XVE SIÈCLES Geneviève Dumas Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | « Cahiers de civilisation médiévale » 2021/2 n° 254 | pages 147 à 151 ISSN 0007-9731 ISBN 9782490783090 DOI 10.4000/ccm.7358 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-civilisation-medievale-2021-2-page-147.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers. © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82 © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82) Cahiers de civilisation médiévale Xe-XIIe siècle 254 | 2021 Varia Antoine CALVET, L’alchimie au Moyen Âge : XIIe- XVe siècles Geneviève Dumas Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/ccm/7358 DOI : 10.4000/ccm.7358 ISSN : 2119-1026 Éditeur Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers Édition imprimée Date de publication : 1 juin 2021 Pagination : 147-151 ISBN : 978-2-490783-09-0 ISSN : 0007-9731 Référence électronique Geneviève Dumas, « Antoine CALVET, L’alchimie au Moyen Âge : XIIe-XVe siècles », Cahiers de civilisation médiévale [En ligne], 254 | 2021, mis en ligne le 01 juin 2021, consulté le 08 novembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/ccm/7358 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccm.7358 La revue Cahiers de civilisation médiévale est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82) © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82) 147 Antoine CALVET, L’alchimie au Moyen Âge : XIIe-XVe siècles, Paris, Vrin (Études de philosophie médiévale, 107), 2018. Depuis quelques décennies seulement, l’alchimie médiévale bénéficie d’un nouveau regard. De multiples entreprises d’édition de textes, des analyses plus fines, des recherches plus concertées ont permis de dresser à nouveau frais la topographie de cette discipline médiévale et moderne qui, jusqu’à très récemment, était traitée comme anecdotique, voire farfelue. Cette nouvelle historiographie révèle que, malgré ses idéaux chimériques, ses discours cryptés, ses horizons initia- tiques, l’alchimie n’était pas qu’une quête effrénée et illusoire de l’or. Elle se développe comme une discipline théorique principalement, mais parfois aussi pratique, s’intéressant à la transformation des métaux. Si l’ensemble des travaux d’ecdotique et d’analyse les plus récents avait permis de parler de l’alchimie médiévale en des termes plus nuancés, les acquisitions nouvelles de ce champ de recherche très dynamique restaient l’apanage de spécialistes ou d’amateurs d’érudition. Manquait donc un ouvrage de synthèse qui mettrait à jour les connaissances accumu- lées depuis les trente dernières années et qui donnerait un portrait général de ce système de pensée ayant imprégné les savants du Moyen Âge et des Temps modernes. Qui de mieux placé pour exécuter cette tâche qu’Antoine Calvet qui a participé activement à ce renouveau historiographique avec des travaux d’édition comme d’analyse, notamment autour du corpus alchimique du pseudo Arnaud de Villeneuve, un des plus célèbres entre tous. Dans ce livre, l’a. nous fait prendre les nombreux chemins que le savoir alchimique a suivis se transmettant par la traduction et l’assimilation à partir de son berceau gréco-romain au monde arabe jusque dans l’univers intellectuel médiéval. L’introduction fait déjà la part des choses et pointe justement les limites évidentes de ces textes : des traductions inégales, imparfaites, où « la cohérence des idées n’est pas toujours respectée », des recettes anonymes, des fragments épars. L’a. y explique bien les principes de base de la transmutation alchimique lesquels sont parfois difficiles à saisir. Les théories du mercure-soufre comme celle des quatre éléments posaient que les métaux se raffinaient sous la terre sur de très longues périodes. Les alchimistes estimaient pouvoir accélérer ce processus et changer ainsi des métaux vils en métaux nobles, notamment en modi- fiant leur couleur. C’est l’histoire de ces alchimistes que l’a. entend retracer dans cet ouvrage. Le premier chapitre s’attaque à la difficile question de la réception de l’alchimie arabe dans l’Europe médiévale. Les premiers témoins sont examinés un à un dans un schéma qui allie analyse de l’œuvre et remise en contexte de sa production. L’a. réussit avec brio à nous présenter des auteurs, voire à mettre de la chair sur des personnages dont les noms sont connus mais peu leur histoire. Le chapitre suivant introduit les principaux corpus alchimiques arabo-latins. Dans l’Occident latin, prin- cipalement trois auteurs arabes sont associés à l’entre- prise alchimique : Geber, Rhazès et Avicenne. Sous ces trois noms circulent des traités presqu’entièrement ANTOINE CALVET © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82) © Centre d'études supérieures de civilisation médiévale/Université de Poitiers | Téléchargé le 25/06/2022 sur www.cairn.info par via Université Rennes 2 - Haute Bretagne (IP: 90.105.189.82) 148 CAHIERS DE CIVILISATION MÉDIÉVALE, 254, 2021 COMPTES RENDUS pseudépigraphiques très divers dans leur forme comme dans leur contenu, dont les notions hétéroclites se transposeront tous azimuts dans l’alchimie latine. Parmi les œuvres connues de l’alchimie arabe on trouve aussi des œuvres canoniques, classées par l’a. dans la catégorie des textes mytho-poétiques. C’est que ces textes montrent une autre forme prégnante de l’alchimie reflétant davantage ses racines gréco-égyp- tiennes présumées, et enrobée dans un discours plus ésotérique et imagé aussi, philosophique et religieux. On y propose une alchimie mystique. Ce sont des spéculations philosophiques sur arrière-fond de cosmologie grecque et fortement teintée de la gnôsis néoplatonicienne. Sans être retenues entièrement par l’alchimie latine fortement aristotélicienne, elles auront proposé « un schéma d’interprétation » (on cite ici Tullio Gregory malheureusement sans citer la référence exacte) ainsi que des termes, des concepts, des légendes, des métaphores pérennes. Ce dernier chapitre montre l’étendue du travail d’A. Calvet sur la tradition manuscrite de ce premier corpus arabo- latin, rectifiant ici, montrant là les conclusions les plus importantes et les plus récentes de l’historiographie. Le troisième chapitre traite de l’alchimie latine et il est de loin le plus long (130 p. sur un total de 247 hors index et bibliographie) ce qui montre à la fois l’intérêt et le haut niveau d’expertise de l’a. qui a déjà abondamment publié sur le sujet. Pour autant, les informations précieuses que contient ce chapitre sont, pour beaucoup, tout à fait nouvelles sinon présentées à nouveau frais. Il est vrai que les études sont nombreuses mais elles n’avaient pas, depuis un certain temps, fait l’objet d’une synthèse. On y retrace chronologique- ment et, auteur par auteur, les débuts de l’alchimie dans l’Europe occidentale, son appropriation par les clercs au XIVe s., et la maturité qu’atteint la discipline dans les grands corpus pseudépigraphiques qui en ont donné le plus manifeste de ses legs médiévaux. Ces débuts coulés dans le creuset de l’aristotélisme émergent ont permis des accointances avec les studia generalia comme les studia mendiants. Si les premiers universitaires n’ont pas compté l’alchimie parmi les sciences élevées ou nobles, la quaestio de alchemica a dû être posée et débattue tandis que les ordres mendiants allaient devenir de fervents parti- sans de l’art (l’a. y reviendra plus loin). On analyse ici de façon exhaustive les premiers témoins : Michel Scot, Albert et le pseudo-Albert le Grand, Thomas d’Aquin (peu étudié pour sa contribution à la question de l’alchimie), Constantin de Pise et Roger Bacon, le docteur Mirabilis ayant laissé une contribution importante. Dans tous les cas, A. Calvet se prête à l’exercice salutaire de bien relier l’homme et son contexte à l’œuvre permettant de comprendre non seulement l’évolution des doctrines mais les réseaux qui les ont portées. On passe ensuite à la pièce de résistance que constitue l’œuvre du pseudo- Geber, identifié par William R. Newman au francis- cain Paul de Tarente (The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber, Leiden, Brill [Collection de travaux de l’Académie internationale d’histoire des sciences, 35], 1991). A. Calvet rapporte savoureusement les étapes de l’enquête minutieuse menée par celui-ci pour comprendre la valeur, la particularité et l’a. du corpus geberiarum. Un travail monumental d’édition et d’analyse qui a permis de montrer que la Somme du pseudo-Geber, pièce maîtresse de l’œuvre « jetait les bases d’une conception de la matière, dont le résultat le plus évident était d’extraire l’alchimie de uploads/Litterature/antoine-calvet-l-x27-alchimie-au-moyen-age.pdf
Documents similaires
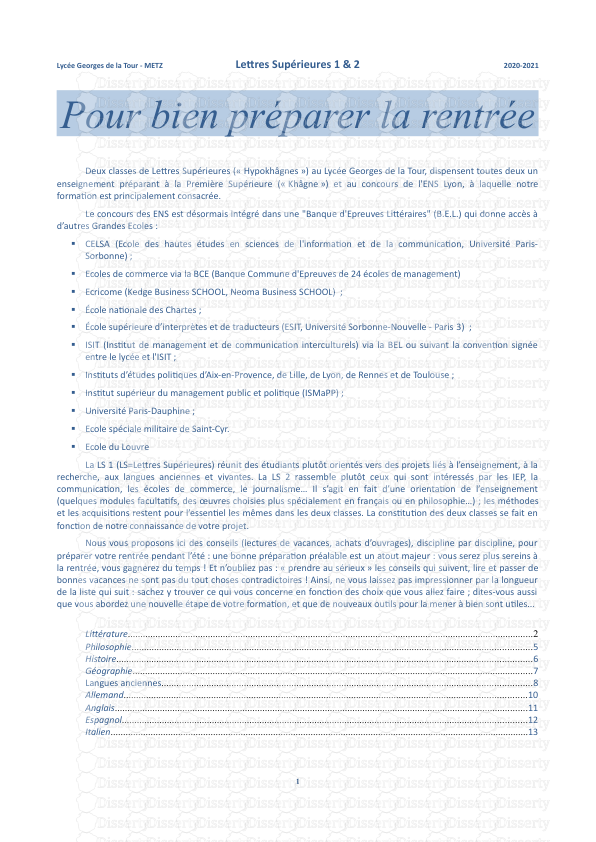









-
129
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7042MB


