DOSSIER PÉDAGOGIQUE L’Île des esclaves Marivaux mise en scène Gerold Schumann C
DOSSIER PÉDAGOGIQUE L’Île des esclaves Marivaux mise en scène Gerold Schumann Claire Cahen et Denis Ardant - L’Île des esclaves ©ERousseau 2 L’Île des esclaves de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux Arlequin Denis Ardant Euphrosine Anne-Sophie Bailly Iphicrate Vincent Bernard Trivelin Marc-Henri Boisse Cléanthis Claire Cahen Mise en scène Gerold Schumann Univers Sonore Bruno Bianchi Scénographie et Video Pascale Stih Costumes Pascale Stih et Chantal Joguet Création Lumières Philippe Lacombe Régie Générale Ydir Acef Construction décor Lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville Section Construction Coproduction Théâtre de la vallée Théâtre municipal d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) Château de La Roche-Guyon Le Théâtre de la vallée, en résidence à Écouen, est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Île-de-France), la Région Île-de-France et le Département du Val d’Oise. 3 Sommaire L’auteur Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux L’oeuvre de Marivaux La pièce L’intrigue Les personnages Les lieux Les emblèmes du pouvoir Le théâtre dans le théâtre Contexte historique Réception des différentes mises en scène La mise en scène du spectacle Note d’intention Eléments de mise en scène Critiques Pour aller plus loin Interventions en classe Le Théâtre de la vallée Contacts p. 4 p. 5 p. 7 p. 7 p. 9 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 14 p. 15 p. 18 p. 20 p. 21 p. 22 p. 23 4 L’auteur Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux naît le 4 février 1688 à Paris, dans une famille de petite noblesse. Son père travaille dans l’administration de la marine. Il est d’abord élève des Oratoriens. De 1710 à 1713, il est inscrit à la Faculté de droit de Paris. Il s’intéresse peu à ses études et préfère fréquenter le salon de Madame de Lambert et celui de Madame de Tancin. Il découvre la préciosité. En 1712, il publie son premier texte, Le Père prudent et équitable, ou Crispin l’heureux fourbe. En 1714, il prend parti pour les Modernes dans la querelle contre les Anciens. Marivaux écrit des romans parodiques, des poèmes, des chroniques journalistiques notamment dans le Nouveau Mercure. Il reprend les classiques pour mieux les détourner, comme L’Iliade Travestie en 1716. On considère Marivaux, moraliste reconnu, comme le nouveau La Bruyère. En 1717, son mariage avec Colombe Bollogne, fille d’un riche avocat, lui apporte l’aisance. Trois ans plus tard, ruiné par la banqueroute du banquier Law, il reprend ses études de droit et est reçu avocat au parlement de Paris. Mais il n’exerce pas vraiment ce métier et se consacre à l’écriture. Il connaît un premier succès théâtral avec Arlequin poli par l’amour en 1720. Impressionné par les comédiens italiens, il écrit pour eux plusieurs pièces de théâtre. Il édite également, jusqu’en 1724, 25 numéros du journal Le Spectateur françois, dont il est le seul rédacteur. Marivaux renouvelle la comédie avec Les Surprises de l’amour, La Double inconstance... Son théâtre reprend la devise de la comédie « castigat ridendo mores ». Par la suite, il se tourne vers la comédie philosophique, pour laquelle il a recours à des cadres utopiques. C’est l’époque de L’île des esclaves en 1725 et de la Nouvelle Colonie en 1729. Marivaux s’intéresse à la réalité sociale de son époque et publie le fruit d’un travail de quinze ans (1726-1741), La Vie de Marianne. En 1742, grâce à Madame de Tancin, il est élu à l’Académie Française. Malade depuis 1758, Marivaux meurt d’une pleurésie le 12 février 1763 à Paris. 5 L’oeuvre de Marivaux L’œuvre de Marivaux s’organise autour de la question de la sincérité, développée tout au long de sa carrière de dramaturge, de moraliste et de romancier. La plupart des comédies de Marivaux exploitent le thème du masque et du déguisement. Les intrigues multiplient les effets de miroir, les symétries et les renversements entre le monde des maîtres et le monde des serviteurs. L’essentiel de la dramaturgie de Marivaux interroge sur les jeux de l’être et du paraître, les pièges de la sincérité et ceux du mensonge. Les ruses du langage, de l’amour et de l’amour- propre, les subtiles dissertations sentimentales des personnages sont la matière même des intrigues de ses pièces. Par l’emploi qu’il fait des thèmes du déguisement et du masque, Marivaux se place dans la tradition italienne de la Commedia dell’arte et dans la tradition espagnole du romanesque baroque. Le masque joue dans son théâtre le rôle de révélateur. Marivaux est préoccupé, à travers le jeu même, par la recherche de la vérité. Le théâtre de Marivaux n’est pourtant pas celui d’un moraliste uniquement soucieux de dévoiler les moyens tactiques et stratégiques du désir amoureux ; il prolonge également une réflexion, déjà engagée dans son œuvre romanesque, sur des problèmes sociaux tels que la hiérarchie des conditions (L’île des esclaves, 1725), l’égalité des hommes et des femmes (La colonie, 1750) ou la distance sociale réelle ou fictive entre deux amants (La dispute, 1744). Sans doute est-ce pour ces raisons que les œuvres de cet auteur si typique du 18ème siècle ont gardé une telle actualité. Le marivaudage L’oeuvre de Marivaux est souvent qualifiée de « précieuse » en raison de la maîtrise des dialogues dont il fait preuve, tout en subtilité et légèreté, et de son ton badin pour décrire les tourments de l’amour naissant . Le terme de « marivaudage », par lequel on désigne désormais l’échange de propos galants et raffinés, renvoie à la manière légère qu’avait Marivaux de jouer sur le double sens des mots et d’utiliser les sentiments comme moteur de ses personnages. Avec le marivaudage, Marivaux renouvelle l’approche de la comédie au théâtre. Parmi ses pièces les plus marquantes, on peut citer : La Surprise de l’amour (1722) La Double Inconstance (1723) L’Île des esclaves (1725) La Seconde Surprise de l’amour (1727) Le Jeu de l’amour et du hasard (1730) Les Fausses Confidences (1737) 6 Vincent Bernard et Denis Ardant - L’Île des esclaves de Marivaux ©ERousseau 7 La pièce L’intrigue Sur une île grecque de fantaisie ou se sont établis des esclaves révoltés contre leurs maîtres, deux nobles d’Athènes, accompagnés chacun de leur valet, échouent après un naufrage. Sur l’île, une seule règle : tous les maîtres perdent leur liberté jusqu’à ce qu’ils comprennent les maux qu’ils ont fait subir à leurs esclaves. Quand aux domestiques, ils deviennent maîtres à leur tour... L’inversion des conditions maîtres - esclaves se fait sous forme d’un grand jeu de rôles, avec un maître de jeu, Trivelin, ancien esclave lui-même, une série de travestissements et de dialogues légers ouvrant sur des relations de séduction, de domination ou de soumission, et un dénouement «heureux», entre utopie et ironie... Gerold Schumann met en scène ce « petit bijou», comme l’appelait Beaumarchais, et l’ouvre vers notre présent. Les personnages Trivelin Ancien esclave, il détient l’autorité. Maître du jeu, il impose l’inversion des rôles pour donner « un cours d’humanité ». Il observe, intervient et prend les décisions. Iphicrate Jeune noble Athénien. Son nom signifie « qui gouverne par la force ». Maître dominateur, il peut frapper Arlequin, le menacer... Arlequin dit de lui qu’il est « étourdi », « honteux d’être sage, glorieux d’être fou ». Arlequin Esclave d’Iphicrate. Arlequin est un personnage de la Commedia dell’arte. Il aime boire, peut être insolent, sait manier la raillerie. Pourtant, il se montre sensible et fait preuve de générosité envers son maître. Euphrosine Jeune Athénienne. Son nom signifie « pleine de joie ». Elle mène une vie superficielle, aime séduire. Elle est présentée par Cléanthis comme « vaine, minaudière et coquette ». Cléanthis Servante d’Euphrosine. Son nom signifie « fleur glorieuse ». Elle est bavarde, sait observer sa maîtresse et rendre compte de ses défauts avec piquant. Elle veut prendre sa revanche et revendique l’égalité. 8 Comme souvent chez Marivaux, les couples maîtresse-suivante et maître-valet sont construits symétriquement. L’ordre de présentation des personnages dans la pièce en témoigne ; d’abord le duo Iphicrate/Arlequin, puis l’apparition de Trivelin et enfin le couple Euphrosine/Cléanthis. Cette construction installe le véritable sujet : une réflexion sur ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le subissent. Au cours de la pièce, les personnages évoluent, dissolvant et recréant d’autres couples : Euphrosine/Iphicrate ; réunis par leur mise à mal en tant que maîtres Cléanthis/Arlequin ; rassemblés par leur désir de vengeance et imitant les jeux de séduction de leurs patrons Euphrosine/Arlequin et Cléanthis/Iphicrate ; couples « contre-nature » dans une volonté des valets de transgresser les conditions sociales Si ces quatres protagonistes fonctionnent par duos, un personnage se démarque, c’est Trivelin. Gouverneur de cette nouvelle république, Trivelin est le garant des lois de l’île, chargé de ramener les maîtres à la raison. Il est aussi en quelque sorte le metteur en scène de toute l’expérience de rééducation des maîtres ; c’est lui qui explique la « cure », énonce les épreuves, distribue les rôles, oblige à changer de costumes et suscite les improvisations qui en découlent. C’est également Trivelin qui impose le rythme de la pièce. Il arrête Cléanthis dans son désir de vengeance, encadre ce qui uploads/Litterature/dpeda-liledesesclaves.pdf
Documents similaires



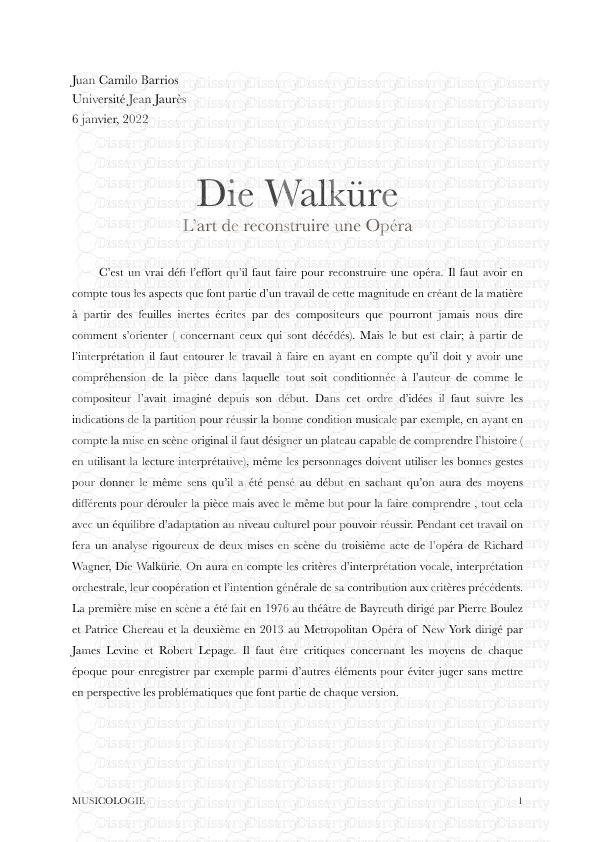






-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 24, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.6940MB


