Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Universit
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Hassiba Benbouali de Chlef Faculté de Technologie Département Electrotechnique Année universitaire : 2019/2020 Maintenance industrielle Cours IX TABLE DES MATIERES INTRODUCTION GENERALE……………………………………………..1 Chapitre I: Généralités sur la maintenance…………………………………3 I.1 Introduction…………………………………………………………………...4 I.2 Historique (concepts et terminologie normalisés ) …………………………...4 I.2.1 Définitions AFNOR et CEN de la maintenance………………………………4 I.2.2 Définitions de la maintenance selon l’AFNOR par la norme X 60-000……....5 I.2.3 Définition de la maintenance selon l’AFNOR par la norme NF X 60-010…...5 I.2.4 Définition de la maintenance selon Larousse………………………………....5 I.3 Rôle de la maintenance et du dépannage des équipements dans l’industrie ….5 I.4 Eléments de mathématiques appliquées à la maintenance …………………....6 I.5 Comportement du matériel en service ………………………………………..8 I.5.1 Qu’est-ce qu’un système ?.................................................................................8 I.5.2 Sûreté de fonctionnement……………………………………………………..9 I.5.3 Maintenabilité (Maintainability)……………………………………………...9 I.5.4 Disponibilité (Availability)…………………………………………………..11 I.5.5 Fiabilité (Reliability)………………………………………………………....12 I.5.6 Analyses FMD : indicateurs opérationnels………………………………......14 I.6 Taux de défaillance et lois de fiabilité……………………………………….15 I.6.1 Définition de défaillance…………………………………………………….15 I.6.2 Fonction de fiabilité R(t) – Fonction de défaillance F(t)…………………….16 I.6.3 Taux de défaillance instantané……………………………………………….17 I.6.4 Indicateurs de fiabilité (λ) et (MTBF)………………………………………..18 I.6.5 Temps moyen de bon fonctionnement……………………………………….18 I.6.6 Les différentes phases du cycle de vie d’un produit………………………….20 X I.6.7 Objectifs et intérêts de la fiabilité en mécanique……………………………..22 I.6.8 Evolution des coûts en fonction de la fiabilité………………………………..23 I.6.9 Fiabilité d’un système………………………………………………………...24 I.6.10 Lois de fiabilité……………………………………………..……………….28 I.7 Modèles de fiabilité …………………………………………………………..30 I.8 Les différentes formes de la maintenance…………………………………….30 I.8.1 Maintenance corrective……………………………………………………….31 I.8.2 Maintenance curative…………………………………………………………32 I.8.3 Maintenance palliative………………………………………………………..32 I.8.4 Maintenance préventive………………………………………………………32 I.9 Organisation d’entretien et de dépannage des équipements électriques……...33 I.10 Classification de la maintenance planifiée des équipements électriques……..34 I.10.1 Prioriser le déploiement de la maintenance planifiée…………….................35 I.10.2 Un exemple de classification…………………………...………...................37 Chapitre II: Organisation et gestion de la maintenance…………………39 II.1 Introduction…………………………………………………………………..40 II.2 Structure des ateliers spécialisés dans le dépannage des convertisseurs électromécaniques……………………………………………………………40 II.2.1 Définition…………………………………………………………………....40 II.2.2 Fonctions de l’atelier de maintenance………………………………………40 II.2.3 Étapes de conception d’un atelier de maintenance………………………….41 II.3 Organisation des opérations de maintenance………………………………...43 II.3.1 Les opérations de maintenance corrective…………………………………..43 II.3.2 Les opérations de maintenance préventive………………………………….44 II.3.3 Autres opérations……………………………………………………………45 II.4 Etapes principales de technologie de dépannage des machines électriques….46 II.4.1 Mise en évidence de la défaillance…………………………………..46 XI II.4.2 Analyse des risques…………………………………………………...46 II.4..3 Recherche de la chaine fonctionnelle……………………………………….47 II.4.4 Liste des maillons de la chaine………………………………………………47 II.4.5 Liste des modes de défaillances……………………………………………..48 II.4.6 Critères de test……………………………………………………………….48 II.4.7 Procédures de test……………………………………………………………48 II.4.8 Réparation…………………………………………………………………...49 II.4.9 Compte-rendu………………………………………………………………..49 II.5 Etude des différentes pannes des machines électriques et méthodes de leur détection………………………………………………………………………49 II.5.1 Défauts statoriques……………………………………………………50 II.5.2 Défauts rotoriques…………………………………………………….51 II.5.3 Méthodes de détection des pannes des machines électriques……….55 II.5.4 Propositions de causes possibles de pannes et des vérifications correspondantes……………………………………………………………..56 II.6 Technique de démontage et de remontage……………………………………58 II.6.1 Démontage : Méthodologie…………………………………………...58 II.6.2 Précautions ……...……………………………………………………60 II.6.3 Vocabulaire :………………………………………………………….61 II.7 Essais et diagnostics avant le dépannage……………………………………..63 II.7.1 Définitions relatives au diagnostic…………………………………...63 II.7.2 Méthodologie : les étapes d’un diagnostic…………………………...63 II.7.3 La méthode générale de diagnostic…………………………………..65 II.7.4 Exemple d’un diagnostic……………………………………………..67 Chapitre III: Dépannage des différentes parties des machines électriques. 69 III.1 Introduction...................................................................................................... 70 XII III.2 Dépannage de la partie mécanique et de la partie électrique d’une machine électrique …………………………………...………………………………...70 III.2.1 Analyse de l’état réel de l’équipement………………………………70 III.2.2 Exemple de dépannage de la partie mécanique/ électrique d’un moteur à courant continu……………………………………………………71 III.2.3 Exemple de dépannage de la partie mécanique/ électrique d’un moteur à courant alternatif…………………………………………………………..76 III.3 Travaux de montage et méthode d’essais après dépannage………..………...83 III.3.1 Démontage et remontage d’une machine asynchrone………………...83 III.3.2 Réparation et remplacement de composants………………………….85 III.3.3 Réglage de nouveaux paramètres……………………………………..85 III.3.4 Vérification du fonctionnement de l’équipement après dépannage…..86 Chapitre IV : Généralités sur la maintenance assistée par ordinateur (MAO) ................................................................................................................. 88 IV.1 Introduction .................................................................................................... 89 IV.2 Le modèle itératif de la gestion……………………………………………...89 IV.3 Application à la gestion du service maintenance ........................................... 89 IV.4 Qu’est-ce qu’un progiciel de GMAO ?...........................................................90 IV.4.1 Définition 1…………………………………………………………..90 IV.4.2 Définition 2…………………………………………………………..90 IV.4.3 Définition 3 ………………………………………………………….91 IV.5 Les progiciels de GMAO : analyse des différents modules fonctionnels…...91 IV.5.1 Module « gestion des équipements » ……………………………......92 IV.5.2 Module « gestion du suivi opérationnel des équipements »…………93 IV.5.3 Module « gestion des interventions »……………………………..…94 IV.5.4 Module « gestion du préventif »……………………………………..94 IV.5.5 Module « gestion des stocks »……………………………………….94 XIII IV.5.6 Module « gestion des approvisionnements et des achats »………….95 IV.5.7 Module « analyses des défaillances »………………………………..96 IV.5.8 Module « budget et le suivi des dépenses »………………………….96 IV.5.9 Module « gestion des ressources humaines »……………………….97 IV.5.10 Module « tableaux de bord et statistiques »………………………...97 IV.5.11 Modules complémentaires ou interfaçages utiles…………………..97 IV.6 Panorama des solutions GMAO (présentation générale ou vue générale)….98 IV.7 Les types de GMAO………………………………………………………..98 IV.8 Installation d'une GMAO…………………………………………………..99 IV.9 Réussite d'une GMAO……………………………………………………...99 IV.10 Elaboration d’un plan GMAO………………………………………………99 IV.11 Le choix d’un outil GMAO bien adapté…………………………………..101 IV.12 Caractéristiques générales ………………………………………………...101 IV.13 Avantages de GAMO ………………………………………………….….102 XIV INTRODUCTION GENERALE 1 INTRODUCTION GENERALE En deux décennies, le développement de l’automatisation des systèmes de production a réduit de façon spectaculaire les emplois dans l’industrie. Les machines d’aujourd’hui produisent à la place des hommes et les usines fabriquent plus et mieux en 2017 qu’en 1980, avec des effectifs en constante diminution [1]. Le cycle de vie d'un composant générique dans un système de production est d'abord caractérisé par des périodes de disponibilité lorsque l'élément fonctionne correctement, i. e., dans des conditions nominales, deuxièmement par des périodes de temps où il fonctionne mais pas comme prévu dans les conditions, et troisièmement par des périodes où il cesse complètement de fonctionner en raison d'une panne se produisant et les réparations subséquentes devant encore être accomplies [2]. Pour ces raisons l’exécution de la maintenance dans une entreprise industrielle est d’une importance capitale pour maintenir les équipements en état de bon fonctionnement. La maintenance, dans sa plus large définition, est l’ensemble de toutes les opérations de gestion, de programmation et d’exécution. Le calcul de la fiabilité d’un équipement constitue un outil incontournable pour évaluer l’efficacité de n’importe quelle entité. Les concepteurs et les utilisateurs sont souvent confrontés à des contraintes par pauvreté ou par manque de modèles permettant de faire des études prévisionnelles correctes. Le taux de défaillance est souvent considéré comme constant ce qui est manifestement faux en mécanique d’où l’intérêt d’outils, de modèles ou de méthodes plus adaptées. Ainsi, le choix d’une loi de comportement du matériel (calcul de la fiabilité) devient une tache très compliquée. Le présent polycopié s’adresse aux étudiants de licence de l’option génie électrique, poursuivant leur formation. La conduite du calcul est conditionnée par le choix convenable d’une loi de fiabilité décrivant le comportement des différents composants constituants une entité. Le but de la maintenance c’est de mettre en œuvre les objectifs (coûts, délai, qualité, etc.) fixés par la direction de production en tenant compte des événements (perturbations, aléas, etc.) de l’environnement. La stratégie de la maintenance est l’ensemble des décisions qui conduisent : • à définir le portefeuille d’activités de la production de maintenance, c'est-à-dire, à décider des politiques de maintenance des matériels (méthodes correctives, préventives, amélioratives à appliquer à chaque matériel). INTRODUCTION GENERALE 2 • et, conjointement, à organiser structurellement le système de conduite et les ressources productives pour y parvenir dans le cadre de la mission impartie (objectifs techniques, économiques et humains). Enfin les objectifs assignés aux activités de maintenance peuvent inclure des indicateurs clés de performance telle que la fiabilité, la disponibilité, le délai moyen de réparation, le nombre de défaillances, et les coûts d'entretien. Par conséquent, certains objectifs illustratifs sont les suivants : améliorer la disponibilité, préserver la santé, la sécurité et la préservation de l'environnement et réduire les coûts de maintenance. CHAPITRE I Généralités sur la maintenance CHAPITRE I. Généralités sur la maintenance 4 I.1. Introduction Pour être et demeurer compétitive, une entreprise doit produire toujours mieux (qualité) et au coût le plus bas. Pour minimiser ce coût, on fabrique plus vite et sans interruption des produits sans défaut afin d’atteindre la production maxi male par unité de temps. Cet objectif est un des buts de la fonction maintenance d’une entreprise. Il s’agit de maintenir un bien dans un état lui permettant de répondre de façon optimale à sa fonction. Ce chapitre examine les définitions fondamentales concernant la maintenance et le rôle de cette dernière dans l’industrie. Ensuite L'accent est mis sur l'intégration d’éléments mathématiques dans la maintenance pour évaluer le comportement du matériel en service. I.2. Historique (concepts et terminologie normalisés) Le terme « maintenance », forgé sur les racines latines manus et tenere, est apparu dans la langue française au XII siècle. L’étymologiste Wace a trouvé la forme mainteneor (celui qui soutient), utilisée en 1169 : c’est une forme archaïque de « mainteneur ». Anecdotiquement, c’est avec plaisir que j’ai retrouvé l’usage du mot « maintenance » sous la plume de François Rabelais, qui, vers 1533, parlait de la « maintenance de la loy » dans Pantagruel. Les utilisations anglo-saxonnes du terme sont donc postérieures. À l’époque moderne, le mot est réapparu dans le vocabulaire militaire : « maintien dans des unités de combat, de l’effectif et du matériel à un niveau constant ». Définition intéressante, puisque l’industrie l’a reprise à son compte en l’adaptant aux unités de production affectées à un « combat économique » [1]. I.2.1. Définitions AFNOR et CEN de la uploads/Management/ cours-maintenace-industrielle1.pdf
Documents similaires









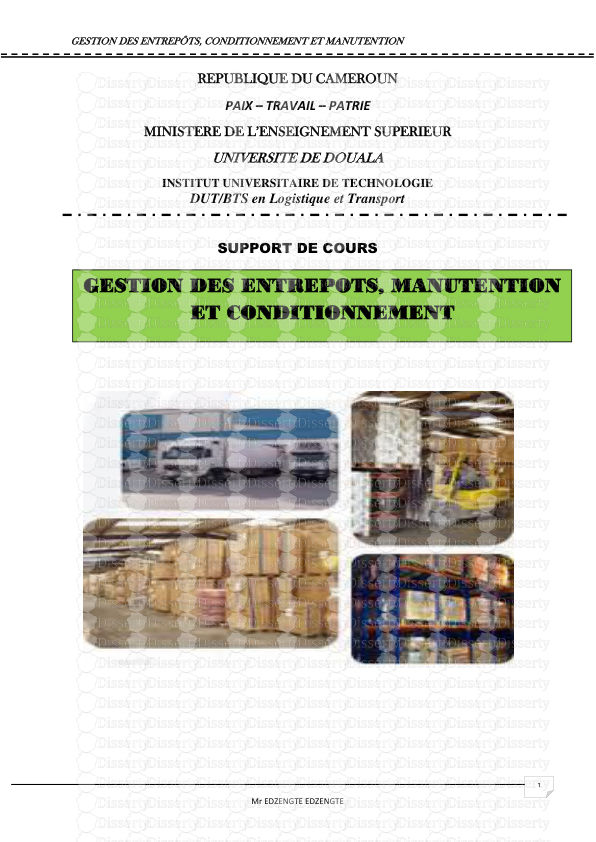
-
95
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 21, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 5.9968MB


