Utilitarisme pragmatique et reconnaissance d’intention dans les actes de langag
Utilitarisme pragmatique et reconnaissance d’intention dans les actes de langage indirects∗ Éric Raufaste1,2, Dominique Longin2,1 Jean-François Bonnefon1,2 1-Laboratoire Travail et Cognition (UMR 5551) Université de Toulouse-Le-Mirail (Toulouse II) 2-Institut de Recherches en Informatique de Toulouse (UMR 5501) Université Paul Sabatier (Toulouse III) Résumé : Après un rappel sur les actes de langage indirects et le traitement classique de ce problème, nous proposons une approche utilitariste de la reconnaissance d’intention dans le langage verbal. Cette approche combine une « heuristique utilitariste » basée sur la distribution d’utilité du locuteur, inférée à partir du contexte, et une « heuristique conventionnaliste » basée sur la reconnaissance de propriétés spécifiques de l’énoncé cible. Cette approche est mise en perspective avec d’autres approches récentes de la litté- rature en sciences cognitives. Mots-clés : reconnaissance d’intention, actes de langage, pertinence, heuristiques, com- préhension. Abstract: The so-called “standard pragmatic view” of intention recognition in indirect speech acts was largely disconfirmed by psycholinguistic research (Gibbs, 1994). We propose a utilitarianist approach to pragmatics. Basically, the framework proposed here assumes that both utterance production and intention recognition can be viewed as a de- cision-making problem using subjective expected utility. We assume that, as part of the standard equipment of a normal adult’s theory of mind, is included the idea that individuals act so as to maximize their well-being while minimizing suffering. We then define the idea of utilitarian context as a collection of contextual elements that provide information about the speaker’s distribution of utility over the possible behavioral responses of the listener. Hence, the utilitarian context en- ables the listener building a representation of the speaker’s distribution of utility. For the listener, using the utilitarian heuristic consists of attributing the intent to obtain the state of the world that presumably maximizes the speaker’s expected utility. In some neutral contexts, however, the distribution of utility cannot be built and therefore, the utilitarian heuristic cannot be used. In such cases, the speaker may recognize a form of indirection in the utterance, form that is conventionally associated with a specific intent. The listener uses the conventionalist heuristic when attributing the intent that is conventionally asso- ciated with that particular form of indirection. We present the notion of “indirection schemes” defined as logical rules that select (1) the intent conventionally associated with the form of indirection of the focal utterance, or (2) the intent with the maximum ex- pected utility to the meaning of the focal utterance. ∗ Ce travail a été soutenu financièrement par le Programme Interdisciplinaire TCAN. Finally, our approach is contrasted with other approaches to intention recognition that have been used in cognitive science. Keywords: intention recognition, speech acts, relevance, heuristics, understanding. Introduction Cet article concerne les processus de reconnaissance de l’intention sous-jacente à la production d’un énoncé isolé. Nous ne traiterons pas de l’ensemble des processus de l’interlocution, ce qui impliquerait de modé- liser la négociation des enjeux de la communication (voir Trognon & Ghiglione, 1993), la gestion des tours de parole, etc. Nous ne traiterons pas non plus des aspects paraverbaux comme l’utilisation de la prosodie. La notion d’acte de langage (« speech act ») remonte à Austin (1962). Rompant avec le courant positiviste du langage qui considérait que les seuls énoncés bien formés étaient les propositions vraies ou fausses (les autres énoncés étant qualifiés de « pseudo-affirmations » ou « non- sens »), Austin constate qu’une bonne part de ces « non-sens » ne sont pas des pseudo-affirmations pour la simple raison… qu’elles n’ont jamais été destinées à être des affirmations ! Austin distingue alors les constatifs (les affirmations) des non-sens, et de ce qu’il appelle alors les performatifs, dont la caractéristique est de viser à faire quelque chose (baptiser, marier, ouvrir une séance…). En ce sens, dire, c’est faire, ce qui le pousse à dres- ser une taxinomie de ce qu’il appelle « actes illocutoires », i.e. les actes produits en disant quelque chose, et consistant à rendre manifeste com- ment les paroles doivent être comprises au moment de l’énonciation). Searle (1969) va montrer la faiblesse de la taxinomie d’Austin et en proposer une nouvelle (qui est celle que nous utilisons présentement) dé- terminée par le but illocutoire des énoncés. Ce but partitionne les énoncés en cinq types d’actes de langage1. Le but assertif est d’affirmer la véracité d’une proposition. Le but commissif détermine un engagement du locu- teur vis-à-vis de l’auditeur à faire quelque chose. Le but directif vise à faire faire quelque chose à l’auditeur. Le but expressif est de communi- quer des informations sur l’état psychologique du locuteur. Enfin le but déclaratif vise à accomplir des transformations du monde social par le seul fait de l’énonciation2. Dans le présent article, nous considérerons es- sentiellement les actes directifs (i.e. à but illocutoire directif). Nous appelons « acte principal » l’acte que le locuteur chercher à ac- complir de manière ultime. Parfois, l’acte principal correspond à l’acte littéral (i.e. l’acte accompli en interprétant littéralement ce qui est dit), parfois non. Par exemple, dans « Peux-tu me passer le sel ? » l’acte litté- ral correspond à une question dont la réponse attendue est « oui » ou « non ». Mais en disant cela dans certains contextes (par exemple, à ta- ble), le locuteur peut avoir l’intention de signifier « Passe-moi le sel ». Dans ce contexte, l’acte principal est donc cet acte-ci. Quand l’acte principal ne correspond pas à l’acte littéral, on parle « d’acte indirect ». Dans l’exemple précédent, si l’intention du locuteur est d’obtenir le sel, il a indirectement demandé à l’auditeur de lui passer le sel (en lui demandant s’il pouvait le lui passer). Le locuteur a donc, dans ce contexte, réalisé un acte directif indirect.3 1. L’approche classique de l’attribution d’intention Le « modèle pragmatique standard » (Gibbs, 1994) repose sur l’idée du « principe de coopération » (Grice, 1975, 1978). Selon Grice, les interlo- cuteurs coopératifs adhèrent, et s’attendent à ce que les autres adhèrent, à 1 Nous assimilons ici, comme il est fréquent, actes illocutoires et actes de langage. 2 Les « performatifs » initialement identifiés par Austin. 3 En fait, la communication non littérale ne se borne pas à la communication indi- recte, mais nous n’étudions pour l’instant qu’elle (même si nous pensons que notre mo- dèle est compatible avec les autres formes de communication non littérale). Voir l’article de Longin dans le présent ouvrage pour plus de détails. quatre « maximes conversationnelles » : il faut transmettre ni trop ni trop peu d’information (maxime de quantité), que cette information soit fiable (maxime de qualité), pertinente (maxime de relation), exprimée claire- ment et sans ambiguïté (maxime de manière). Une violation de maxime traduit la volonté de transmettre indirectement une information. L’auditeur déclenche alors un processus d’inférence (Grice, 1975) afin de déterminer l’intention réelle du locuteur. Ce principe implique (1) que l’interprétation du sens littéral est obligatoire ; (2) que le sens non littéral n’est recherché qu’en cas de découverte d’un sens littéral défectif ; (3) que des inférences additionnelles sont ensuite réalisées pour atteindre le sens non littéral. Dans la pratique, le modèle standard est battu en brèche par de nombreux résultats expérimentaux qui montrent, entre autres, que dans la compréhension des requêtes indirectes on n’accède pas toujours au sens littéral (Gibbs, 1983) ; ou encore qu’on peut accéder au sens non littéral alors même que le sens littéral est parfaitement acceptable (i.e. non défectif) dans le contexte (Glucksberg, Gildea, & Bookin, 1982). Selon Sadock (2004), on peut observer dans le développement de la théorie des actes de langage un mouvement de balancier entre des appro- ches que nous qualifierons ici de « conventionnalistes » et d’autres que nous appellerons « intentionnalistes ». Les premières, à commencer par Austin (1962) et Searle (1969), mettent l’accent sur le côté conventionnel de la relation entre actes locutoires et illocutoires. Les secondes (e.g., Grice, 1989; Strawson, 1971) mettent l’accent sur le rôle de l’intention suggérée par le locuteur. Ainsi, rejetant l’idée que les conventions puis- sent traiter seules l’ensemble du problème, Grice (1957, 1989) a introduit l’idée que les conventions ne sont pas tant déterminantes que les inten- tions que le locuteur rend manifestes à son auditoire. Par exemple, l’énoncé « il fait chaud » dans une salle où la fenêtre est fermée peut être interprété comme une requête indirecte pour que quelqu’un ouvre la fenê- tre. Mais rien dans la forme linguistique de l’énoncé ne permet d’inférer cette intention. Autrement dit, l’énoncé n’est pas directement porteur du sens mais fait partie d’un ensemble d’indices permettant à l’auditoire d’accéder à l’intention sous-jacente. En résumé, l’approche conventionna- liste met l’accent sur les propriétés syntaxico-sémantiques de l’énoncé tandis que l’approche intentionnaliste met l’accent sur l’apport informa- tionnel des contextes linguistique et extralinguistique. 2. L’approche utilitariste de la reconnaissance d’intention De notre point de vue, l’opposition entre les approches conventionna- liste et intentionnaliste témoigne en fait d’une complémentarité. Ainsi, dans le cadre de la théorie de la pertinence, Sperber et Wilson (1989) énoncent que : « On peut diviser les hypothèses qui se uploads/Management/2006-utilitarisme-pragmatique-et-reconnaissance-d-x27-intention-dans-les-actes-de-langage-indirects.pdf
Documents similaires


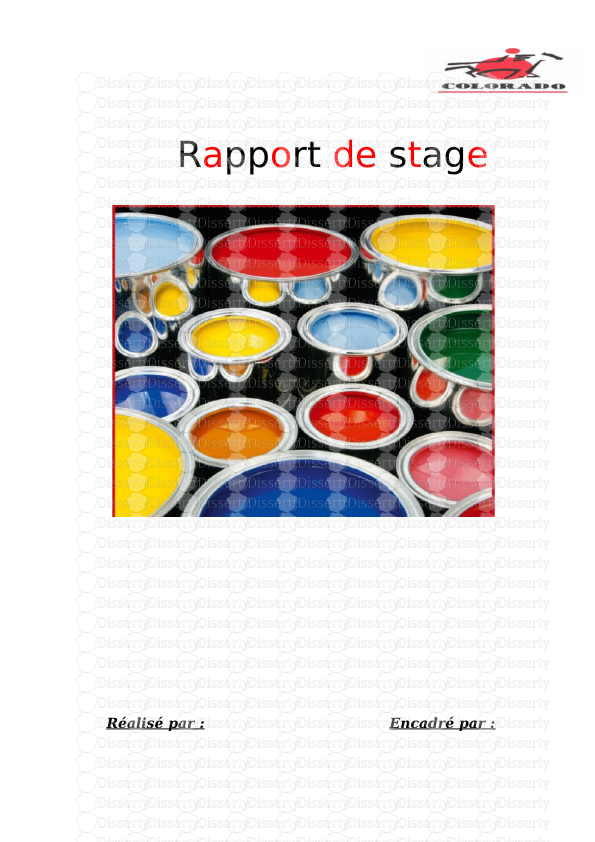







-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 22, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.2243MB


