LES LOIS DE LA NATURE À L’ÂGE CLASSIQUE LA QUESTION TERMINOLOGIQUE Sophie ROUX
LES LOIS DE LA NATURE À L’ÂGE CLASSIQUE LA QUESTION TERMINOLOGIQUE Sophie ROUX RÉSUMÉ : Quatre propositions relatives aux lois de la nature à l’âge classique doivent être distinguées. 1. Certaines régularités dans les phénomènes ont été décou- vertes. 2. Un concept de loi a émergé. 3. La science classique se caractérise par l’instauration de l’idée de légalité de la nature. 4. De nouveaux usages du mot « loi » sont apparus dans les textes scientifiques. Cet article est uniquement consacré à l’analyse de la quatrième et dernière de ces propositions, autrement dit à un pro- blème terminologique. Dans un premier temps, il procède à la description des usages sémantiques du mot « loi » qui ont pu contribuer à la constitution de son sens classique : usage spécifique, usage disciplinaire, usage physique, usage mathéma- tique, usage métaphysique. Dans un second temps, il analyse les différents moments de la diffusion de ce mot dans les sciences au XVIIe siècle. La thèse générale soute- nue est finalement que, si le terme « loi » a bien été utilisé dans les sciences sans référence à un Dieu législateur avant le XVIIe siècle, seule cette référence, autrement dit la rencontre entre l’usage physique et l’usage métaphysique, a permis sa généra- lisation dans le tournant du XVIIe siècle au XVIIIe siècle. MOTS-CLÉS : loi, loi de la nature, terminologie scientifique, sémantique historique, physique classique. ABSTRACT : Four propositions relative to the laws of nature in the classical period must be noted. 1. Certain regularities in phenomena had been discovered. 2. A concept of law had emerged. 3. Classical science is characterized by the introduc- tion of the notion of the legality of nature. 4. New uses of the word « law » had appeared in scientific texts. This article is devoted to the analysis of only this last proposition, that is to say to a terminological problem. First we will describe the semantic uses of the word « law » that may have contributed to the constitution of its classical meaning : its specific usage, disciplinary usage, usage in physics, in mathematics, in metaphysics. Second we will analyze the various moments of the diffusion of the word in the sciences in the XVIIth century. The general thesis defended in the end is that if the term « law » had indeed been used in science with no refe- rence to a law-giving God prior to the XVIIth century, only this reference, that is, the coming together of its physical and its metaphysical usage, allowed its generaliza- tion in the period between the XVIIth and XVIIIth centuries. KEYWORDS : law, law of nature, scientific terminology, semantic history, classical physics. Revue de synthèse : 4e sér., nos 2-3-4, avr.-déc. 2001, p. 531-576. 532 REVUE DE SYNTHÈSE : 4e SÉR., Nos 2-3-4, AVRIL-DÉCEMBRE 2001 ZUSAMMENFASSUNG : Mit Hinblick auf den Begriff des Naturgesetzes in der « klas- sischen Periode » der modernen Wissenschaften müssen vier Aussagen unterschie- den werden. 1. Es wurden bestimmte Regelmäßigkeiten der Erscheinungen entdeckt. 2. Ein Gesetzeskonzept hat sich herausgebildet. 3. Die klassische Wissenschaft zeichnet sich durch die Einführung der Idee der Gesetzmäßigkeit der Natur aus. 4. In wissenschaftlichen Texten wurde das Wort « Gesetz » auf neue Weisen ver- wendet. Der vorliegende Aufsatz ist ausschließlich der letzten Frage gewidmet, also einem terminologischen Problem. In einem ersten Schritt geht es um die Beschrei- bung der semantischen Verwendungsweisen des Wortes « Gesetz », die man als konstitutiv für seine klassische Bedeutung ansehen kann : spezifischer, disziplinärer, physikalischer und mathematischer Gebrauch. In einem zweiten Schritt werden die unterschiedlichen Aspekte der Verbreitung dieses Wortes in den Wissenschaften des 17. Jahrhunderts untersucht. Letztlich wird die allgemeine These vertreten, daß der Gesetzesterm, wenngleich er in den Wissenschaften vor dem 17. Jahrhundert ohne Bezugnahme auf einen göttlichen Gesetzgeber verwendet wurde, es doch allein die- ser Bezug war oder, in anderen Worten, das Aufeinandertreffen von physikalischem und metaphysischem Gebrauch, der seine Verallgemeinerung am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert ermöglicht hat. STICHWÖRTER : Gesetz, Naturgesetz, wissenschaftliche Terminologie, historische Semantik, klassische Physik. Sophie ROUX, née en 1965, ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de philo- sophie, docteur en histoire des sciences, est actuellement chercheur au centre Alexandre-Koyré (Paris). Ses travaux portent sur la philosophie et les sciences à l’âge classique, en particulier sur les mécaniques. Adresse : Centre Alexandre-Koyré, Muséum national d’histoire naturelle, Pavillon Chevreul, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris Cedex 05. Courrier électronique : sophie.roux@damesme.cnrs.fr S. ROUX : LES LOIS DE LA NATURE À L’ÂGE CLASSIQUE 533 1. Cet article est l’un des fruits d’une enquête que j’ai entreprise pour un groupe de travail animé par Lorraine Daston et Michael Stolleis. Ce groupe doit prochainement publier un recueil sur la notion de loi dans les sciences, le droit et la théologie à l’époque moderne; quant aux autres fruits de mon enquête, il s’agit de deux articles, l’un sur le concept de loi de la nature chez Descartes, l’autre sur la notion de loi de la nature dans les polémiques de la fin du XVIIe siècle : j’espère être en mesure de les publier prochainement. Je remercie Catherine Goldstein, Ian Mclean et Friedrich Steinle pour avoir lu ce texte et m’avoir aidée à l’amender. Lorsque je ne donne aucune référence à propos de la traduction d’un texte écrit dans une autre langue que le français, je suis responsable de la traduction proposée. Je modernise l’ortho- graphe des textes cités. 2. Ces articles sont à ma connaissance les suivants : ZILSEL, 1942a; NEEDHAM, 1951; OAKLEY, 1961a et 1961b; CASINI, 1976; MILTON, 1981; RUBY, 1986; STEINLE, 1995; CHEVAL- LEY, 1995; MILTON, 1998. 3. Dans cet article, « science » peut se rapporter à l’effort de compréhension systématique du monde physique qu’était la « philosophie naturelle », mais aussi à des parties des mathé- matiques mixtes comme l’optique ou l’astronomie, voire occasionnellement à la médecine; il en est de même pour les adjectifs « scientifique » ou « physique » et les noms « savant », « physicien » ou « philosophe naturel ». « Classique » ou « moderne », employés indifférem- ment, se réfèrent à la science qui s’élabore en Europe au XVIIe siècle, avec parfois quelques incursions au XVIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. « Qualibet data quaestione, imprimis enitendum est, ut dis- tincte intelligamus, quid quaeratur. » DESCARTES, Regulae ad directionem ingenii, regula XIII. LA QUESTION 1 Chez tous les historiens qui ont consacré un article à la notion de loi de la nature dans les sciences au XVIIe siècle 2, un même étonnement affleure : comment se fait-il qu’une notion aussi fondamentale ait suscité si peu d’études? Le soupçon peut cependant naître que ce petit nombre d’études ne soit pas sans raison : peut-être le problème est-il mal posé, peut-être met-il en œuvre des entités mal définies, peut-être recouvre-t-il plusieurs questions qu’il convient de distinguer. Et d’ailleurs, la notion de loi de la nature constitue-t-elle vraiment un objet d’enquête naturel pour l’historien de la physique classique 3? Les savants des XVIe et XVIIe siècles pensent que la manière dont ils conçoivent la nature et la philosophie naturelle n’a rien à voir avec celle des scolastiques ou des philosophes de la nature du XVIe siècle, mais ils ne caractérisent cette rupture ni par la découverte d’un concept de loi, ni par l’instauration de l’idée que la nature est gouvernée et constituée par des lois. Ils préfèrent opposer la philosophie des choses mêmes à une philosophie purement verbale, l’explication mécanique des phénomènes à l’invocation incantatoire de formes substantielles et de 534 REVUE DE SYNTHÈSE : 4e SÉR., Nos 2-3-4, AVRIL-DÉCEMBRE 2001 4. Sur cette première voie, voir, p. ex., CASINI, 1976 et DUFOUR, 1980. 5. Que l’on prenne « idéologie » au sens défini dans l’article de Georges CANGUILHEM, « Qu’est-ce qu’une idéologie scientifique? », in Idéologie et rationalité, Paris, Vrin, 1993, ou au sens classique du terme — comme le remarquait plaisamment l’abbé Gabriel BONNOT DE MABLY à propos de l’Ordre naturel et essentiel de Le Mercier de La Rivière, in Doutes propo- sés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, in Œuvres complètes de l’abbé de Mably, Londres, 1789, t. XI, p. 33 : « Au lieu de l’ordre essen- tiel de la nature, je crains bien qu’on ne nous donne ici que l’ordre naturel de l’avarice, de la cupidité et de la sottise. » 6. OAKLEY, 1961a, p. 433, et OAKLEY, 1961b, p. 78-79, reprend l’opposition de Robin George Collingwood entre la Nature des Grecs et la Nature de la Renaissance. Pour MILTON, formes occultes, l’analyse mathématique à la recherche des essences. En ce sens, l’historien ne sait pas d’emblée où la notion de loi de la nature opère, ni même si elle est opérante; aussi en viendra-t-il rapidement à égrener un chapelet de questions et de doutes. Pourquoi recourir à une métaphore d’origine théologico-politique pour désigner les régularités ou les principes que la science découvre dans la nature? Le terme « loi » est-il fréquent dans les textes de la science uploads/Philosophie/ les-lois-de-la-nature-a-lage-classique-l.pdf
Documents similaires






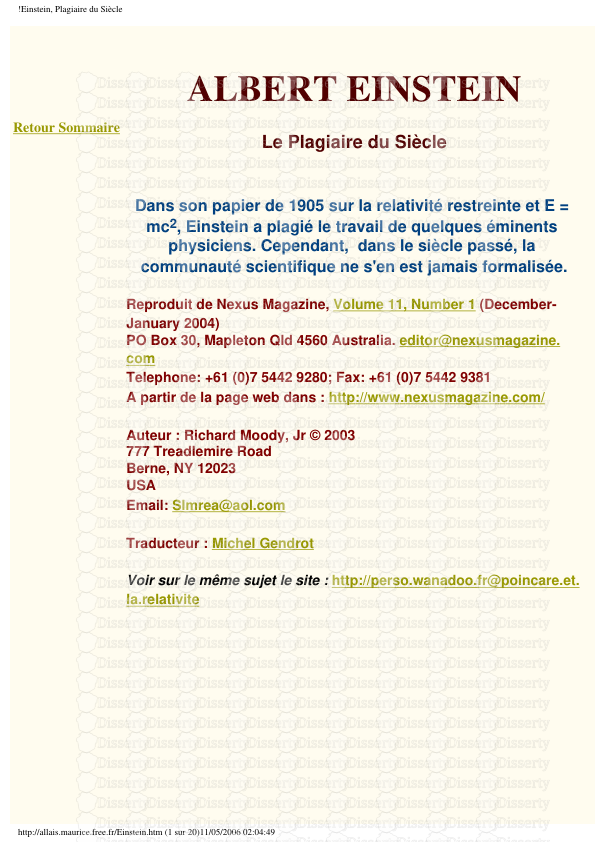



-
227
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 29, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2359MB


