Revue Philosophique de Louvain De la divinisation à la domination : Étude sur l
Revue Philosophique de Louvain De la divinisation à la domination : Étude sur la sémantique de capable/capax chez Descartes Jean-Luc Marion Abstract Setting out from the information provided by the automatic indexation of certain French texts by Descartes, a comparison is made between the occurrences of the item capable and those of their respective Latin translations. One observes that often capable allows of an « active » semantic in Descartes, completely foreign to the « passive » semantic of capax ; hence the recourse of translators to metaphors and substitutions. Inquiring into the semantic reversal thus discovered, the attempt is made to understand it in relation to the definition of man in the theologians of the 16th century, no longer as capax Dei, but as endowed with a power by his nature alone. Résumé À partir des informations fournies par l'indexation automatique de certains textes français de Descartes, on y compare les occurrences de l'item capable avec celles de leurs traductions latines respectives. On constate que, souvent, capable admet chez Descartes une sémantique « active », complètement étrangère à celle, « passive », de capax ; d'où le recours par les traducteurs à des métaphores ou des substitutions. S'interrogeant sur le renversement sémantique ainsi repéré, on tente de le comprendre en relation avec la définition, chez les théologiens du XVIe siècle, de l'homme, non plus comme capax Dei, mais comme doué d'un pouvoir de par sa nature seule. Citer ce document / Cite this document : Marion Jean-Luc. De la divinisation à la domination : Étude sur la sémantique de capable/capax chez Descartes. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 73, n°18, 1975. pp. 263-293. doi : 10.3406/phlou.1975.5837 http://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1975_num_73_18_5837 Document généré le 24/09/2015 De la divinisation à la domination : Étude sur la sémantique de capable /capax chez Descartes A H. de Lubac. § 1. Élaboration de la question Les entreprises contemporaines pour constituer, avec l'aide de moyens techniques puissants (ordinateurs), des indices de corpus philosophique, soulèvent un constant paradoxe. Autant leur élaboration progresse rapidement, autant l'utilisation des informations ainsi disponibles reste-t-elle en butte à de grandes difficultés. Fréquences relatives, ou absolues, co-occurrences, recherche des hapax, longueur de phrases, redondance lexicale, etc., tous ces paramètres d« calcul ne peuvent suffire à construire la question proprement philosophique, qu'ils servent seulement. Le dernier mot reste au chercheur puisque lui seul peut faire jouer philosophiquement le complexe d'informations, où se réduit tel ou tel texte, philosophique ou supposé tel (1). — Le travail d'indexation du corpus cartésien par l'Équipe Descartes (Paris), n'échappe pas à ces difficultés et ambiguïtés (2). Pour transgresser l'insignifiance, même rigoureusement quantifiée, jusqu'à une interrogation authentiquement conceptuelle, plusieurs procédés se présentent. Deux d'entre eux sont assez fréquemment utilisés. Premièrement, la mise en place (par indexation exhaustive) d'un réseau de signifiants, qui permettent, outre un lexique raisonné, la constitution rigoureuse (!) Sur ces questions, on pourra consulter la Revue Internationale de Philosophie, 1973/1, n° 103, sur « Études philosophiques et informatiques», dont notre contribution « À propos de la sémantique de la méthode » (pp. 37-48) sur le Discours de la Méthode. (2) Pour un état de ses travaux d'indexation du corpus cartésien, voir « Bulletin Cartésien III», in Archives de Philosophie, 1974/3, la contribution de J.-R. Armogathb, pp. 453 ss. — et aussi Computers and Humanities, mai 1971, vol. 5, New York, p. 315, *P12. 264 Jean-Luc Marion de l'état synchronique des signifiés correspondants — analyse sémantique ; dans ce cas, le texte d'expérimentation renvoit à un unique discours, dont on inventorie l'architecture sémantique (D = t). Deuxièmement, la mise en évidence de l'évolution diachronique d'un corpus de signifiés, par repérage des apparitions, disparitions et substitutions de certains signifiants dans un même texte ; lequel recèle alors plusieurs discours, dont les écarts, sur ce terrain commun, deviennent visibles (D1 -f- D2 + D3 + ... Dn = t) (3). Reste une autre manière de repérer les écarts significatifs, que nous tenterons ici d'appliquer : étudier le rapport de superposition, ou non, entre les deux signifiants, supposés se correspondre, dans deux textes supposés équivalents : ainsi dans le texte français d'un discours, et son texte latin (sa traduction, donc), un même réseau conceptuel (les signifiés du philosophe) est censé se donner à lire dans deux textes, deux syntaxes, deux lexiques de signifiants (D es ti + £2). La traduction ne peut, à moins de translitération, éviter la réinterprétation par un système d'équivalences. Celles-ci permettent une manière de définition opératoire des concepts, indépendants des signifiants de tel ou tel texte : d'abord parce que l'un peut se substituer à l'autre, en passant du texte ti au texte t2-, ensuite, parce que l'équivalence ne réunit pas ces signifiants sans quelque modification de l'un, ou de l'autre, pour l'accorder au concept; dans ce cas, l'accord d'équivalence sémantique des signifiants suppose, par là même, l'écart de l'un ou (et) l'autre avec la sémantique « naturelle» de son signifié commun; cet écart sémantique se décèle au vu de l'écart syntaxique qu'impose au signifiant le concept signifié, que l'équivalence (traduction) lui désigne. Ici, le latin doit réformer la syntaxe de certains signifiants pour que ceux-ci signifient précisément le signifié qu'impose le français ; car le signifiant français ainsi traduit reste dépositaire d'un signifié lui-même modifié — parce que pensé conceptuellement par le philosophe. En un mot, l'écart syntaxique du signifiant latin avec la latinité « correcte » mesure l'écart sémantique qu'impose le signifié français à traduire, — mais l'équivalence ainsi obtenue transpose l'écart sémantique inscrit dans le concept (3) Voir la tentative de A. Robinet, et des « philogrammes » dégagés des variantes, d'édition en édition, du texte de Malebrache, particulièrement dans « Malebranche et Leibniz à l'ordinateur : de PIM 71 à MON ADO 72 », in Revue Internationale de Philosophie, loc. cit., pp. 49-56; et« Hypothèse et Confirmation en Histoire de la Philosophie », in Revue Internationale de Philosophie, 1971/1-2, pp. 119-146. Sémantique de capable /capax chez Descartes 265 lui-même, qui réformait déjà le signifié français. Le concept à penser se dégage par cette double opération, qui le définit (4). À ce cadre vide, correspond une question définie. — La sémantique de capable \ capacité demeure, au XVIème siècle, celle d'une contenance, parfaitement réceptrice, et donc passive; contenance d'une « écuelle bien capable et profonde » (Rabelais) (5) qui contient beaucoup de vin ; contenance par le cosmos de ce qui s'y produit, « l'espace du monde et de l'air n'est assez capable pour le vol de sa perfection et renommée » (Brantôme) (6) ; contenance par l'âme d'une révélation, «... l'homme n'est point capable d'une si grande clarté», «des commandements dont notre cœur n'est point capable » (7), A cette signification s'oppose l'usage moderne, où capable (de -f- infinitif) dénote un pouvoir suffisant, une puissance prête à l'action. Quand passe-t-on d'une sémantique à l'autre ? 0. Bloch et von Wartburg, tout en rejetant la présence du sens ancien jusqu'au XVIIIème siècle, font dater « le sens moderne du XVIème siècle » ; récemment, M. Rat a maintenu la dualité « encore pendant tout le XVIIème siècle » (8). "Le Dictionnaire de l'Académie, en 1678 et en 1695, attribue la signification active à l'homme « capable, qui a des qualités requises pour quelque chose, entreprenant et hardi»; quant à la passive, elle n'y apparaît qu'en (4) On suit ici la terminologie saussurienne. Il s'agit en fait de déterminer la « valeur linguistique » de capable, puis de capax ; si elles ne se superposent pas, on en conclut à la non-équivalence des significations. Mais la « valeur linguistique » elle-même ne se repère qu'au terme d'une approche syntaxique. — « Dans tous les cas, nous surprenons donc, au lieu d'idées données à l'avance, des valeurs émanant du système. Quand on dit qu'elles correspondent à des concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels, définis non pas positivement, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système» (Cours de Linguistique générale, IV, § 2. Paris, Payot, 1968 (3ème éd.), p. 162). (5) Gargantua — I, 20 — qui transcrit exactement Horace, « Capaciores affers hue, puer, scyphos » (Epodes, IX, 33). Tite-Live complète cette sémantique œnologique en parlant d'un individu « vini capacissimus" (IX, 16, 13), c'est-à-dire d'un type qui « tient très bien le litre », comme traduit excellemment le langage courant. (6) Brantôme, Des Dames, I, Discours V, Marguerite, reine de France et de Navarre, œuvres complètes, éd. Mérimée, Paris 1890, t. x, p. 188. (7) Calvin, Institution Chrétienne, III, p. 130, (éd. 1541, rééd. Lefranc, E.P.H.E., Paris, 1911) et III, 7, 14, (éd. 1560, in corpus Reformatorum, t. xxxii, col. 188). — Voir aussi les textes cités par E. Htjguet, Dictionnaire de la Langue française du XVIème siècle, Paris, 1932. (8) Respectivement O. Bloch et von Wartbttrg, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, 1950 (2e éd.), ad loc. ; et M. Rat, in Défense de la langue française, n° 37, 1969, p. 14. Voir aussi J. Dubois et R. Lagarbe, Dictionnaire de la langue française classique. Paris, 1960 (2ème uploads/Philosophie/jean-luc-marion-capax-en-france-s.pdf
Documents similaires








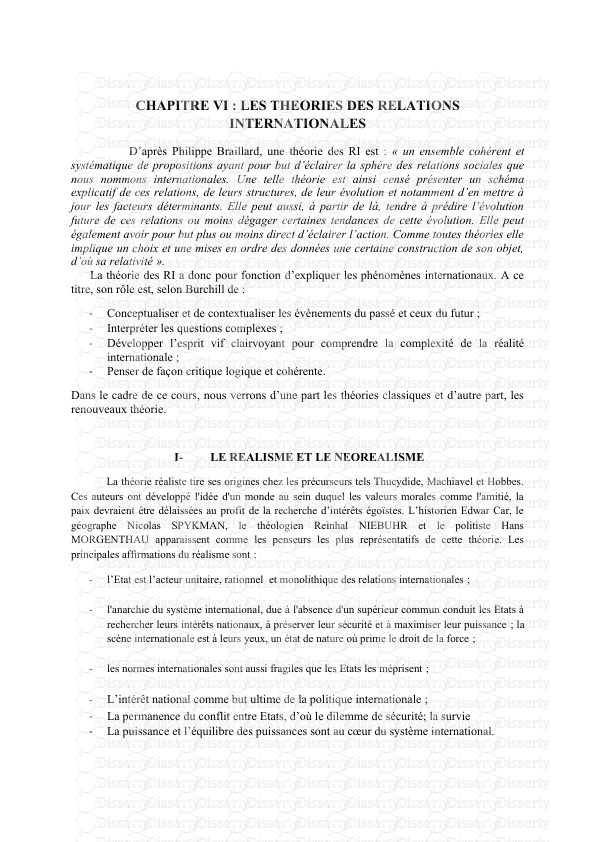

-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 26, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.6769MB


