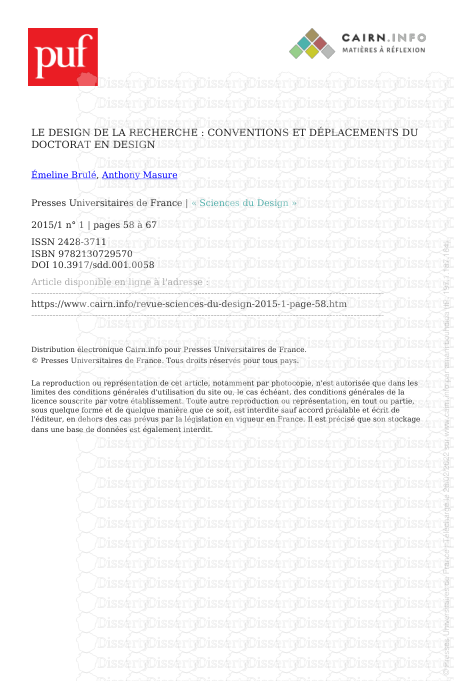LE DESIGN DE LA RECHERCHE : CONVENTIONS ET DÉPLACEMENTS DU DOCTORAT EN DESIGN É
LE DESIGN DE LA RECHERCHE : CONVENTIONS ET DÉPLACEMENTS DU DOCTORAT EN DESIGN Émeline Brulé, Anthony Masure Presses Universitaires de France | « Sciences du Design » 2015/1 n° 1 | pages 58 à 67 ISSN 2428-3711 ISBN 9782130729570 DOI 10.3917/sdd.001.0058 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2015-1-page-58.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France. © Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) 58 Mots-clés Design Thèse de doctorat Format Norme Édition Keywords Design PhD dissertation Format Norm Publishing Émeline Brulé Anthony Masure Le design de la recherche : conventions et déplacements du doctorat en design Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication (spécialité design), Telecom ParisTech Membre de l’association Design en Recherche brule.emeline@gmail.com Docteur en esthétique (spécialité design), UFR Arts Plastiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Professeur agrégé normalien en arts appliqués Membre de l’association Design en Recherche anthonymasure@gmail.com © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) 59 Sciences du Design — 01 — Mai 2015 Résumé Prenant acte d’une spécificité du design quant au travail des supports d’expression, cet article se donne comme champ d’étude les formes et for mats de thèses dans le contexte de la recherche en design. Nous considé rerons ici la thèse comme un « type » de document ayant intégré au fil du temps un certain nombre de conventions qui ne sont que trop rarement interrogées. Nous reviendrons tout d’abord sur son évolution historique et discuterons des conventions et normes des thèses en design à l’heure actuelle. Nous étudierons ensuite la manière dont ces dernières structurent le travail de recherche pour nous demander si la recherche en design se doit d’en créer d’autres, ou si elle doit œuvrer à les déconstruire. Enfin, nous nous demanderons si le design peut être vu comme un « laboratoire » permettant de déplacer les façons de faire de la recherche, au sens large. Abstract Design has specific ways of doing things. This article studies PhD thesis forms and formats in the context of design research. We consider the thesis as a kind of document built over time from many conventions that are too rarely questioned. First of all, we discuss historical evolutions and the restrictions of doctoral dissertations. We then study how conventions frame research to ask if design research must create others norms, or try to deconstruct them. Finally, we pose the question whether design can be seen as a « laboratory » for changing the ways in which research is done. Introduction Prenant acte d’une spécificité du design quant au travail des supports d’expression (Findeli, 2005), cet article se donne comme champ d’étude les formes de la recherche en design dans le contexte des thèses. En tant que jeunes doc torants/docteurs membres de l’association Design en Recherche 01, cet intérêt trouve son ancrage dans notre propre travail quant au développement d’une méthodologie adéquate, dans cette discipline encore récente sur le plan univer sitaire. Cette ouverture peut être considérée comme une opportunité pour les chercheurs en design, puisqu’ils peuvent construire eux-mêmes leurs méthodes d’écriture en empruntant et en « bricolant » 02 d’autres disciplines. Il faut pourtant que cette liberté s’exerce dans un cadre, celui des structures institutionnelles susceptibles d’accueillir les recherches — environnement qui contraint par bien des aspects ce qui pourra être produit. Dans le contexte de l’université, l’entrée dans le monde de la recherche se concrétise habituellement par la production d’une thèse. La confrontation de la culture du design au monde scientifique ne s’y opère pas sans heurts, par exemple dans le cas de doctorats où l’articulation entre la recherche et le projet joue un rôle clé (Findeli et Coste, 2007). Deux problèmes se posent. D’une part, concernant l’introduction du projet dans une dimension écrite, les thèses « par la pratique » ne permettent pas d’échapper à une formalisation textuelle de la pensée. D’autre part, du point de vue de la forme que cette écriture peut prendre, la pro duction de l’objet-thèse est souvent vécue douloureusement du fait de « guides » directifs comprenant les « normes de présentation » 03 : police Times corps 12, interligne double, gabarit Word à reproduire 04, etc. Peut-on la repenser ? Et si 01. Réseau de jeunes chercheurs en design francophones créé en décembre 2013, en ligne : designenrecherche.org 02. « L’art s’insère à mi- chemin entre la con- naissance scientifique et la pensée mythique ou magique ; car tout le monde sait que l’artiste tient à la fois du savant et du bri- coleur : avec des moyens artisanaux, il confectionne un objet matériel qui est en même temps objet de connaissance. » (Lévi-Strauss, 1962). 03. Notons que le format PDF, indispensable pour l’impression ou le dépôt numérique, dépend d’une norme ISO. Précisons également que les fichiers de thèse faisant l’objet d’un dépôt électronique doivent parfois faire l’objet d’une validation en ligne pour être acceptés (conformité aux standards des normes ISO ISO 32000 : PDF/A 1a, PDF/A 1b, 1.4 à 1.7). Source : Université Paris 1-Sorbonne : http:/ /goo.gl/f1jNnc (consulté le 03/12/14). 04. Notons que la circulaire 35837, datant de 2012, vise à encourager l’usage des logiciels libres dans les admini- strations française ; source : Légifrance, en ligne : http:/ /goo.gl/ hqG2VV. Plusieurs autres États européens ont adopté des mesures similaires. Source : April.org, en ligne : http:/ /goo.gl/63ftRb (consulté le 16/11/14). © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) © Presses Universitaires de France | Téléchargé le 26/02/2022 sur www.cairn.info par amani bouhdida (IP: 197.1.187.164) 60 Sciences du Design — 01 — Mai 2015 oui, comment ? Que viendrait faire le design dans cet environnement semblant hermétique aux changements techniques, et qui pourtant permet l’existence des thèses ? Comment faire valoir des spécificités propres au design si le travail de la forme n’est bien souvent même pas une question ? Quelles places y a-t-il pour le design au sein des formes de la recherche ? Si une thèse en design — comme n’importe quelle thèse — est essentielle ment du texte, rares sont celles qui se limitent à cela. En fonction des disciplines de rattachement — arts plastiques, anthropologie, sciences de l’information et de la communication, sciences de la conception, sciences de l’ingénierie, etc. 05 — , la thèse peut ainsi comprendre une partie iconographique, mais aussi être accompagnée de productions diverses pouvant nourrir, éclairer, déplacer ou incarner le registre discursif. C’est précisément des tensions entre la forme « conventionnelle » de la thèse et des spécificités propres au design que provient l’intérêt de la recherche en design. Nous reviendrons tout d’abord sur la nécessité d’organiser la lecture et la transmission du savoir par la mise en place d’un ensemble de conventions, de formats et d’habitudes qui ne sont que trop rarement interrogés. Nous étudie rons ensuite la notion de « norme » pour nous demander si la recherche en design se doit d’en créer d’autres, ou si elle doit œuvrer à les déconstruire. Enfin, nous nous demanderons si le design peut être vu comme un « laboratoire » permettant de déplacer les façons de faire de la recherche, au sens large. 1. — Formes et formats de la thèse Les premières thèses en France datent des débuts de l’université, au XIIe siècle ; elles n’avaient alors pas de forme spécifique. Le titre de « Docteur » était attribué en fonction des notes reçues et suivant quelques formalités admi nistratives (Imbert, 1984). Il nous faut d’ailleurs rappeler que le premier journal académique date de 1665 06. C’est vers la même époque que Leibniz commence ses échanges épistolaires avec de nombreux scientifiques et personnalités de toutes sortes 07, préfigurant les réseaux de chercheurs tels que nous les connais sons aujourd’hui. Quelques décennies plus tard, c’est l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert qui rassemblera des rédacteurs, graveurs et autres illustrateurs autour de la construction d’un savoir à visée universelle. Cet ouvrage est déjà en soi un travail de recherche s’interrogeant sur sa forme et sur les outils et modalités de représentations du savoir 08. Sous Napoléon, et suite à d’autres réformes datant de 1840, la thèse de recherche dans les uploads/Science et Technologie/ le-design-de-la-recherche.pdf
Documents similaires










-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 09, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0459MB