ICT LAB La Recherche à l’Institut Catholique de T oulouse N°2 2019 Dossier spéc
ICT LAB La Recherche à l’Institut Catholique de T oulouse N°2 2019 Dossier spécial « Sciences ecclésiastiques » 2 ICT LAB - LA RECHERCHE À L’ICT Editorial, P . Grégory Woimbée DOSSIER SPÉCIAL « Sciences ecclésiastiques » Une médiation vers le réel, les sciences religieuses dans Veritatis Gaudium!, P . Christian Delarbre L ’insolite et le scandaleux, P . Jean-Michel Poirier Le Codex de Bèze, Bernadette Escaffre Le spiritualisme français et le défi de la grâce, Giulia Maniezzi Le temps de la femme, Aude Suramy Portrait d’une femme artiste : Camille Claudel, Pascale Cazalès La théologie selon la tradition thomiste, fr. Philippe-Marie Margelidon, o.p. Mgr Aimé-Georges Martimort (1911-2000) : un serviteur de l’Église, fr. Benoît-Marie Solaberrieta Théologie des pratiques, Sr. Odile Hardy Partenariat avec l’Université Toulouse 1 Capitole : une journée d’études interfacultaire jubilaire, P . Etienne Richer L ’Église et l’ecclésiologie post-Vatican II, P . Gregory Woimbée Recherche doctorale : rencontre avec trois doctorants Le Bulletin de Littérature Ecclésiastique, bientôt 120 ans, Abbé Jean-François Galinier Le BLE dans Gallica, Marie-Charlotte Tanguy FOCUS Assises de l’éducation, Karine Wiltord L ’urgence en kinésithérapie, Marie-Christine Monnoyer Faut-il parler de la maladie et de la souffrance ?, Vera Walburg (D)écrire le paysage, Christophe Balagna Service aux chercheurs – Bibliothèque universitaire Aimé-Georges Martimort, Laura Monneau Prix décerné par la chaire Rodhain, dans l’agenda 2019-2020 Publications À paraître 3 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 20 23 24 25 25 26 27 28 29 30 32 sommaire P . Grégory Woimbée Le Professeur Grégory Woimbée est Vice-Recteur « Recherche et Relations Internationales » de l’ICT. Membre de CERES (TR2 : «Christianisme: héritages et présence»), ses recherches portent sur l’histoire et la théologie. 3 L ’Unité de Recherche Culture, Ethique, Religion Et Société (CERES) coordonne et stimule les activités de recherche au sein de notre université depuis quatre ans maintenant. Lors de son évaluation par le HCERES, le Haut-Conseil pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, a été notamment saluée la longue tradition d’expertise de notre institution dans le domaine des sciences dites ecclésiastiques. L ’adjectif est facilement trom- peur et réducteur si l’on s’en tient au sens qui vient immé- diatement à l’esprit dans une culture largement sécularisée et dominée par le préjugé anti-religieux ou qui oublierait par exemple que le CNU (Conseil National des Universités) reconnaît pleinement la théologie catholique (section 76) ou que le BLE (voir pages 20-23 ), est une revue répertoriée par les instances nationales et internationales, ce qui lui vaut de bénéficier d’un programme de numérisation par la BNF ou à ses contributeurs d’être gratifiés d’une publication de rang 1. « Ecclésiastique » fait droit à l’effort de compréhension d’une raison en quête de transcendance et mue par le désir de vérité, non pour la posséder comme une chose, mais pour la contempler comme un vivant, non pour être satisfait par des opinions toutes faites, mais pour être transformé par une invincible espé- rance. « Ecclésiastique » ne définit pas un péri- mètre d’autojustification, mais l’effort de l’Ecclesia à déployer tout le potentiel d’un homme devant la question de Dieu. La science ne désigne pas tel savoir, elle désigne un acte de compré- hension permis par la rigueur d’une méthode objective, d’une sortie de l’immédiateté et du dépassement d’un simple programme de toute- puissance. La science n’a pas de sens si, dépourvue de sagesse, elle ne met nos forces qu’au service d’un faire, si elle ne permet au savant de discerner l’être caché au cœur du réel. Toute science est construite sur un socle qui la dépasse pour être apte à la fonder, un dévoilement de l’être, une étincelle dans la motte de terre que nous sommes. « Ecclésiastique » désigne théologie, philosophie, droit canonique ou encore les multiples sciences du phénomène religieux ainsi qu’une légion de disciplines auxiliaires qui permettent d’en interpré- ter les sources, parce que l’intelligence de la foi, la quête de sens ou le service du plus faible comme le bien commun d’une société consti- tuent des relais incarnés de la parole de Dieu faite chair dans le Christ. La constitution Veritatis Gaudium (VG) du 8 décembre 2017 prévient : « La vérité n’est pas une idée abstraite, mais c’est Jésus, le Verbe de Dieu en qui se trouve la Vie qui est la Lumière des hommes. » (n.1). « Ecclésiastique » ne désigne donc pas une citadelle, encore moins une île, il désigne un lieu où tout se lie, s’interpelle et se conjoint. Quelle est l’apport des sciences ecclésiastiques ? Elles nous rappellent le rôle essentiel de la contemplation dans l’exercice de la pensée, ce d’où vient la joie intérieure, la fruitio des Anciens. Nos sciences contemporaines manquent souvent d’intériorité. Par intériorité il ne faut pas entendre « repli sur soi » mais « mystique du nous » qui se fait levain d’une fraternité et « qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain » (VG, n.35). Elles invitent au dialogue dans tous les domaines scientifiques, brisant des frontières épistémologiques ou idéologiques parfois complaisantes avec la loi du tout-marchand. Rien à voir avec la seule recherche prosélyte des effets de vérité, tout à voir avec l’approfondissement constant des significations et la saisie des implications pratiques de la vérité. Au service d’une culture de la rencontre, elles pratiquent l’interdisciplinarité qui caractérise leur offre académique, formative et de recherche. L ’unité du savoir à laquelle elles tiennent tant requiert le respect de ses multiples expressions, d’une attention aux corrélations positives et convergentes entre elles. Pluralité n’est pas ici l’ennemi de l’unité, mais le réel à la lumière conjointe de la Révélation chrétienne et de tous les efforts continus pour s’en approcher. Pour faire face « au manque de sagesse, de réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice » (Benoît XVI, Caritas in Veritate, n.45), l’interdisciplinarité va au-delà de la simple pluridisciplinarité, comme accumulation de multiples points de vue au sujet d’un même objet d’étude, jusqu’à la transdisciplinarité comme fermentation de tous ces points de vue. Le tout qu’elle vise n’est pas ici la somme des parties mais leur fruit commun. Les sciences ecclésiastiques doivent servir à construire de véritables matrices intellectuelles et existentielles, doivent être des lieux de fécondité, des oasis accueillantes et non des repoussoirs incrustés dans un sol sec et stérile. Elles doivent prendre garde, si elles veulent conserver ce caractère matriciel, de se laisser purifier par cette lumière qu’elles invoquent comme de vivre authentiquement de cette tradition qu’elles perpétuent. Il leur faut une activité véritablement commune et partagée par et pour laquelle chacun se dépasse et accepte lorsqu’il le faut dépouillement et décentrement. La tradition ecclésiale, notamment intellectuelle, n’est pas un modèle culturel ou sociologique unique, elle a donné naissance à d’innombrables cultures, à d’innombrables peuples, à de multiples racines, et aussi à de multiples problèmes. L ’image de la sphère est fascinante, l’équidistance de tous les points nous apaise, mais fait naître en nous l’illusion d’un réel uniforme aux solutions faciles. Le pape François lui préfère celle du polyèdre « qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité » (VG n.52). Face aux humanismes abstraits de la sphère, il y a l’humanisme difficile du polyèdre. Pour Blondel ou Maritain, et tant d’autres grandes figures de la pensée chrétienne contemporaine, cet humanisme plus difficile est aussi le plus chrétien, le plus à même de rendre compte d’un événement qui a surmonté la haine et la peur, qui a vaincu la mort et qui a servi de berceau au christianisme. Accepter le conflit, la contradiction ou la disputatio, c’est aussi aller du centre aux périphéries, de la source aux terres arides, pour qu’elles soient irriguées par le fleuve de la tradition. Les sciences ecclésiastiques doivent démontrer le caractère vivant des héritages, leur état non de survivances mais de semences. Elles ne cherchent pas à construire un nouveau syncrétisme, absorbant ou se laissant absorber, mais la découverte d’un plan supérieur du réel, là où les mots « culture », « éthique », « religion » et « société » seront davantage qu’un acronyme passe-partout, là où ils deviendront une véritable disposition à expérimenter, à comprendre ce qu’on a expérimenté, à juger de ce qu’on a compris et à décider de ce qu’on va faire, là même où se conduira un processus de régénération culturel, éducatif et spirituel. Ce qui suit donnera au lecteur un avant-goût de ce qui se fait actuellement chez nous en la matière. Il faut saluer une commu- nauté de chercheurs enracinés, ouverts et conscients de leur tâche. Plus que des projets esquissés ici, c’est d’une dynamique générale dont ICTlab voudrait se faire le témoin. P . Grégory Woimbée Directeur de l’Unité de Recherche CERES « La vérité germera de la terre » (psaume 84) Éditorial 4 ICT LAB - LA RECHERCHE À L’ICT La Constitution apostolique du Pape François sur la mission des universités et facultés ecclésiastiques du 8 décembre 2017 porte le titre de Veritatis Gaudium (VG) et uploads/Science et Technologie/ revue-ict-lab-2019-web.pdf
Documents similaires




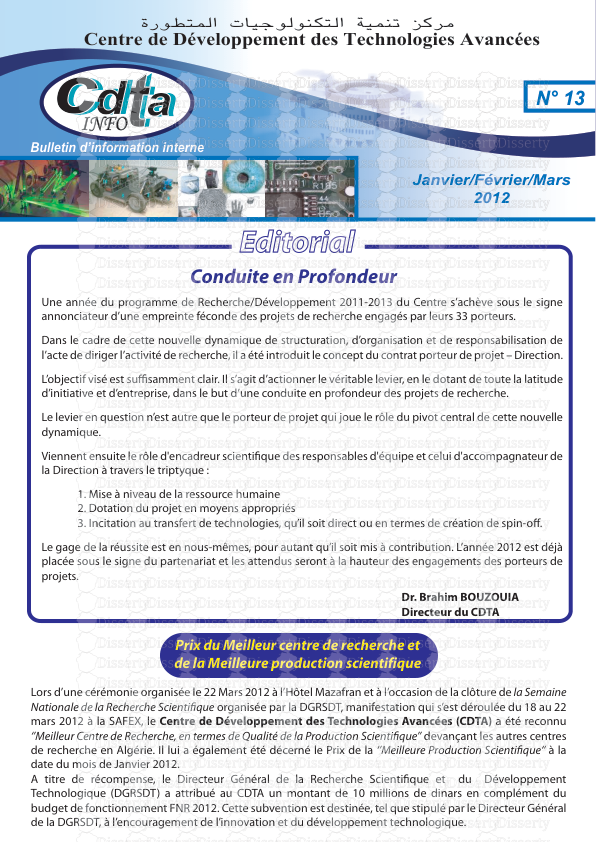





-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 28, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.6307MB


