Mi:--l T STÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS ANNALES DU MUSÉE GUI
Mi:--l T STÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS ANNALES DU MUSÉE GUIMET BiBLIOTHÈQUE D'ÉTUDES. TOME ~l4 DU MÊME AUTEUR Le Crime des Lemniennes. Rites et Légmdes du monde égém. Un vo i. d'environ 100 pages, gr. in-B, 1924, 15 Fr. GEORGES DUMEZIL DOCTEUR ÈS-LETTRES , L E FESTIN D'IMMORTALIT E ÉTODE DE M YTHOLOGIE COMPARÉE INDO-EUHOPltENNE LIBR. IRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNEH P .\P.IS - 13, RCE J,\COB (VIe) - 1~24 A P IERRE GAXOTTE, affectueusement. G. D. INTRODUCTION I. MYTHOLOGIE INDO-Eu ROPÉENNE (1) La réaction contre l'ancienne rnythologie comparée indo européenne, celle des rnythes solaires et des à-peu-près étymo logiques, se prolonge iusqu'à nos fours. On n'adrnet guère que la cornparaison perrnette de dépasser l'état de choses indo (1) Note sur quelques points de vocabulaire. POUl' éviter toute confusion, précisons le sens de quelques termes simples, mais d'usage parfois incertain. TI y a tout intérêt il adopter le vocablll4ire qu'on trouve défini par exemple dans le Jiyre rlc ]\!. A. yan Gennep sur la Formation des Légendes. On désigne ici par thème le sujet d'ull l'~cil légendaire simple, ab~traGtiol1 faite des noms cle lieux, de personnages... et antres détails du même ordre, exposés à de continuelles variations. En général, un récit n'étant pas simple, il faut y distinguer dh'ers thèmes. juxtaposés ou enchevêtrés. On a alors affaire à une sequence thématique. C'est ainsi que la légende grecque de Phrixos et d'HeIIé juxtapose le thème de la marâtre persécutant les enfants du premier lit, celui de la victime substituée, celui du voyage aérien, etc... Enfin quand plusieurs récits ainsi composés ont un pOillt essentiel commun, un centre (être animé ou inanimé, divin ou humain, événement, etc... ) ils forment un cycle: l'aventure de Phrixos, la navigation des Ar{Jonautes , les épreuves de Jason en Colchide, les exploits de Iv[édéc en Grèce constituent ncttement un Cycle de la Toison d'or - D'ailleurs, les centres de cycles changent constamment; une figure divine, Thor ou Héraclès, accapare-t-elle la fa,;cllr d'une génération ? Aussitôt elle attire à elle une foule de thèmes étrangers, appauvrissant ainsi d'allcicns cycles. Ces dislocations et ces regroupements de thèmes sont un des phénomènes les pins apparents dans J'histoire de tontes les mythologies, de toutes les traditions littéraires ou populaires. Il est bien rare qu'un cycle survive intact à une révolution religieuse aussi radicale que le christianisme; on en cite cependant des exemples, et nous-mêmes en ren contrerons. Nous appellerons variantes les légendes qui racontent de diverses façons la même aventure d'un même personnage: par exemple, les versions du sacriflce d'Iphigénie, du rapt des pommes des Hespérides ... Nous appellerons doublets les légendes, contemporaines ou non, qui racontent identiquement la même aventure de personnages différents : ainsi les monstres tués par un héros aux portes d'une ville, les enfants abandonnés sur l'indication d'un oracle... Nous réserverons le nom de mythes aux légendes dramatisées, 'aux récits qui sont objets de croyance et se traduisent en acte au fur et à mesure de leur récitation )) : pour qu'il y ait mythe, il fau t donc qu'aux thèmes corres pondent de~ rites. II INTRODUCTIOK iranien ou l'état germanique comm1tn. L'étude des données grecques a mis en évidence la complexité des éléments égéens aussi bien qu' orientmtx où se sont fondues les légendes · propres des conquérants, et l'on a mi,;ux senti l'abîme qui sépare Hésiode ou Pindare du Rig- Véda. D'autre part, le développement rapide, les résultats substantiels des recherches sociologiques paraissent avo'ir relégué au dernier plan, parmi les problèmes insolubles ou inexistants, l'examen comparatif des traditions indo-européennes. En France et à l'étranger, les savants les pl~ls considérables se sont souvent exprimés avec netteté sur ce point ; d'ap'rès eux, les anciens ihè1nes légendaires, les anciens mythes de l'Inde, de la Grèce, de l'Italie ne sont guère pl~ls voisins les uns des autres q~l' il:'l ne le sont des thèmes ou des ·mythes des non-civilisés de toute époque. Ils expriment ~m état de pensée collective qui se retrouve sensiblement identique daru; l'évolution de toute société, et les mêmes causes produisant partout les mêmes effets, les points de comparÙiison, les éléments d'explication des légendes classiques s'étendent sur toute la teTre et à travers toute l' histoire. 1 111. Salomon Reinach écrit à propos de l'ancienne mytho logie comparée (Cultes, Mythes et Religions. l, p. 19l~) : « Les savants de cette école ne comparaient que trois ou quatre mythologies et laissaient en dehors de leurs spéculations 1'immense domaine des tTaditions populaires et des religion8 des peuples non civ'ilisés. » Ce n'est donc pas seulement la méthode de cette école qu'il blâme, c'est son principe, c'est l'idée que les peuples de langue indo-européenne puissent avoiT gardé en commun, avec la langue et quelques autres faits sociaux bien attestés, des traditions d'ordre religieux. Cette opinion, sous des formes généralement moins brutales est àcceptée par les spécialistes : il suffit de lire les premièTes pages du livre d' Oldenberg sur la relig1:on védique ou de feuilleter les grands répertoires allemands de mythologie classique pour mesurer le discrédit où est tombée la notion III INTRODUCTIO~ de mythologie indo-européenne. Dans son récent travail sur la libation dans le monde scandinave, M. Cahen, content d'appliquer avec bonheur l'analyse sémantique aux phhw mènes religie~tx, repousse en toute rencontre la tentation comparatiste. Avant tout, il faut reconnaître que la mythologie comparée a cherché sa disgrâce. La « folie védique» sous ses deux formes, exégèse naturaliste (mythes d'orage, mythes solaires), et exégèse rituelle (mythes de libation... ), a littéralement dévoyé les esprits. Puis, de même que latinistes et hellénistes ont longtemps ignoré la linguistique comparative, les mythologues à leur tour ont négligé, méprisé parfois, les jeunes écoleiJ anthropologiques et sociologiques. On citerait sans peine, S011,.'J la plume pourtant si mesurée de Victor Heury. plus d'une exécution sommaire du totémisme. C'est un exemple original, et malheureusement fort peu suivi qu'a donné M. Meillet en montrant dans l'indo-iranien Mitra non pas un phénomène naturel, mais un phénomène social divinisé. En somme, ce sont les (c mythologues indo-européens », qui, énonçant mal la question, ont tué leuT discipline .' ils ont opposé, comme deux systèmes inconciliables, les nouvelles idées et les anciennes, au lieu d'examiner si, comme il arrive à chaque progrès essentiel d'une science, les nouvelles idées ne fournissaient pas ~tn cadre plus vaste, une classification plus générale, où, leI anciennes dussent trouver place. Par là même, ils se sont exclus de la vérité, et chaque conquête de lMt1's adversaires a mieux révélé la fausseté de leur position. Il n'est guère étonnant que ces adzJe1'saires, sociologues, folkloristes, devenus les maîtres de la situation, aient gardé une ce1taine défiance, une certaine hostilité de principe envers la notion d'une mythologie indo européenne. A u cours de la féconde discussion qui s' est déro~llée, en 1908, dans la Revue de l'Histoire des Religions entre les tenants de cc la méthode historique » et ceux de « la méthode sociologique » (qualifiée de « méthode comparative »), aucune place n'a été prévue, ni par les uns ni par les autres, pour I;V INTRODUCTION la « méthode comparative » au sens étroit du mot, c'est-à-dire pour la comparaison des diverses traditions groupées par familles (indo-européenne, sémitique ... ). Le bon sens, cependant, appelle une conciliation. Quand des groupes humains ont connu, à une certaine époque, l'unité sociale que suppose la communauté de la langue, de l'orga nisation familiale, etc... , il est invraisemblable que ces groupes humains n'aient pas conservé, après leur séparation, une partie considérable du bagage de rites, de légendes, d'idées abstraites qui constituait alors leur religion. Que ce bagage soit du même ordre que celui des demi-civilisés dont se nour rissent les études sociologiques, c'est ce qui est a priori vrai semblable, et pourra utilement orienter les recherches ; mais que ce bagage n'ait pas existé, on nous soit inaccessible, c'est CI qu'on ne peut admettre sans supposer du même coup un vide de plusieurs siècles dans l'évolution religieuse d'une société, ou un oubli parallèle et complet des anciennes traditions chez tous les g1'oupes hU1nains issus de cette société : hypothèses auss~ invraisemblables que le serait celle d'une conservation parfaite des antiques croyances. On est ainsi amené à ?'ectifier l'attitude des sociologues: entre la comparaison d'une donnée grecque ancienne, par exemple, et d'une donnée australienne ou africaine moderne, il faudra intercaler, au cas où la donnée grecque aura des correspondants précis chez les lndo-Iraniens, les Latins,les Germains, les Celtes, les Slaves, etc... la donnée indo-européenne définie par ces corres pondances, et c'est cette donnée indo-européenne qu'il appartiendra !;tu sociologue d'expliquer selon ses méthodes. La donnée grecque, eHe, s'expliquera par déformation, conta mination, etc ... Elle ne saurait être, sous peine de graves méprises, traitée comme une donnée première. Bref, il s'agit de restituer, dans la préhistoire des légendes et des mythes, à côté de leur interprétation sociale, une part à l' étude de leur évolution. v INTRODUCTION II. MÉTHODE On accordera sans doute facilement cette rectification théorique. Mais, devant les chétifs résultats de l'ancienne mythologie comparée, on se demande si ces vues de l'esprit comportent quelque uploads/Sante/ dumezil-le-festin-de-l-immortalite.pdf
Documents similaires




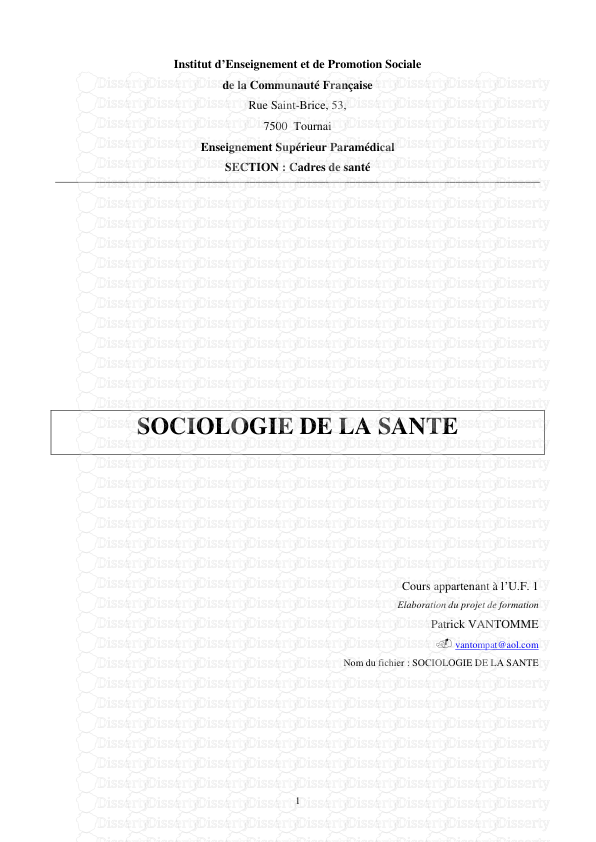





-
85
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 01, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 10.1214MB


