SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 1 sur 12 Du 13 octobre 2021 SHS – EB 1 SUJET
SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 1 sur 12 Du 13 octobre 2021 SHS – EB 1 SUJET Durée : 1 h 00 Nombre de QCMs : 27 Nombre de QROCs : 3 UE5 : 14 QCM – UE6 : 10 QCM – UE7 : 3 QCM/3 QROC Ce sujet comporte 12 pages, couverture comprise. Avant de commencer l’épreuve, veuillez vérifier que votre sujet est complet. En cas de problème avec le sujet, signalez-le ! L’épreuve sera corrigée demain à partir de 18H00. Retrouvez-la avec sa correction détaillée et votre résultat sur le site web du tutorat : http://tutoratparis12.fr en vous connectant à votre espace. Bon courage ! SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 2 sur 12 UE 5 – Economie-gestion, géographie urbaine et droit Enoncé commun aux Q1 et Q2. « Deux voies de réformes hospitalières ont été privilégiées par les pouvoirs publics depuis les années 1990. D’abord la mise en concurrence des établissements par l’introduction d’un nouveau mode de financement et ensuite l’application de méthodes de management issues du secteur privé et notamment l’expérimentation de méthodes de certification et d’accréditation censées normaliser les pratiques : – La mise en œuvre d’un financement incitatif : la tarification à l’activité (T2A) L’objectif de ce nouveau mode de tarification est simple : l’acheteur (en l’occurrence la Sécurité sociale) rémunère un établissement pour la prise en charge d’un épisode de soin hospitalier (un séjour pour un malade atteint d’une pathologie donnée). La logique de la concurrence par comparaison suppose que chaque établissement reçoive un prix fixe par pathologie (défini selon des groupes homogènes de malades, GHM) en fonction de la moyenne des coûts observés (Mougeot, 2000). La tarification à l’activité est selon ses partisans un mécanisme incitatif et efficace dans la mesure où la classification par GHM doit permettre de classer chaque patient entrant en fonction des caractéristiques observables ex ante. – L’accréditation est définie par l’ordonnance du 24 avril 1996 comme la « procédure d’évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des professionnels, indépendante de l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle, concernant l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise à s’assurer que les conditions de sécurité et de qualité des soins et de prise en charge du patient sont prises en compte par l’établissement de santé ». La certification a quant à elle été mise en œuvre par la loi du 13 août 2004, elle remplace l’accréditation qui est désormais réservée aux médecins et aux équipes médicales. La certification « est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, service ou système qualité, est conforme aux exigences spécifiées » (Iso/CEI guide 2). » Source : Réforme de l’hôpital. Quels enjeux en termes de travail et de santé des personnels ? Samia Benallah, Jean-Paul Domin. Dans La Revue de l’Ires 2017/1-2 (n°91-92), pages 155 à 183 SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 3 sur 12 QCM 1. A l’aide du texte et de vos connaissances, indiquer la (les) bonne(s) réponse(s) (1 point) : A. La T2A correspond à une tarification en fonction du nombre de médicaments prescrits à l’hôpital. B. La technicité des soins entraine très souvent l’augmentation du nombre d’actes. C. Le risque de la tarification à l’activité est un raccourcissement de la durée moyenne des séjours. D. Le principe de T2A fait l’hypothèse que la prise en charge d’un malade issu d’un même GHM est identique d’un établissement à un autre. E. La T2A est une mesure beveridgienne. QCM 2. A l’aide du texte et de vos connaissances, indiquer la (les) bonne(s) réponse(s) (1 point) : A. La certification des établissements permet de porter une appréciation globale sur la conformité des pratiques. B. L’évaluation de la qualité relève uniquement des professionnels appréciant leur propre travail. C. La procédure de certification est explicitement destinée à informer les usagers de la qualité des soins délivrés par les établissements de santé. D. Les Recommandations de Bonnes Pratiques (RBP) définissent les prescriptions et les soins médicalement inutiles ou dangereux. E. Les données des établissements sont collectées dans une base de données à des fins comparatives. SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 4 sur 12 Enoncé commun aux Q3 et Q4. « En quoi la demande de césarienne sur demande maternelle peut-elle être considérée comme demande induite ? » Résumé́ : La césarienne sur demande maternelle englobe une grande variété de situations qui ne se réduisent pas toutes à une pure convenance. Une mère exprimant une envie de césarienne peut réagir dans la continuité d’un traumatisme antérieur ou peut agir suite à une information biaisée. Le dialogue mère–soignant est primordial afin de comprendre la demande maternelle sous-jacente et pour y apporter la réponse la plus adaptée, qui n’est pas nécessairement une césarienne. Les taux de césariennes, en augmentation constante, ont incité les auteurs à se pencher sur les causes de ce phénomène. Parmi elles, la césarienne sur demande maternelle est parfois invoquée pour justifier cette augmentation [1]. Cela nous semble révélateur d’un contexte général, valorisant la césarienne au nom de la sécurité et de la maîtrise, contexte qui imprègne aussi bien les mères que les soignants. Depuis 2005, l’association Césarine, association d’usagers qui propose aux parents échange, soutien et information autour de la naissance par césarienne, a recueilli dans son forum de discussion, et lors de groupes de parole, plusieurs centaines de témoignages de mères. Notre expérience nous a montré́ qu’une envie de césarienne formulée par une mère masque bien souvent une réalité plus complexe, allant de la décision mal informée jusqu’à la phobie de l’accouchement. La pure convenance ne nous semble y occuper qu’une place anecdotique, tandis que le rôle des soignants ne nous semble pas à négliger [...]. D’après S. Heimann, Revue Médicale de Périnatalité. (2010) 2:8-11 QCM 3. A l’aide du texte et de vos connaissances, indiquer la (les) bonne(s) réponse(s) (1 point) : A. La demande induite peut se définir comme la capacité du médecin à choisir une quantité (ou une qualité) différente de traitements de celle qui serait choisie par le patient si celui-ci était parfaitement informé. B. L’information parfaite des différents acteurs n’est pas une des conditions d’un marché concurrentiel parfait. C. La cause psychologique est considérée comme une indication médicale de césarienne. D. Une information éclairée des risques et des avantages des deux modes de naissance (accouchement par voie basse et césarienne) est systématiquement donnée aux patientes. E. Dans le secteur de la santé, la diffusion du progrès technique a stimulé la demande. SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 5 sur 12 QCM 4. A l’aide du texte et de vos connaissances, indiquer la (les) bonne(s) réponse(s) (1 point) : A. Il existe des preuves empiriques au niveau international qui appuient la théorie de la « demande induite ». B. Il peut en effet être de l’intérêt (financier ou organisationnel) du médecin d’inciter ses patientes à la césarienne. C. L’illusion du « risque zéro » pendant une césarienne, à la différence de l’accouchement par voie basse (soumis à l’aléatoire) ne fait pas partie des raisons invoquées par les mères pour justifier leur choix. D. La notion d’accompagnement humain et de dialogue est à négliger face à la médecine mécanique qui favorise la prescription de soin. E. L’asymétrie d’information entre les médecins et les patients peut être rectifiée par des campagnes de prévention notamment. QCM 5. Parmi les propositions, concernant la transition démographique, la ou lesquelles sont exactes ? (1 point) Ici phase 3 fait référence au cours et non au graphique qui concerne uniquement les flèches. A. Le taux de natalité diminue plus rapidement que le taux de mortalité. B. La pré-transition est caractérisée par un taux de mortalité élevé C. La phase 3 est caractérisée par une limitation involontaire des naissances. D. La flèche 1 désigne le taux de mortalité. E. La flèche 2 désigne le taux de natalité. QCM 6. Parmi les propositions suivantes, concernant l’augmentation de l’incidence des cancers, la ou lesquelles sont exactes ? (1 point) A. L’augmentation de la prévalence de certains facteurs de risque (comportements individuels, dégradation de l’environnement est un facteur d’augmentation. B. La diminution de la population est une des raisons de l’augmentation de l’incidence des cancers. C. L’amélioration des techniques de diagnostic est un facteur. D. Le cancer est la première cause de mortalité dans le monde. E. La diminution de l’espérance de vie est une des raisons de l’augmentation de l’incidence des cancers. 1 2 SHS – EB 1 SUJET TUTORAT Page 6 sur 12 QCM 7. Parmi les propositions suivantes, concernant la transition épidémiologique / sanitaire, la ou lesquelles sont exactes ? (1 point) Ici les phases font références au cours. A. Elle est uniforme. B. La phase 1 est caractérisée par une prédominance des maladies infectieuses et parasitaires. C. Les phases 2 est caractérisée par une diminution de l’espérance de vie. D. Les phases 2, 3 et 4 sont caractérisées par une prédominance des maladies chroniques et dégénératives. E. La phase 4 est caractérisée par un uploads/Sante/eb1-sujet-shs.pdf
Documents similaires





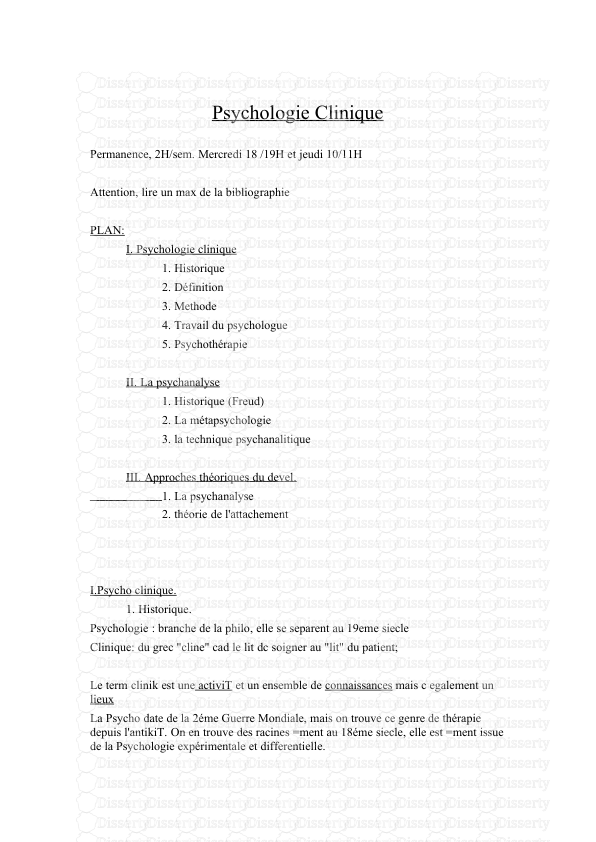




-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 29, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.3063MB


