1 ANNEXE AU PROJET DE RAPPORT N° 2012-04-0072 SYNTHESE DES PROPOSITIONS ET ECHA
1 ANNEXE AU PROJET DE RAPPORT N° 2012-04-0072 SYNTHESE DES PROPOSITIONS ET ECHANGES INTERVENUS DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA POLITIQUE DE L’EAU INSTITUE PAR LA DELIBERATION DE PRINCIPE DU 12 MARS 2012 Membres : Les représentants indiqués sont les personnes représentant la structure qui ont assisté à une ou plusieurs séances du groupe de travail Elus du Conseil général désignés en Assemblée : - majorité : Romain Colas, Guy Bonneau, Paul da Silva - opposition : Jean-Jacques Boussaingault et Thomas Joly Représentants de collectivités essonniennes : - Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne représentée par son président Gabriel Amard - Syndicat des eaux de la Région du Hurepoix, représenté par son président Pascal Fournier et son directeur Christophe Rabelle - Syndicat des eaux de la Vallée de la Juine, représenté par son président Francis Maquennehan - Syndicat d’assainissement Da.Co.Mo.Vi représenté par son président Henri Meier - Commune de Richarville, représentée par sa maire Marie-Thérèse Leroux Associations, experts, collectivités hors Essonne : - Union départementale des associations familiales de l’Essonne (UDAF91), représentée par Isabelle Gaillard - Association de consommateur CLCV, représentée par Jean Lacroix - Coordination eau Ile-de-France, représentée par Pascal Grandjeat ou Francis Diener - Fédération nationale des collectivités concédantes et en régies (FNCCR), représentée par Michel Desmars (séance du 20 juin 2012) - Région Ile-de-France représentée par Guillaume Cantillon, conseilleur technique du Président du Conseil régional et Nathalie Evain-Bousquet, cheffe de l’unité aménagement durable (séance du 29 août 2012) Séances du groupe de travail � 21 mai 2012 : installation du groupe � 20 juin 2012 : séance sur les missions d’appui technique et d’animation � 29 août 2012 : séance sur les aides financières � 19 septembre 2012 : auditions d’expériences d’échelle départementale d’appui à la gestion des services d’eau et/ou d’assainissement o Agence technique départementale eau de la Mayenne : établissement public administratif o Association pour la mutualisation des moyens en eau (ASMEAU) : association appuyé par le Conseil général de Saône-et-Loire o Conseil général des Pyrénées-Orientales : missions d’appui aux régies o Assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ADTO) : société publique locale � 14 novembre 2012 : restitution des travaux et présentation des arbitrages 2 Synthèse des échanges par grands sujets abordés Audits et études de choix de mode de gestion Utilité partagée des audits avant fin de contrat et pendant la vie du contrat Question d’une expertise publique : des membres du groupe souhaitent que les études soient réalisées par des agents publics mais reconnaissance d’un besoin a minima d’une expertise publique (au sein ou en appui à la collectivité) pour lancer, suivre les études et avoir une analyse critique. Ces différentes études ne doivent pas exonérer l’exploitant de produire et transmettre les données dont il a l’obligation La région dispose d’une aide pour ces audits (40%). Il est jugé utile que le Conseil général complète cette aide et sensibilise les collectivités à l’utilité de ces études et aux possibilités d’aides. Tarification Absence de tarification idéale reconnue dans le groupe. Accord sur les possibilités très larges des collectivités pour appliquer des structures tarifaires, notamment tarification selon les usages. Souhait confirmé de membres du groupe – associations et certaines collectivités - de réduire au maximum la part fixe pour ne pas pénaliser les petits consommateurs. Contrôle – information des usagers Les commissions consultatives ne sont parfois pas en place ou pas alimentées par les documents nécessaires. Un usager informé est capable de contribuer au contrôle de la gestion d’un service, affermé ou en régie. Les rapports du maire sur la qualité du service (RPQS) sont obligatoires mais pas toujours réalisés ou accessibles. Les rapports des délégataires sont des documents publics. Il est difficile de juger du « bon suivi » d’une DSP sur des critères simples. Les régies doivent faire l’objet de contrôles. Le conseil d’exploitation d’une régie associant des usagers offre de fait une possibilité de participation plus importante des usagers. Les régies doivent contribuer comme les autres modes de gestion à alimenter des réseaux d’indicateurs de gestion des services permettant une analyse de la performance des services. Ingénierie publique – disparition de l’ingénierie de l’Etat – besoins des collectivités Constat partagé d’un besoin pour les petites ou moyennes collectivités rurales suite à la disparition de l’ingénierie de l’Etat (ex-DDAF). Contrairement à d’autres territoires (dont ceux auditionnés), l’Etat assure encore en Essonne par la Direction des Territoires (DDT) une mission de gestion des services publics mais seulement pour quelques collectivités rurales. Le besoin d’ingénierie et de mutualisation de certaines tâches se pose de plus en plus, y compris sur des tâches ne prenant pas ou peu la place des entreprises privées comme l’AMO. En matière de gestion des services publics, les collectivités ont des besoins ponctuels (pour faire un audit, préparer un renouvellement de DSP…) et des besoins dans le temps (aide au suivi du contrat, aide à la réalisation du RPQS). La réglementation offre aujourd’hui de nouveaux outils plus souples comme les sociétés publiques locales, outils que la Région entend favoriser. La mise en réseau des acteurs et des expériences en matière de gestion des services semble utile. Le Conseil général pourrait élargir ses missions d’animation et contribuer également à l’animation régionale dans le cadre de l’espace public régional sur l’eau créé à l’occasion du vote de la politique régionale de l’eau en juillet 2012. 3 Ressources en eau du nord Essonne La situation de ressources en eau privée (Lyonnaise des Eaux) alimentant le nord Essonne et plus largement une partie du sud de la région parisienne (1 million d’habitants) est quasiment unique en France. La question a été posée quant à la véritable libre administration des collectivités pour l’exercice de leurs missions actuelles de distribution de l’eau et à une situation de relative précarité face à une offre unique de ressource en eau renforcée par le fait que la vente d’eau se fait de gré à gré. La question d’un outil public de production d’eau a été abordée, les conditions financières actuelles rendant difficiles un engagement des collectivités en ce sens. Intercommunalité - taille critique de régie Les régies sont plus fréquentes en assainissement. Certaines petites régies fonctionnent bien. Leur situation reste généralement simple. Il est rare que les régies du département soient structurées à part certaines régies « urbaines ». Il est beaucoup fait recours à des prestations sous forme de marchés. L’implication des élus dans la gestion des services est un facteur clé dans ces petites régies. La nécessité d’une structure de taille suffisante est plutôt admise bien que non partagée par l’ensemble du groupe. Certaines structures intercommunales importantes « sur le papier » ne se sont pas dotées de moyens humains nécessaires, notamment en raison de l’ingénierie de l’Etat présente jusqu’à une période récente. L’intérêt d’une mutualisation pour un certain nombre de prestations ou de commandes semble faire consensus. Renouvellement du patrimoine Le renouvellement des réseaux est très insuffisamment mis en œuvre par les collectivités responsables (eau ou assainissement). Le taux de renouvellement minimal souhaitable est de 1% (100 ans pour renouveler le patrimoine) alors que les taux observés sont très inférieurs, voire inexistants dans certaines collectivités. Le renouvellement peut être fait pour partie au sein des contrats de délégation en cas d’affermage, selon les contrats. L’impact financier de mise en œuvre d’une politique de renouvellement a été discuté au sein du groupe : l’avis général est qu’une telle politique se traduirait par une hausse du prix de l’eau, renforcée par la baisse générale constatée des consommations face des coûts de service essentiellement fixes. Toutefois, certains membres du groupe estiment que les marges des sociétés fermières doivent être mises à contribution de ce renouvellement, limitant ainsi la hausse du prix de l’eau. 1 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION N° 2012-04-0072 DISPOSITIF D’AIDES DEPARTEMENTALES 1. CONTRAT DE BASSIN Conformément aux orientations données par les délibérations précédentes, le contrat de bassin est le cadre nécessaire de mise en œuvre des aides départementales en matière de gestion de l’eau. Ce document est un contrat d’objectifs à l’échelle d’une unité cohérente (bassin versant ou sous bassin versant) pour préserver ou reconquérir les ressources en eau et les milieux aquatiques associés. De manière générale, les aides au titre de la politique départementale de l’eau ne sont pas attribuées à un maître d’ouvrage en l’absence d’engagement de celui-ci dans une démarche de contrat de bassin, à l’exception des natures d’opérations suivantes pouvant être aidées hors contrat de bassin : - les travaux en matière d’eau potable, - certains travaux spécifiques : démarche de réduction des produits phytosanitaires, démarche de réduction de la vulnérabilité face aux risques d’inondations et de gestion de la crise (plans communaux de sauvegarde), mise en conformité des branchements d’assainissement. L’engagement d’un territoire dans une démarche de contrat sera jugé au vu des délibérations de principe d’au moins 70 % des collectivités concernées pour s’engager dans cette démarche, acter le périmètre et le porteur du contrat. L’engagement doit être concrétisé par la signature du contrat de bassin dans un délai de deux ans à partir de la uploads/s1/ compte-rendu-groupe-eau-cg91-2012.pdf
Documents similaires




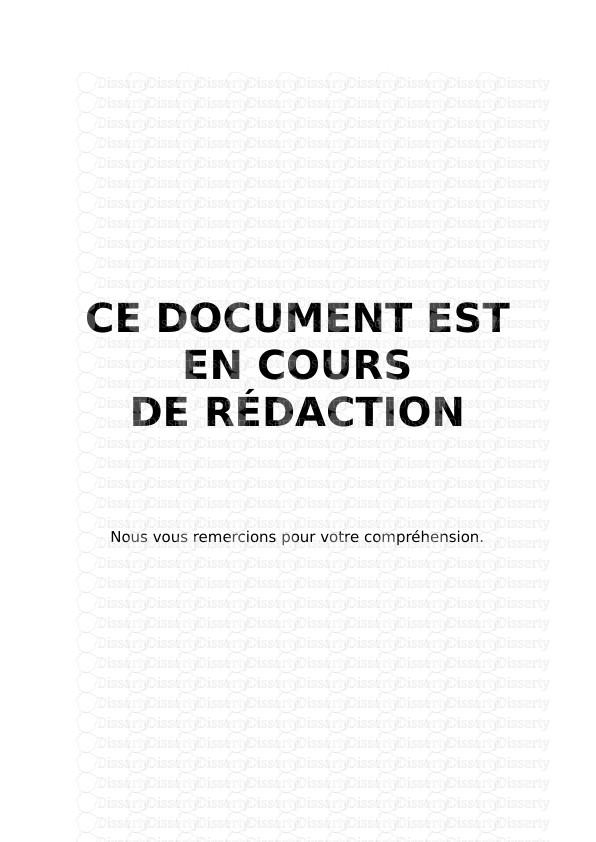





-
111
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 19, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.2554MB


