Évolutions technologiques et multimédia Pour cerner les caractéristiques du mul
Évolutions technologiques et multimédia Pour cerner les caractéristiques du multimédia et comprendre la place et les rôles qu’il peut occuper dans des contextes d’apprentissage des langues, il convient de le situer par rapport aux technologies qui l’ont précédé et qui continuent pour certaines à l’environner. Sous les effets de phénomènes de mode largement encouragés par les milieux économiques concernés, on a trop souvent tendance à laisser une technologie effacer les précédentes, parée qu’elle est de tous les prétendus avantages de la nouveauté. C’est oublier qu’elle s’inscrit dans une filiation, une généalogie qu’il faut examiner pour en saisir les enjeux. À cet égard, le terme même de multimédia est intéressant puisqu’il renvoie aux médias qui l’ont précédé. Le GAME (Groupe audiovisuel et multimédia de l’édition) propose d’appeler multimédia une œuvre qui comporte « sur un même support un ou plusieurs des éléments suivants : texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques » et dont « la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité ». Toute mise en perspective historique du multimédia suppose donc la prise en compte des différents supports qui articulent eux aussi images, son et texte, de même qu’il conviendra de considérer le domaine de l’informatique. Audiovisuel et multimédia Il ne s’agit pas ici de proposer un historique de l’audiovisuel (on sait d’ailleurs que le terme pose d’autant plus de problèmes qu’il renvoie soit à des supports très divers, soit à des pratiques elles-mêmes différentes) (Miège, 1990), mais plutôt d’essayer de comprendre en quoi certaines caractéristiques des supports audiovisuels qui ont occupé une place très importante dans les méthodologies d’enseignement des langues peuvent nous intéresser par rapport au multimédia. Dans un secteur technologique marqué, durant ces vingt dernières années, par des évolutions très rapides, nous chercherons surtout à isoler quelques moments importants. Des images fixes qui perdurent À l’ère du multimédia, il peut paraître curieux, voire anachronique, d’évoquer les images fixes de combinaisons audiovisuelles bien anciennes telles que celles des films fixes que l’on projetait dans une classe, tandis que défilait la bande sonore d’un magnétophone. Pourtant, l’examen d’un certain nombre de supports multimédias, cédéroms de langue mais aussi encyclopédies pour enfants, montre que le recours à des images fixes peut y être important. Si ces images y jouent le même rôle qu’autrefois (images traduction d’un mot vu et/ou entendu, images à mettre en rapport avec un énoncé vu et/ou entendu, images situationnelles permettant de comprendre l’énoncé), l’apport du multimédia vient ici des agencements qui sont proposés ou encore de l’interactivité rendue possible par le programme. En termes d’agencement entre le canal sonore et les images, plusieurs mots ou énoncés pourront par exemple être proposés parallèlement à une même image, tandis que la personne qui consulte le cédérom devra choisir l’énoncé qui correspond à l’image, et ce à des fins de compréhension ou d’évaluation. Le cédérom peut d’autre part donner à la personne qui le consulte la possibilité d’interagir avec ces images. Qu’il s’agisse de produits de langue ou de produits ludo-éducatifs, clic pourra par exemple déplacer des images pour les mettre en correspondance avec des énoncés qu’elle va alors entendre ou qui vont apparaître à l’écran. Les familiers d’informatique savent que certains didacticiels permettaient déjà de telles opérations mais sans la souplesse et la qualité sonore aujourd’hui obtenues. Des images mobiles qui rencontrent déjà le multimédia Si l’on considère maintenant les images mobiles ou animées, on peut chercher à repérer des parentés pour mieux comprendre ensuite les différences qu’il peut y avoir entre des documents télévisés ou vidéo et des supports multimédias ayant recours aux images mobiles. Pour cela, il convient de distinguer différents supports d’images mobiles : nous évoquerons successivement les méthodes télévisées, les documents vidéo, les ensembles multimédia et les émissions satellitaires ou câblées. En se référant à la définition du multimédia proposée précédemment, on constate tout d’abord que tous ces supports d’images mobiles articulaient déjà des images, du son et du texte. C’est donc sur ces articulations et ces rapports qu’il est intéressant de se pencher pour voir ce qui diffère d’un type de document à un autre, avant d’examiner l’apport du multimédia. En ce qui concernera « multicanalité », c’est-à-dire l’agencement d’images mobiles et/ou fixes, de sons et d’écrit dont il a été question dans la définition du multimédia, on note que dès leur première génération, les méthodes télévisées de langue cherchent à optimaliser cette multicanalité. Leurs auteurs ont en effet bien compris qu’elle pouvait faciliter l’apprentissage et qu’elle s’inscrivait dans le droit fil des principes des méthodes audiovisuelles. Ce sont généralement des rapports de redondance ou en tout cas de forte complémentarité entre les trois canaux qui sont mis en place pour faciliter la compréhension des énoncés linguistiques. L’écrit va par exemple apparaître sous forme de cartons (dans les méthodes les plus anciennes) ou bien, plus récemment, à travers des sous-titres et des incrustations, et jouer ainsi différents rôles pédagogiques : aide à la compréhension lorsqu’il s’agit par exemple du sous-titrage d’un dialogue qui peut d’ailleurs être une traduction, fixation de formes grammaticales, variations sur des structures morphosyntaxiques. Si nous avons distingué les méthodes télévisées des documents vidéo, c’est précisément parce que la multicanalité y est différente car ces documents ne prennent pas place dans les mêmes contextes de communication. Les méthodes télévisées diffusées avant l’apparition du magnétoscope s’inscrivent dans un type de communication unidirectionnelle, ce qui veut dire que le téléspectateur ne peut pas interagir avec ces messages. Cette situation explique que les auteurs de ces documents multiplient du même coup les formes de médiation avec le téléspectateur. La multicanalité en est une et elle va aussi souvent être mise en rapport avec d’autres procédés de médiation : présence à l’écran d’un ou deux médiateurs, reprise de scènes ou de séquences avec variations, rappels de scènes avec utilisation d’écrit à l’écran. Lors de l’analyse de cédéroms pédagogiques qui mettent en œuvre l’interactivité, il sera intéressant d’examiner ce que sont devenus ces procédés. Les documents vidéo qui correspondent à la diffusion du magnétoscope présentent des caractéristiques sensiblement différentes. En permettant une communication moins unidirectionnelle que la télévision, puisque la personne qui consulte un document vidéo peut arrêter l’image, revenir en arrière, repasser une scène, le magnétoscope dispense du même coup les auteurs d’avoir recours à certains des procédés évoqués précédemment. Les reprises, variations de scènes, vont le plus souvent disparaître et la multicanalité changer d’aspect. La redondance sera moins systématiquement visée et l’on rencontrera surtout des rapports de complémentarité entre une voix commentaire et des images. Le reportage ou court documentaire semble, en effet, être le genre dominant dans ces documents vidéo qui peuvent appartenir à trois catégories différentes : le document fabriqué, le document didactique ou le document authentique habillé (Lancien, 1991). Dans ce dernier, on peut retrouver un recours important à l’écrit, destiné à travers l’habillage du document à faciliter la compréhension ts d’un document authentique en la préparant ou en la guidant. Dans les deux autres cas, c’est surtout l’écrit présent dans l’image (enseignes, panneaux, etc.) qui sera privilégié. Comme nous l’indiquions à propos des méthodes télévisées, il sera intéressant de voir ce que représente l’apport du multimédia par rapport à ce type d’approche. A côté des méthodes télévisées et des documents vidéo apparaît dans les années soixante-dix, la notion de multimédia appliqué à des objets différents de ceux que le terme désigne aujourd’hui. Dans la mouvance des travaux des ateliers du Conseil de l’Europe, on emploie l’adjectif multimédia pour désigner des ensembles destinés à l’apprentissage et qui articulent trois supports différents. Lorsqu’il s’agit de médias dits de masse, ces ensembles proposent des émissions de télévision parallèlement à des émissions de radio et à des documents dans la presse. Autrement, notamment dans des contextes d’enseignement présentiel, il s’agit de cassettes vidéo, de cassettes audio et de supports papier (livres, livrets). Il est intéressant de comprendre ce qui sous-tend cette démarche qui préside aux travaux de Fitzpatrick (1981) et qui s’est notamment matérialisée à travers la série d’apprentissage de l’anglais Follow me. On peut à notre avis dégager trois idées maîtresses. La première consiste à penser que ces ensembles multimédia auront d’autant plus de potentialités pour l’apprentissage qu’ils permettent de proposer des complémentarités entre les différentes spécificités des trois médias concernés. La seconde concerne les avantages que ces ensembles représenteraient dans l’apprentissage à distance puisque, grâce aux médias de masse, ils devraient permettre de toucher des populations difficilement accessibles sans cela. Enfin, ces ensembles permettraient l'autonomisation, tant en termes d’horaires que de modalités d'apprentissage, les apprenants pouvant privilégier un média plutôt qu’un autre. Si le multimédia d'aujourd’hui est très différent puisqu’il réunit des médias qui restaient matériellement indépendants à l’époque du multimédia, il prolonge celui-ci et peut-être même représente un aboutissement pour ceux qui croyaient aux vertus du croisement des médias. On retrouve à propos du multimédia les potentialités qui étaient mises en avant à propos des ensembles dont il vient d'être question. Aujourd’hui comme hier, la possibilité d’avoir recours à différents médias est perçue comme un avantage par rapport à ce que chacun de ces médias uploads/s1/ cours-tice-1.pdf
Documents similaires




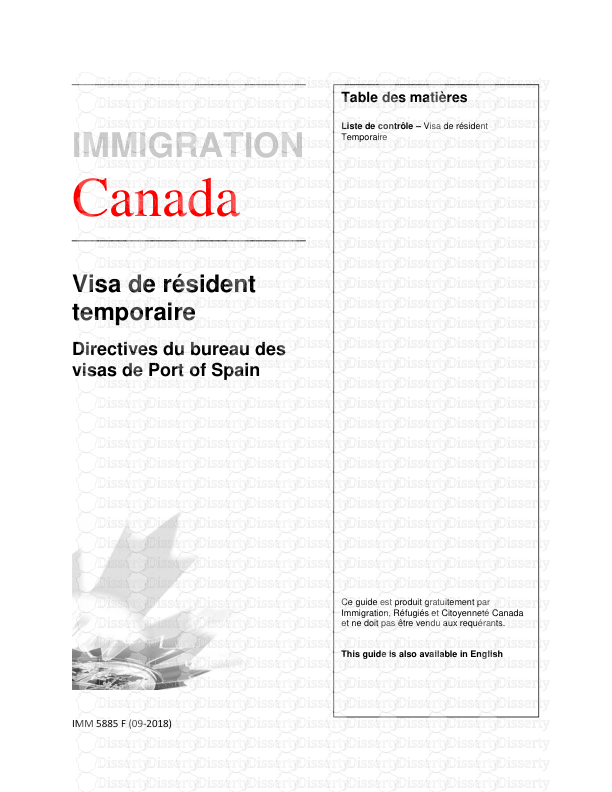





-
128
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 29, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.1444MB


