- » ' k rit pil ' • t *4 ? ! l tri ï • T Ma I .4V / DE LA SYNTAXE FRANÇAISE ENT
- » ' k rit pil ' • t *4 ? ! l tri ï • T Ma I .4V / DE LA SYNTAXE FRANÇAISE ENTRE PALSGRAVE ET VAUGELAS DE LA SYNTAXE FRANÇAISE LNTRE PALSGRAVE ET VÀUGELAS PAR Antoine BENOIST, PROFESSEUR DE SECONDE AU LYCÉE DE GRENOBLE, ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE, AGRÉGÉ DE GRAMMAIRE ET DES LETTRES PARIS E. THORIN, ÉDITEUR Librairie du Collège de France et de FEcole normale supérieure, des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 7, RUE DE MÉDICIS, 7 1877 PC 5.3 g; LIBRARY 734289 UNIVERSITY OF TORONTO A MON MAITRE MONSIEUR CHARLES THUROT MEMBRE DE L'INSTITUT MAITRE DE CONFÉRENCES A L'ÉCOLE NORMALE HOMMAGE DE RECONNAISSANCE ET D'AFFECTION DE LA SYNTAXE FRANÇAISE ENTRE PALSGMVE ET VAUGELAS PRÉAMBULE L'objet de ce travail est d'étudier les transforma- tions qu'a subies la syntaxe française entre le xvi8 et le xvii e siècle. Nous ne nous occuperons en aucune façon de la question du vocabulaire, qui n'est pas moins intéressante, mais qui demanderait une étude à part. Il s'agit seulement pour nous d'analyser les dif- férences qu'il peut y avoir, au point de vue de la syn- taxe, entre une phrase d'Amyot ou de Montaigne, et une phrase de Pascal ou de Bossuet. Il est bien dif- ficile d'enfermer une étude de ce genre entre des dates précises : les changements que subit une langue ne sont point l'œuvre d'un jour ou d'une année; c'est peu à peu, et par un mouvement insensible, que les 2 PRKAMBULB constructions font place à d'autres constructions, que certaines phrases vieillissent et que d'autres tournures leur succèdent et se développent. Tout cela est lent, et l'arbre conserve longtemps des feuilles jaunies à côté de ses feuilles jeunes et vertes. Aussi les limites que nous indiquerons ont-elles un caractère purement approximatif. Nous nous contenterons, pour fixer les idées, de donner comme première date l'année 1530, où parut la Grammaire de Palsgrave, et comme date extrême l'année 1647, où sont publiées les Remarques de Vaugelas. Entre ces deux dates s'ouvre un champ bien vaste. Sans exclure aucun des grands écrivains de cette période, nous nous attacherons surtout à ceux qui étaient considérés au xvir 3 siècle comme faisant autorité en matière de langue , particulièrement à Amyot. Nous rappellerons, non sans quelques restric- tions, la phrase de Labruyère : « On lit Amyot et Coëffeteau ; lequel lit-on de leurs contemporains ? » Nous accorderons aux poètes une moins large place : car si leur étude est essentielle pour bien connaître le vocabulaire de l'époque, elle est beaucoup moins pro- bante en ce qui touche la syntaxe, puisqu'on peut toujours les soupçonner d'avoir altéré leurs construc- tions et modifié leurs phrases suivant les besoins du rhythme. Bien que l'étude de la langue doive se faire direc- tement et d'après les écrivains eux-mêmes, il ne sera pas inutile cependant d'interroger les grammairiens du temps. Témoins souvent inconscients de l'évolution du langage, s'ils ne possèdent ni la perspicacité qui eu devine les lois, ni la méthode sûre qui permet de les tracer, ils ont du moins l'avantage d'avoir vécu dans PREAMBULE 3 le milieu où se sont formés les écrivains que nous étu- dions, et leurs erreurs mêmes sont instructives pour nous, puisqu'elles nous renseignent sur l'état de la science grammaticale au xvi c siècle. Dans la première partie de ce travail, nous analy- serons, au point de vue de la syntaxe française, les principaux grammairiens qui ont écrit depuis 1530 jusqu'à 1580. C'est en 1530 que Palsgrave fait paraître en anglais son Eclaircissement de la langue fran- çaise, c'est-à-dire la première grammaire française qui ait quelque valeur. Peu après, en 1531. Jacques Dubois publie, sous le pseudonyme transparent de Sylvius. une Introduction à la langue française In gallicam linguam isagoge ), écrite en latin suivant la mode du temps. Dix-neuf ans plus tard, en 1550, Louis Meigret fait paraître son Traite de grammaire fran- çaise. C'est le premier livre de ce genre écrit en fran- çais. Le livre de Jean Pilot. intitulé Gallicœ linguœ institution est de la même année. Six ans plus tard, Robert Estienne publie son Traité de grammaire française, qui n'est qu'une imitation as>r j z faible de Dubois et de Meigret. UInstitutio gallicœ linguœ, de Jean Garnier. paraît en 1558. La Grammaire fran- çaise de Pierre de la Ramée, plus connu sous le nom de Ramus, est de 1571. Henri Estienne '1528-1598 n'a point écrit de gram- maire à proprement parler, mais dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans son Traité de la confor- mité du langage français avec le grec, et dans ses Hypomneses de gallica lingua, il a trouvé en passant des vues ingénieuses et frappantes, ou développé avec- talent des idées entrevues par d'autres. » PREAMBULE L'étude de la syntaxe, dans les livres que nous ve- nons d'énumérer, formera la première partie de cette thèse. Nous réserverons pour la tin, et comme cou- ronnement de l'étude des textes, les précieuses Re- marques de Vaugelas, qui par leur date se placent entre l'ancienne langue et la langue nouvelle, et qui nous serviront tout à la fois de résumé et de conclu- sion pour notre travail. ÉTUDE DE LA SYNTAXE FRANÇAISE DANS LES PRINCIPAUX GRAMMAIRIENS DU XVI' SIÈCLE PARTIES DU DISCOURS. La théorie des parties du discours avait été fixée dans ses traits principaux par les grammairiens de l'antiquité. Ils en reconnaissaient huit sur les dix qui sont généralement admises aujourd'hui. Les Grecs et les Romains ne séparaient pas l'adjectif du nom; les Romains n'avaient pas d'article, et les Grecs confon- daient l'interjection avec l'adverbe 1 . La distinction des noms en substantifs et adjectifs, que les grammai- riens anciens semblent avoir entrevue, ne fut nette- ment établie qu'au xn e siècle, au temps d'Abélard 2 . Elle s'efface de nouveau chez les grammairiens du xvi e siècle, qui rompent avec les traditions du moyen 1 Y. Egger. Notion* élémentaires de grammaire comparée (Paris, Durand. 1875 1 , p. 47. • V. Thurot. Notices et extraits des manuscrits, t. XXII Paris, 1868), p. 165, 170, 499. 6 GRAMMAIRIENS DU Wl'' SIECLE âge pour essayer de renouer celles de l'antiquité. C'est ainsi que Palsgrave, <d après lui Meigret et Robert Estienne, reconnaissent oeuf parties du discours, les mêmes que nous admettons aujourd'hui, sauf l'adjec- tif qu'ils confondenl avec le substantif. D'autres, comme Jean Pilot et Jean Garnier, ne comptent que huit parties d'oraison : tons deux rangent dans une même catégorie le nom substantif et le nom adjectif; ils diffèrent en ce que Jean Garnier n'admet pas l'ar- ticle parmi les parties du discours, tandis que Jean Pilot n'y admet pas l'interjection, qu'il considère, avec les drecs, comme une espèce d'adverbe. Ainsi que Jean Garnier, Jacques Dubois ne recon- naît ni l'article ni l'adjectif comme des parties du dis- cours distinctes. Le prénom même, que dans un pas- sage il reconnaît comme une partie d<> l'oraison, il le confond dans un autre avec le nom ; il appelle le pro- nom relatif qui un nom indéfini. Quant à Ramus, il ne prend pas la peine de nous dire combien il admet de parties du discours. On ne peut que conjecturer, en lisant son ouvrage, quelles sont ses idées à ce sujet. Il est permis de croire que pour lui le nom et l'adjectif ne forment qu'une même partie du discours, et il nous dit en termes exprès que le pronom n'est qu'une espèce de nom. Il est probable qu'il y adjoint l'article, bien qu'il ne se soit pas ex- pliqué à cet égard. Il se contente de donner une divi- sion des mots en variables et invariables. NOM — SUBSTANTIF — ADJECTIF. La théorie du nom vient après celle des parties du NOM 7 discours. Nous avons déjà remarqué que la plupart des grammairiens du xvie siècle ne voient pas de dif- férence essentielle entre le nom substantif et le nom adjectif. Suivant Palsgrave, les accidents du nom sont au nombre de six : le genre, le nombre, la personne, la dérivation y la composition, la déclinaison. On voit que cette division comprend des éléments de nature différente. On peut s'étonner de trouver ce que Pals- grave appelle la composition des noms, rangé sous le même chef que le genre ou le nombre. Il est aussi dif- ficile de comprendre pourquoi l'auteur l'ait de la per- sonne un accident ou attribut du nom. La manière dont il divise les noms n'est pas beaucoup plus ration- nelle : après la division des substantifs en masculins et féminins, il en donne deux autres qui ne sont pas du même ordre, et qui n'ont qu'un intérêt secondaire ; telle est la division en mots primitifs et dérivés (une pomme, — un pommier), et en mots simples et com- posés (père, — beau-père). De même, dans ses remarques sur ce qu'il appelle le nom adjectif, il met sur la même ligne les obser- vations relatives à la dérivation des adjectifs, et celles qui concernent les degrés de comparaison ou la cons- truction. L'absence d'ordre et de uploads/s1/ de-la-syntaxe-francaise-entre-palsgrave-et-vaugelas-benoist-antoine-pdf.pdf
Documents similaires




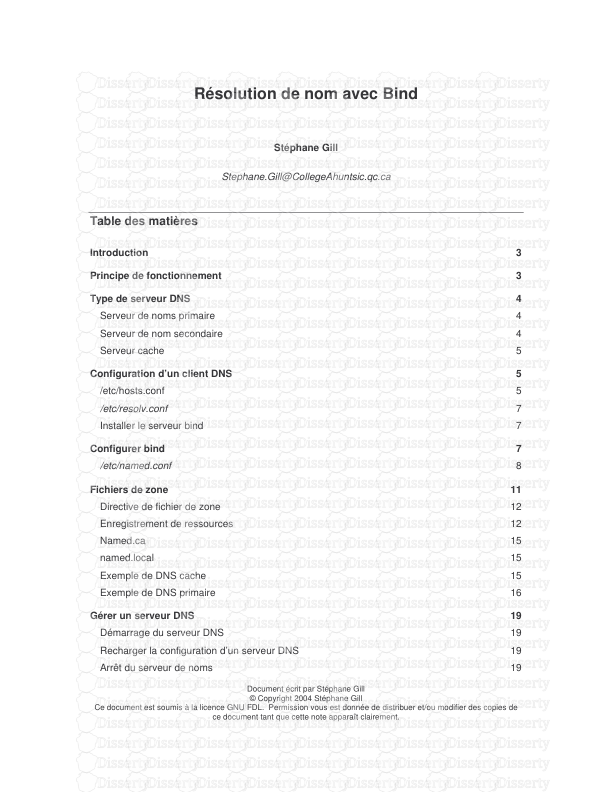





-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 11, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 9.8823MB


