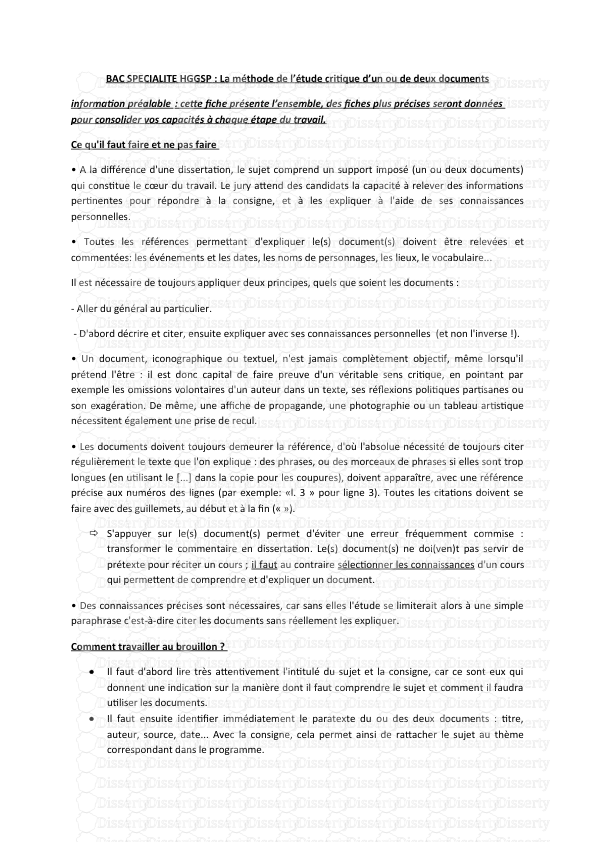BAC SPECIALITE HGGSP : La méthode de l’étude critique d’un ou de deux documents
BAC SPECIALITE HGGSP : La méthode de l’étude critique d’un ou de deux documents information préalable : cette fiche présente l’ensemble, des fiches plus précises seront données pour consolider vos capacités à chaque étape du travail. Ce qu'il faut faire et ne pas faire • A la différence d'une dissertation, le sujet comprend un support imposé (un ou deux documents) qui constitue le cœur du travail. Le jury attend des candidats la capacité à relever des informations pertinentes pour répondre à la consigne, et à les expliquer à l'aide de ses connaissances personnelles. • Toutes les références permettant d'expliquer le(s) document(s) doivent être relevées et commentées: les événements et les dates, les noms de personnages, les lieux, le vocabulaire... Il est nécessaire de toujours appliquer deux principes, quels que soient les documents : - Aller du général au particulier. - D'abord décrire et citer, ensuite expliquer avec ses connaissances personnelles (et non l'inverse !). • Un document, iconographique ou textuel, n'est jamais complètement objectif, même lorsqu'il prétend l'être : il est donc capital de faire preuve d'un véritable sens critique, en pointant par exemple les omissions volontaires d'un auteur dans un texte, ses réflexions politiques partisanes ou son exagération. De même, une affiche de propagande, une photographie ou un tableau artistique nécessitent également une prise de recul. • Les documents doivent toujours demeurer la référence, d'où l'absolue nécessité de toujours citer régulièrement le texte que l'on explique : des phrases, ou des morceaux de phrases si elles sont trop longues (en utilisant le [...] dans la copie pour les coupures), doivent apparaître, avec une référence précise aux numéros des lignes (par exemple: «l. 3 » pour ligne 3). Toutes les citations doivent se faire avec des guillemets, au début et à la fin (« »). S'appuyer sur le(s) document(s) permet d'éviter une erreur fréquemment commise : transformer le commentaire en dissertation. Le(s) document(s) ne doi(ven)t pas servir de prétexte pour réciter un cours ; il faut au contraire sélectionner les connaissances d'un cours qui permettent de comprendre et d'expliquer un document. • Des connaissances précises sont nécessaires, car sans elles l'étude se limiterait alors à une simple paraphrase c'est-à-dire citer les documents sans réellement les expliquer. Comment travailler au brouillon ? Il faut d'abord lire très attentivement l'intitulé du sujet et la consigne, car ce sont eux qui donnent une indication sur la manière dont il faut comprendre le sujet et comment il faudra utiliser les documents. Il faut ensuite identifier immédiatement le paratexte du ou des deux documents : titre, auteur, source, date... Avec la consigne, cela permet ainsi de rattacher le sujet au thème correspondant dans le programme. Puis doit démarrer la lecture attentivement du ou des deux documents. Pour un texte, si ce n'est pas déjà fait sur le sujet, il faut numéroter les lignes (de 5 en 5), car dans le devoir il faudra indiquer les numéros de lignes pour les citations. En lisant le texte, il faut repérer tout ce qui devra être commenté et expliqué : les allusions à des événements, des dates, des noms propres, du vocabulaire... Pour cela, n'hésitez pas à utiliser un code couleur (une couleur pour les événements et une autre pour les noms, encadrer les mots à définir...) et à écrire sur la feuille du sujet. À l'issue de la lecture des deux documents, faites une liste d'idées et de thématiques qu'il faudra développer, puis regroupez-les pour en faire deux ou trois parties. Ensuite, formulez une problématique et rédigez, toujours au brouillon, votre introduction (c'est le seul élément qu'il est conseillé de rédiger dans sa totalité avant de passer au propre). Comment construire le devoir et présenter sa copie ? L'introduction L'introduction doit être particulièrement soignée, car c'est en quelque sorte la « vitrine » du devoir. Elle doit comporter plusieurs éléments, sachant que les éléments 2 à 5 doivent en réalité être présentés ensemble et qu'il n'y a pas d'ordre précis (cela dépend du sujet): - Une accroche , qui consiste à introduire élégamment un sujet par une référence précise à un événement ou à un historien ou bien par une citation significative (elle peut être prise dans les documents s'il s'agit d'un texte). - La présentation du ou des documents , en indiquant leur nature (pour un texte, préciser s'il s'agit d'un discours politique, d'un extrait de mémoires, d'un texte de loi, d'un rapport, d'un article de presse, d'une oeuvre littéraire...) mais aussi, quand cela est possible, leur source (notamment lorsqu'il s'agit d'un extrait qui provient d'un livre). - L'auteur ou les auteurs . Deux cas de figure sont envisageables : L'auteur d'un document est clairement identifiable ; dans ce cas, qui est le plus fréquent, une présentation en quelques lignes de sa biographie est indispensable, sans entrer dans tous les détails : seuls les faits marquants, permettant d'éclairer la compréhension du document, sont utiles, tandis que les détails de sa vie privée sont souvent inutiles à rappeler. L'auteur n'est pas nettement identifiable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un texte de nature juridique (constitution, loi...), d'un tableau de statistiques ou d'une carte ; pour un texte, il est possible d'indiquer qui est l'inspirateur du texte (cela peut être un individu en particulier ou un groupe politique). Il faut également être attentif à la situation de l'auteur par rapport aux phénomènes ou aux événements qu'il évoque : L'auteur peut être un acteur de ces événements, y avoir participé directement : cela doit impérativement être souligné dès l'introduction car cela influence nécessairement son point de vue ; il peut aussi être témoin, y avoir assisté en spectateur, phénomène qui doit être aussi souligné. Inversement, l'auteur peut écrire plusieurs décennies après les faits, cas de figure assez fréquent qu'il faut aussi indiquer. L'auteur peut également avoir une sensibilité politique marquée qui explique le jugement qu'il porte sur tel ou tel événement, qu'il en ait été acteur, spectateur ou ni l'un ni l'autre (écrivant bien plus tard). - La date et le contexte. La première chose à faire est de bien identifier la date des deux documents, car il est nécessaire de présenter en quelques lignes le contexte en fonction du sujet. Il s'agit de présenter les principaux événements et les faits qui permettent de comprendre les documents et de les replacer dans une époque précise. Deux erreurs sont à éviter : remonter trop loin dans le temps et aller au-delà de la date des documents (ce qui, par définition, deviendrait un hors sujet). - L'analyse. Elle a pour but de mettre en évidence, en quelques lignes, les principaux enjeux du ou des documents, leur contenu. - La problématique . Véritable fil directeur de toute l'étude, il s'agit d'une ou de deux questions qui permettent de traiter le sujet. Elle doit obligatoirement arriver à cette étape de l'introduction (ni avant ni après). - L'annonce du plan . Le plan, de préférence en deux ou trois parties, découle logiquement de la problématique car chaque partie doit être conçue comme un élément de réponse à cette problématique. Il est conseillé d'éviter les formulations maladroites du type « Dans une première partie, nous verrons... » pour leur préférer la formulation d'une ou de deux phrases qui montrent la cohérence d'ensemble de la démonstration. Le plan Il n'existe aucun plan « type » pour traiter une étude de document(s). Néanmoins, il est possible d'adopter deux démarches différentes quand il s'agit d'un texte : Faire un plan qui respecte la logique interne du texte : c'est le cas de figure le plus fréquent qui consiste à découper le texte en deux ou trois grands thèmes, correspondant chacun à une partie du texte, qui deviennent les deux ou trois parties du commentaire. Cela suppose évidemment de faire un découpage du texte pertinent et de prendre suffisamment de recul critique dans le cas d'un texte où l'auteur se montre partial et subjectif. Faire un plan qui ne respecte pas la logique interne du texte : dans ce cas, c'est à l'élève d'opérer les regroupements entre les diverses parties isolées du texte pour en faire deux ou trois parties. Cela s'impose pour les textes dans lesquels les propos de l'auteur sont plus ou moins désorganisés, par exemple s'il revient plusieurs fois sur un même thème. ICI : Sauter plrs lignes entre l’introduction et le développement Le développement Articulé en deux ou trois parties, il doit être entièrement rédigé (les titres des parties ne doivent pas apparaître), aéré de manière à pouvoir identifier aisément les paragraphes. Chaque partie correspond à un paragraphe. Il n'est pas nécessaire de faire des sous-parties, mais bien entendu les idées doivent être présentées de manière structurée. La démarche consiste toujours à commencer par citer le ou les documents, en utilisant les guillemets lorsqu'il s'agit d'un texte et en précisant le ou les numéros de lignes, puis à expliquer par les connaissances personnelles. Il ne faut pas faire l'inverse, car alors l'étude de document(e) se transformerait en dissertation. Sautez une ou deux lignes entre chaque partie et faites un alinéa au uploads/s1/ fiche-methode-ecdd-hggsp.pdf
Documents similaires










-
105
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 29, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0714MB