StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Fiches dro
StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Fiches droit administratif S4L2 Droit administratif (Université Jean-Moulin-Lyon-III) StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Fiches droit administratif S4L2 Droit administratif (Université Jean-Moulin-Lyon-III) Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 FICHES – DROIT ADMINISTRATIF PARTIE 1 : LES BUTS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE Deux activités : le service public et la police administrative. Service public : activités qui ont pour but de rendre service au public. Police administrative : activité de préservation de l’ordre public interdictions ou des restrictions à l’exercice de libertés publiques. TITRE 1 : LE SERVIC PUBLIC Service public notion clé du droit administratif qui conditionne l’application d’autres notions. Gaston Jèze : « le service public est une pierre angulaire du droit administratif » c’est autour de la notion de service public que se construisent d’autres notions du droit administratif. CHAPITRE 1 – LA NOTION DE SERVICE PUBLIC I- DÉFINITIONS Plusieurs définitions du service public car : Qualification par le législateur : il ne fait que dire si telle ou telle activité est de SP. Qualification par le juge si pas de qualification législative 1 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 Il n’y a pas de définition générale mais on peut distinguer deux hypothèses : • Lorsque l’activité est gérée par une personne publique • Lorsque l’activité est gérée par une personne privée A- Le service public géré par une personne publique Activité régie par personne publique « présomption » que cette activité est de service public. En effet la JP ne pose que deux conditions pour qu’une activité soit de service public : • Qu’elle soit gérée par une personne publique • Qu’elle soit d’intérêt général 1- Les deux conceptions de l’intérêt général Il y a le modèle anglo-saxon et le modèle continental : Dans le modèle anglo-saxon, l’intérêt général (IG) est perçu comme l’addition des intérêts particuliers. Dans le modèle continentale, l’IG se définit négativement : il est contre les intérêts particuliers, il est une transcendance de ces derniers. 2- Les illustrations jurisprudentielles Pas de définition de l’IG. Le juge qualifie seulement telle ou telle activité d’IG sans vraiment justifier cette qualification définition contingente et relative : elle peut varier au fil du temps car le juge tient compte de l’évolution des mœurs et des mentalités. Il y a un noyau dur des activités d’IG : les activités régaliennes. Au-delà, la notion d’IG s’est étendue en direction des domaines culturels, sportifs et de loisirs : Domaine culturel : CE, 1916 : refus de qualifier d’activité d’IG une activité théâtrale créée par une commune. Mais 7 ans plus tard il a jugé l’inverse. Domaine des loisirs : le CE a considéré que le festival de Cannes était une activité de service public Domaine sportif : les fédérations sportives sont considérées comme gérant un service public CE, Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale, 1994 : parfois le juge peut estimer être en présence d’une activité de service public en fonction de l’exploitation de cette activité. 2 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 Ex : la gestion d’un restaurant sur les pistes de ski n’est pas une activité de service public en soit mais elle peut le devenir si la personne publique impose des conditions particulières d’exploitation. On parle de service public virtuel. B- Le service public géré par une personne privée Deux hypothèses : délégation d’un service public par voie de contrat ou délégation d’un SP en dehors de tout contrat. 1- La délégation du service public par contrat Une personne publique va confier, par contrat, la gestion d’un service public à une personne privée. Contrat de concession ou contrat de marché public. Dans certains cas, le SP préexiste au contrat. Dans d’autres, le SP résulte de la délégation de missions par le contrat. Ex : service public virtuel. Mais à partir de 1938, la JP a consacré les SP gérés par les personnes privées en dehors de tout contrat. 2- Les services publics gérés par les personnes privées en dehors de tout contrat CE, Feutry, 1908 : si une activité d’IG est gérée par une personne publique, on est incontestablement en présence d’un SP. Donc avant 1938, personne publique = service public = juge administratif. Mais les choses se sont complexifiées. À partir de 1938 on admet que les personnes privées puissent être en charge d’activités de service public en dehors de tout contrat. CE, Caisse primaire aide et protection, 1938 : première JP qui admet qu’on est en présence d’une personne privée qui gère un SP. C’est par la suite que le CE a posé un certain nombre de conditions pour qu’on soit en présence d’un SP géré par une personne privée. CE, Narcy, 1963, trois conditions cumulatives : L’activité doit être d’intérêt général L’activité doit être contrôlée par la personne publique La personne privée doit avoir des prérogatives de puissance publique Mais la JP a évolué puisque la troisième condition n’est plus nécessairement exigée. Depuis une CE, Ville de Melun, 1990 : la troisième condition n’est plus requise en présence d’association transparente. 3 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 En 2007, le CE a généralisé les cas dans lesquels la 3ème condition n’est pas requise. CE, APREI, 2007 : cet arrêt reprend la formulation de la JP de Narcy et ajoute que, même en l’absence de prérogatives de puissances publiques, s’il apparaît clairement que l’administration a eu l’intention de créer une activité de service public, alors on est présence d’un SP. Faisceau d’indice : intérêt général, condition de création, organisation, fonctionnement, obligations imposées à la personne privée et mesures prises pour vérifier que les objectifs sont bien atteints. II- COMPARAISONS A- Comparaisons internes 1- La notion de service public en droit constitutionnel Notion qui découle de l’article 9 de la C° de 1946. Depuis cette définition, le CE a dégagé deux conceptions du service public national : Conception d’un service public exigé par la Constitution : ici le Conseil constitutionnel contrôle les privatisations d’entreprises qu’opère le législateur. Il va vérifier que l’activité de l’EP privatisée ne correspond pas à un SP exigé par la Constitution. Conception de la décision du 30 novembre 2006 : ici le législateur peut choisir lui-même si un SP sera national ou pas. 2- Service public et monopole Il ne faut pas confondre SP et monopole. Toutes les activités de SP ne font pas forcément l’objet d’un monopole légal. Il n’y a pas de corrélation automatique entre les deux. B- Comparaisons externes 1- La notion de services d’intérêt économique général C’est une notion visée par l’art. 106 du TFUE. C’est à partir de cet article que la commission de Bruxelles a incité les États membres de l’UE à ouvrir à la concurrence les grands SP nationaux. Cet article a fait l’objet d’une interprétation évolutive : Au départ on disait que ces activités de service d’intérêt économie général devaient être ouvertes à la concurrence sauf si la concurrence remettait en cause les missions d’un service public. Maintenant les État membres ont adopté des directives européennes conduisant à ouvrir à la concurrence. 4 Téléchargé par benjamin duvaut (etude.marche@sfr.fr) lOMoARcPSD|4317033 2- Le service universel Cette notion se retrouve dans des directives européennes qui conduisent à ouvrir à la concurrence un certain nombre de secteurs. Les États membres peuvent, tout en ouvrant leur réseau à la concurrence, mettre en place un service universel, pour faire en sorte de garantir l’accès à ce service à un prix abordable. III- LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DU SERVICE PUBLIC A- La distinction SPA/SPIC 1- Les critères de la distinction TC, bac d’Éloka, 1921 : dans cette affaire le TC attribue la compétence au juge judiciaire alors même que : On est en présence de la responsabilité d’une personne privée Il reconnaît la présence d’un service public. Il reconnaît implicitement l’existence d’un SPIC. Il dit que certains services sont de la nature même de l’État alors que d’autres sont de nature privée. On juge donc que certaines activités exercées par les personnes publiques et qui sont des SP ont des caractères de service commercial. Suite de cette décision : TC, Dame Mélinette, 1933 : consécration de l’expression « SPIC ». Quels sont les critères permettant de distinguer un SPA d’un SPIC ? CE, Union Syndicale des Industries Aéronautiques (USIA), 1956 : 3 critères : L’objet du service en question : on regarde si le service public relève plus naturellement d’une personne publique ou d’une personne privée. Ex : SPA hôpitaux, culture… Dans certaine matière, la nature privée ou publique de l’objet est discutée et peut même évoluer dans le temps. L’origine des ressources du SP : si le SP est financé par des usagers (ressources privées), c’est un SPIC. S’il est financé par les impôts, c’est un SPA. S’il y a les deux financements, le juge va regarder quel est le financement principal Les conditions d’organisation et de uploads/s1/ fiches-droit-administratif-s4l2.pdf
Documents similaires

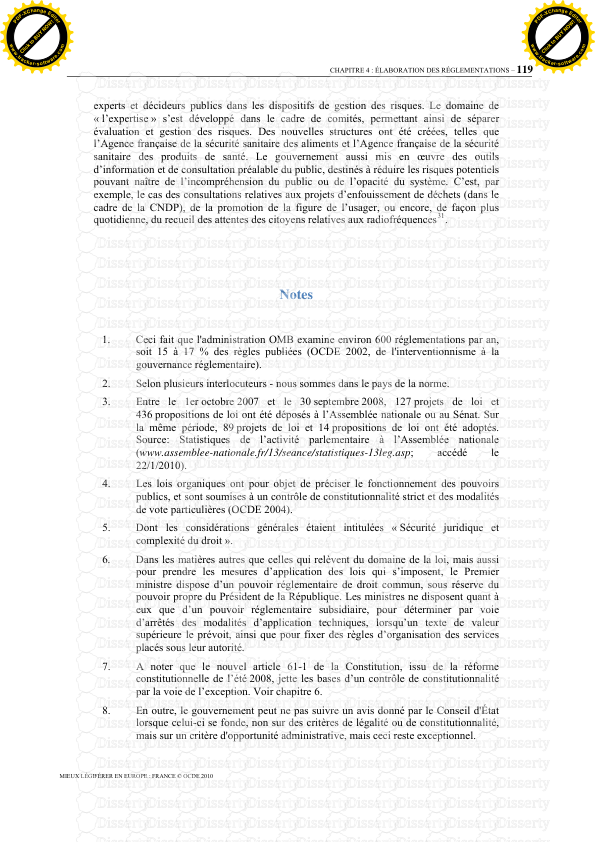








-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 20, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.4755MB


