HAL Id: halshs-01875020 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01875020 Sub
HAL Id: halshs-01875020 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01875020 Submitted on 15 Sep 2018 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. GÉOPOLITIQUE DES TERRITOIRES FRANÇAIS : DÉCENTRALISATION VERSUS RECENTRALISATION Gérard-François Dumont To cite this version: Gérard-François Dumont. GÉOPOLITIQUE DES TERRITOIRES FRANÇAIS : DÉCENTRALISA- TION VERSUS RECENTRALISATION. Diploweb.com : la revue géopolitique, Diploweb.com, 2018, pp.1-21. <halshs-01875020> 15/09/2018 21)00 Page 1 sur 21 https://www.diploweb.com/spip.php?page=imprimer&id_article=1924 Retour à l'accueil du site | Retour à l'article Géopolitique des territoires français : décentralisation versus recentralisation Par Gérard-François DUMONT*, le 15 septembre 2018. La recentralisation française entamée à la fin des années 1990 redonne à Paris un poids géopolitique interne de plus en plus prédominant sur les territoires français même si la domination centrale s’exerce de façon plus indirecte et sournoise qu’avant les lois de décentralisation de 1982- 1983. Gérard-François Dumont brosse ici une analyse très solidement documentée qui fera référence. PENDANT plusieurs siècles de centralisme royal, impérial ou républicain, les rapports de force entre les territoires français étaient simples : d’un côté Paris, où pratiquement tout se décidait, de l’autre la province, c’est-à-dire l’ensemble des autres territoires traité comme de simples sujets. La littérature illustre cette dualité par exemple avec les personnages de Molière dans Les précieuses ridicules : « Madelon : Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit, de la galanterie. » « Mascarille : Pour moi je tiens que, hors de Paris, il n’y a pas de salut pour les honnêtes gens. » « Cathos : C’est une vérité incontestable. » [1] Ainsi, pendant des siècles de pouvoir central fort autoritaire, les chartes communales, précédemment accordées par des rois, des comtes ou des ducs locaux au Moyen Âge, ne sont guère plus respectées. C’est seulement en 1884, par une loi municipale, que la France affirme l’existence propre des communes, avec l’élection au suffrage universel du conseil municipal et l’instauration d’une clause générale de compétence. Toutefois, la tutelle de l’État, notamment avec son représentant départemental le préfet, reste forte, à la fois sur le maire et sur les actes de la commune. Quant aux départements [2], ils demeurent gérés par l’État puisque leurs fonctionnaires sont sous la seule autorité du préfet. Il faut attendre un siècle plus tard, 1982, pour que soit mise en place, dans un contexte que nous préciserons d’abord, une décentralisation [3] permettant aux communes, aux départements et aux régions d’avoir des compétences affirmées et, dans une certaine mesure, la possibilité de les exercer. En dresser un bilan est nécessaire. Mais, depuis la fin des années 1990, la libre administration des collectivités territoriales n’a-t-elle pas été écornée ? Les multiples décisions de recentralisation ne remettent-elles pas la France sous des contraintes jacobines sans équivalent depuis un demi-siècle ? 15/09/2018 21)00 Page 2 sur 21 https://www.diploweb.com/spip.php?page=imprimer&id_article=1924 Gérard-François Dumont Gérard-François Dumont est Professeur à l’université Paris-Sorbonne I. De la décentralisation... Les sources de la décentralisation Avant la décentralisation de 1982, le pilotage des politiques publiques se trouve essentiellement dans les mains de l’État. Ce dernier décide depuis Paris les modalités de définition des questions publiques et les programmes d’action concernant tous les territoires, même s’il lui arrive de négocier localement la mise en œuvre de ses politiques en s’appuyant sur deux ressources essentielles : l’allocation d’argent, et la réglementation. Il est vrai que, dans la France des années 1950-1960, l’État dispose en abondance de ressources financières qui lui permettent de s’imposer à des collectivités locales mal dotées et d’offrir des subventions à celles qui voudront bien accepter les objets qu’elles sont censées financer et les procédures ou normes à satisfaire. « Les collectivités locales n’ont pas la maîtrise des règles du jeu, même si leurs élus participent à la vie parlementaire, car ils sont prisonniers d’une logique distributrice qui se nourrit de leurs propres besoins. À travers son administration, l’État pèse donc d’un poids capital sur les collectivités locales. Cet activisme entrepreneurial des technocrates de l’État se traduit par une multiplication de programmes sectoriels nationaux, chacun étant confié à un service ministériel particulier. La verticalisation des politiques et la segmentation des enjeux privilégient la réalisation d’équipements et d’infrastructures posés sur le sol au hasard des allocations décidées par l’État et mal intégrés entre eux » [4]. 15/09/2018 21)00 Page 3 sur 21 https://www.diploweb.com/spip.php?page=imprimer&id_article=1924 À compter du milieu des années 1970, donc après le fin de ce que Jean Fourastié a appelé les « Trente glorieuses », arrivent la crise économique et la fin du plein- emploi. L’État ne parvient plus à répondre mécaniquement au chômage ou à l’exclusion. Il en vient à manquer de ressources financières pour prendre en charge à lui seul la couverture et le financement des besoins des territoires. Or, tandis que l’idée de décentralisation a fait son chemin depuis le fameux livre de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, dont la première édition a paru en 1948. La France se rappelle alors la phrase de Gœthe : « Ce serait un grand bonheur, pour la belle France si, au lieu d’un centre, elle en possédait dix répandant tous la lumière et la vie », ou les analyses de son grand géographe, Paul Vidal de La Blache (1845-1918) considérant en 1910 que « le temps n’est plus de chercher dans la centralisation le secret de la force » [5].S’ajoutent les déclarations, plus récentes, du général De Gaulle, alors président de la République, prononçant le 24 mars 1968, à Lyon, un discours en rupture avec le centralisme d’État en déclarant : « L’effort multiséculaire de centralisation qui fut longtemps nécessaire à la nation pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées ne s’impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain ». L’ambiance est donc favorable à ce que l’État appelle la montée d’intervenants locaux. Il décide en conséquence d’externaliser sur les collectivités locales les coûts d’une gestion rapprochée, en particulier dans le domaine social dont les budgets s’accroissent. Les principes et les modalités de la décentralisation En conséquence, au début des années 1980, dans le contexte de l’alternance politique droite/gauche, la France met en œuvre une décentralisation sans précédent historique. Cette dernière s’effectue au nom de principes à préciser débouchant sur des transferts de compétences. Les principaux objectifs énoncés par Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur en charge de la question, sont au nombre de trois. Il s’agit d’abord de rapprocher les citoyens des centres de décision, notamment pour prendre en considération les nouvelles aspirations sociales qui s’expriment localement, comme le souci identitaire des territoires qui, selon le rapport du député Jean-Pierre Worms sur la loi du 7 janvier 1983, préfèrent « l’unité nationale librement choisie à l’uniformité administrativement imposée ». Ensuite, responsabiliser les élus et leur donner de nouvelles compétences, afin de rendre l’administration locale plus efficace car plus proche des décideurs. Enfin, favoriser le développement d’initiatives locales dans le contexte d’une économie dont le ressort ne dépend plus exclusivement de la politique économique nationale, mais également des dynamiques locales. Trois lois fondamentales, datées du 2 mars 1982 et des 7 janvier et 22 juillet 1983, 15/09/2018 21)00 Page 4 sur 21 https://www.diploweb.com/spip.php?page=imprimer&id_article=1924 fondent la décentralisation. La première fixe les règles générales et les secondes la répartition des compétences. Les principales mesures modifiant la géopolitique interne de la France concernent d’abord le transfert de l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général [6], la reconnaissance de la capacité d’intervention économique des collectivités territoriales, et l’érection de la région en collectivité territoriale à part entière avec un élargissement et un transfert des compétences du Préfet de région au président du conseil régional. Cette affirmation des régions comme collectivité territoriale nouvelle est la mise en application d’idées antérieures, comme celle de Pierre Mendès France écrivant dans son livre La république moderne, publié en 1962 : « la région est une réalité économique ; mais elle n’a trouvé jusqu’ici aucune expression institutionnelle ». Parallèlement, la loi supprime toute tutelle a priori, instaurant un contrôle de légalité a posteriori. En matière financière, la tutelle des services financiers de l’État dans le domaine des actes budgétaires cesse. Un contrôle a posteriori, exercé par une nouvelle juridiction, la chambre régionale des comptes, est instauré. Les principaux transferts des compétences sont effectués à la commune en matière d’urbanisme, aux départements en matière de transports scolaires, d’action sociale et de santé, d’environnement, et de collèges (précisément construction, équipement, entretien et fonctionnement), et à la région en matière de planification, d’aménagement du territoire, de formation professionnelle, d’apprentissage et de lycées (soit également construction, équipement, entretien et fonctionnement). Ces décisions se mettent en uploads/s1/ geopolitique-des-territoires-francais-de.pdf
Documents similaires
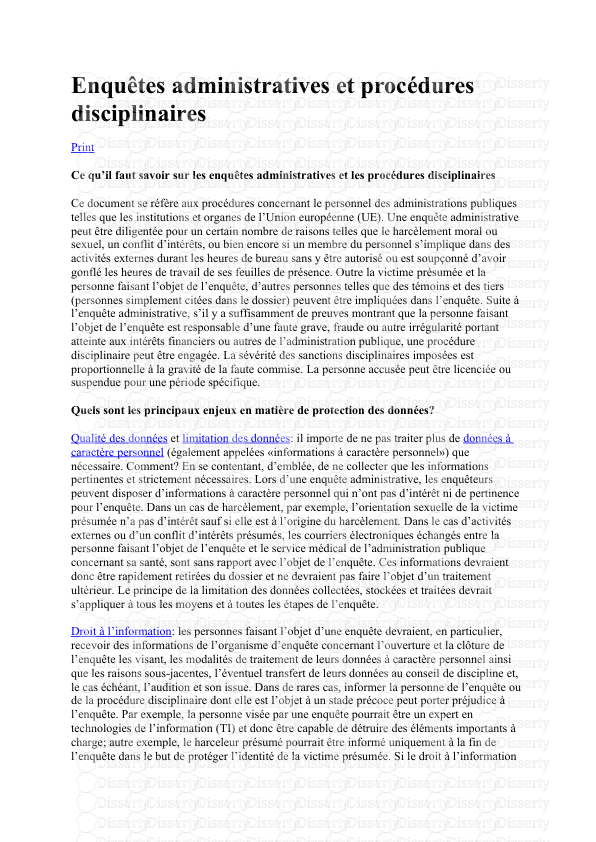









-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 27, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.3528MB


