1 Titre 2 : Les juridictions de l’ordre administratif Litige où est impliquée u
1 Titre 2 : Les juridictions de l’ordre administratif Litige où est impliquée une personne morale de droit public. Pendant longtemps, ils étaient jugés par le supérieur hiérarchique de celui qui a contesté la décision. Le justiciable qui souhaitait attaquer, devait saisir le supérieur hiérarchique de la personne morale de droit public. En général c’est le ministre. Période du ministre juge. Organe crée : le Conseil d’Etat (il ne conseillait que les ministres saisis d’un litige administratif) Loi du 24 mai 1872 a confié au Conseil d’Etat le soin de juger à la place des ministres tous les litiges administratifs. Période de la justice déléguée. Le double ordre de juridiction a été créé à la suite de cette loi. Pour désengorger le Conseil d’Etat, en 1953 on a créé les tribunaux administratifs. D’abord le litige passait par tribunaux administratifs ensuite il y avait appel et cassation : Conseil d’Etat. En 1987, création d’une cour administrative d’appel. (CAA) Chapitre 1 : les juges du fond de l’ordre administratif SECTION 1 : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE DROIT COMMUN Depuis ces réformes, l’ordre administratif compte deux juridictions de droit commun. Paragraphe 1 : Le 1er degré : Le tribunal administratif Il est la juridiction de droit commun de l’ordre administratif au premier degré. Décret du 30 septembre 1953 : remédier à l’encombrement du Conseil d’Etat. A) Organisation du Tribunal administratif 1) Le ressort territorial Il s’étend à un nombre de départements variant de deux à cinq. C’est une juridiction interdépartementale. Un décret ministériel donne le nombre de départements en fonction de la population et du nombre de contentieux. (Aujourd’hui 42 TA en France) 2) La composition - juges appelés des conseillers et dans chaque tribunal le nombre de conseillers varie en fonction de l’importance du TA. Ils sont recrutés parmi les ENA (école supérieure de l’administration). Il existe d’autres moyens pour intégrer la juridiction administrative (élus de la République ou fonctionnaires). - Ils sont nommés par décret du Président de la République. - Les TA sont répartis en chambre (1 pour le plus petit, 18 pour Paris) quand il y en a beaucoup elles peuvent elles-mêmes être subdivisées en section. - IL y a un Président de TA qui assure l’administration générale de sa juridiction et affecte le personnel dans les différentes chambres et procède à la notation des conseillers. Il assure aussi la discipline dans sa juridiction. Le Président de TA est secondé par un ou plusieurs vice-présidents. Devant le TA, le ministère public est permanent, composé d’un conseiller appelé le rapporteur public. 3) Le fonctionnement o le TA rend des jugements, audiences publiques avec un cérémonial beaucoup moins important que devant les juridictions judiciaires. Les audiences ne se déroulent pas forcément dans une salle d’audience (par exemple dans une salle de cours). Il n’y pas de solennité. Les conseillers ne portent pas de toges. Le ministère d’avocat est en principe obligatoire mais il y a des exceptions : si contentieux de l’excès de pouvoir ou en matière de travaux publics ou en matière électorale, en matière de contrat administratif, en matière de contravention de grande voierie, en 2 matière fiscal ou dans les litiges individuels de la fonction publique. C’est une formation collégiale (3 conseillers) mais ce principe connaît des exceptions (le TA intervient à juge unique) : o Les litiges relatifs aux impôts locaux o Les actions de responsabilité dirigée contre les collectivités publiques lorsque le montant de l’indemnité réclamé est inférieur à 8000 euros. Il peut à tout moment renvoyer l’affaire à la formation collégiale. o Le Président du TA a des compétences juridictionnelles propres : il intervient seul. Il est juge des référés (juge de l’urgence), il peut statuer par ordonnance sur des questions simples relatives au déroulement de la procédure notamment le président peut seul prononcer une dispense d’instruction. o Le TA peut se réunir en formation plénière : le ou les vice-présidents du TA se rejoignent à la chambre à laquelle appartient le contentieux (au moins 4 conseillers alors). La chambre peut intervenir sur décision du Président du TA (donner une plus grande autorité à la décision du TA) B) La compétence du TA 1) La compétence territoriale - Le critère du domicile du défendeur est inadapté devant le TA parce qu’il aurait pour résultat que de concentrer le contentieux qui implique l’Etat à Paris. Art R 312-1 du code de justice administrative : celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision d’attaquer ou signer le contrat litigieux. On prend en compte des délégations que l’Etat peut donner l’autorité. - En matière contractuelle, ce sera le lieu d’exécution du contrat. - En matière de responsabilité d’une personne civile, la compétence est donnée au tribunal du fait générateur. - Si c’est un litige par rapport à l’immeuble, ressort du tribunal où l’immeuble est situé. Pour les litiges individuels relatifs à des agents publics, le tribunal compétent est celui du lieu d’affectation de l’agent. 2) La compétence d’attribution a) Les attributions consultatives Le TA exerce une mission de conseil à l’échelon local au profit du préfet du département (R 212-1 du code de justice administrative) le préfet du département peut demander des conseils juridiques aux TA : c’est un avis (consultatif) qui ne lit pas le préfet des départements. b) Les attributions juridictionnelles Il a compétence pour connaître de tout litige administratif qui n’est pas spécialement attribué à une autre juridiction administrative. (La personne morale de droit public doit être impliquée) Les litiges qui relèvent d’une juridiction administrative spécialisée et les litiges qui relèvent de la compétence directe du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (ex : acte administratif à portée générale). Lorsque le TA intervient, un appel peut toujours être interjeté ainsi qu’un pourvoi en cassation sauf exceptions (premier et dernier ressort) comme par exemple les litiges par rapport à la redevance audiovisuelle ou les recours relatifs aux impôts locaux. Paragraphe 2 : La cour d’appel administrative Créée en 1987. Avant les appels formés contre un tribunal administratif étaient renvoyés au Conseil d’Etat. Il était encombré. La loi du 31 décembre 1987 a créé les cours administratives d’appel, elles sont les juridictions administratives de droit commun du second degré. A) L’organisation de la Cour Administrative d’appel 1) Le ressort territorial (1987 : cinq cours créés à Lyon, Bordeaux, Nancy, Nantes et Paris) Elles étaient rapidement encombrées donc il a fallu en créer trois nouvelles (Marseille 1997, Douai 1999, Versailles 2004). Ces CAA apparaissent comme des juridictions régionales et leur ressort territorial est celui de 3 à 5 ressorts territoriaux de TA. 3 2) La composition La Cour d’Appel Administrative est composée de : - conseillers et leur nombre dépend de la population et du contentieux administratif. - Ils sont recrutés parmi les conseillers du TA et ont une certaine ancienneté. - D’autres peuvent être nommés sans être passés par TA. Ils sont regroupés en chambre, chaque CAA est divisée en un nombre de chambre qui varie selon l’importance du contentieux et densité de la population (décret ministériel qui fixe le nombre, actuellement 3 à 9). - Chaque chambre a un Président. Chaque CAA a aussi un Président qui est un conseiller d’Etat en service ordinaire. Il a les mêmes missions que celles du TA. - Le nombre de vice-présidents dépend. - Il y a un ministère public permanent (un ou plusieurs rapporteurs publics) 3) Le fonctionnement - La Cour d’Appel administrative rend des arrêts, en audiences publiques. - Le ministère d’avocat est obligatoire sauf quelques exceptions. - Elle intervient : soit en formation ordinaire (composée de 3 conseillers : le Président de la chambre concernée) : lorsque la difficulté ou la nature de l’affaire le justifie on peut élargir cette formation à 5 membres ; soit en formation plénière : elle peut le faire sur décision du Président de la CAA s’il veut donner une plus grande autorité à la décision. (composée des Présidents de chambre, du conseiller rapporteur, du Président de la Cour d’Appel Administrative et d’un autre conseiller de la CAA). - Elle peut intervenir à juge unique : le Président de la CAA est investi de pouvoirs juridictionnels propres : juge des référés. B) La compétence 1) Compétence territoriale Tous les appels formés contre un Tribunal Administratif si ce TA est placé dans le ressort territorial de cette Cour d’Appel Administrative 2) Compétence d’attribution a) attributions consultatives la CAA peut conseiller peut conseiller le Préfet de région. (Art R 212-1) b) attributions juridictionnelles Les CAA sont au second degré les juridictions de droit commun de l’ordre administratif. Donc, elles ont vocation à connaître des appels formés contre les jugements rendus par les TA placés dans leur ressort territorial dès lors que cet appel n’est pas attribué à une autre juridiction. Sont exclus de sa compétence les appels formés dans le contentieux de la légalité, de l’excès de pouvoir, des élections municipales ou cantonales car ces appels-là relèvent de la compétence du Conseil d’Etat ; et les appels formés contre les juridictions autres qu’un TA. uploads/s1/chapitre-1-juges-du-fond-de-l-x27-ordre-adm.pdf
Documents similaires






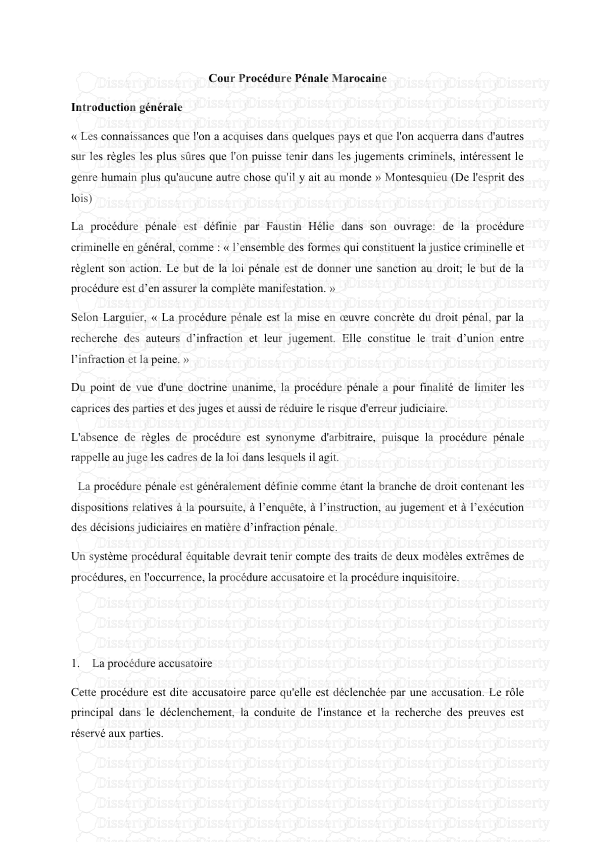



-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 07, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.4985MB


