Une lecture des Adages d’Érasme, entre bibliographie rêvée et bibliothèque idéa
Une lecture des Adages d’Érasme, entre bibliographie rêvée et bibliothèque idéale Isabelle Diu École nationale des Chartes (Paris) Les Adages d’Érasme ont représenté l’un des plus grands succès de librairie de la Renaissance1 : cet ouvrage, en chantier permanent durant la vie de l’humaniste2, a fait l’objet d’un 1 L’édition de référence des Adages est aujourd’hui celle des œuvres complètes d’Érasme, en cours de publication. Les Adages comprennent six volumes : Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Amsterdam, 1969-, II, 1- 6. Cette édition sera désignée par le sigle A.S.D. À noter également que les Adages sont disponibles en traduction anglaise intégrale dans les Collected Works publiés aux Presses universitaires de Toronto. Mentionnons également la publication, à l’automne 2011, de l’édition bilingue intégrale des Adages aux Belles Lettres sous la direction de Jean-Christophe Saladin. 2 Les lettres où l’humaniste avoue remettre l’ouvrage sans cesse sur le métier sont légion, notamment les préfaces à ses différentes éditions. Voir P. S. Allen, www.revue-analyses.org, vol. 6, nº 2, printemps-été 2011 32 nombre considérable d’éditions, du vivant même de son auteur ; il a rencontré un succès prodigieux auprès d’un large public comme dans les cercles érudits3. Les éloges incessants dont les milieux humanistes ont couvert l’ouvrage ont contribué à bâtir la renommée d’Érasme et à asseoir définitivement sa réputation comme homme de lettres4. Les raisons en sont faciles à comprendre : d’un accès aisé, presque ludique, composé comme en passant5, l’ouvrage semble véhiculer une sorte de sagesse populaire ; pourtant, il s’appuie sur les autorités les plus prestigieuses, révèle de hautes qualités rhétoriques et s’avère ancré dans la réalité la plus contemporaine. Bien loin de n’être qu’une simple compilation à usage éthique, l’œuvre ressortit à la catégorie des essais rhétoriques et esthétiques. D’un même mouvement, il met à portée du grand nombre, avec un réel talent pédagogique, les trésors de la sagesse antique, sous une forme nouvelle et proprement humaniste : en restituant la lettre même des textes. Cette sorte d’anthologie de la littérature antique est donc aussi une forme de manifeste de l’humanisme lettré. Les analyses récentes des Adages se sont attachées à mettre en valeur son caractère linguistique et rhétorique : pour Jacques Chomarat, l’œuvre se veut un « manifeste des droits de 1906-1958, 12 vol. Les renvois à cette édition seront indiqués comme suit : Allen, suivi du tome et du numéro de la lettre. Les préfaces aux Adages sont les suivantes : I, 126 ; I, 211 ; I, 269 ; IV, 1204 ; VI, 1659 ; VII, 2022 ; X, 2773. 3 T. J. Arnold, 1897 : sous le titre Adagiorum Collectanea, on dénombre trente- cinq éditions avant 1536 ; les éditions des Chiliades sont au nombre de seize. Un grand nombre d’épitomè ont également contribué à la diffusion de l’œuvre : quinze éditions abrégées ont paru du vivant d’Érasme. 4 Pour une étude d’ensemble de l’œuvre, on se reportera à Phillips, 1964. 5 Voir la préface à la première édition en 1500 (Allen, I, 126), où Erasme se compare au promeneur qui cueillerait des fleurettes dans un jardin pour en tresser une guirlande. ISABELLE DIU, « Une lecture des Adages d’Érasme » 33 la grammaire » qui se dégage d’une silva, forêt broussailleuse, d’un supellex ou matériau constitué de toutes les expressions utiles à l’écrivain et frappantes pour le curieux (p. 761-782) ; pour Claudie Balavoine, l’ouvrage se situe «sur le plan du langage et du savoir, non de la conduite morale » (p. 9-23) ; il cristallise finalement autour de l’adage toute une conception de la culture. Cependant, le texte même des Adages, son contenu comme sa structure, ainsi que la forme matérielle qu’affectent les diverses éditions du texte imprimé, invitent, en raison de leur complexité, à une lecture polysémique. On peut notamment se demander si cet ouvrage multiforme ne serait pas aussi à lire comme une tentative bibliographique, emblématique de l’humanisme, à laquelle Érasme lui-même et ses imprimeurs nous inviteraient, rassemblant les autorités idéales en un panthéon des auteurs classiques et de leurs grands textes. Nous nous aventurerons donc à cette lecture, en considérant tout d’abord les Adages comme le lieu de construction d’un canon bibliographique, puis en confrontant ce modèle idéal avec les lectures d’Érasme, repérables par le biais de bibliothèques de prédilection — la sienne propre, mais aussi celles d’autres cercles humanistes — et à travers l’énoncé de ses choix littéraires. L’évolution des enjeux au fil des éditions On ne saurait séparer l’étude du texte des Adages de celle des diverses éditions qui les ont fait connaître : les enjeux de l’ouvrage rejoignent en effet les choix éditoriaux et le contenu de l’œuvre évolue en fonction de sa mise en texte. www.revue-analyses.org, vol. 6, nº 2, printemps-été 2011 34 Les Adages ne sont pas seulement le premier recueil de proverbes latins, même si Érasme le présente comme tel6 ; ils s’affirment surtout comme une première tentative pour ouvrir, par le biais des proverbes, des perspectives sur le monde antique. L’œuvre affecte une forme assez codifiée : les adages choisis sont tirés pour l’essentiel des grands auteurs classiques de l’Antiquité, auxquels s’ajoutent quelques citations bibliques et patristiques ou, plus rarement, des textes d’auteurs contemporains. Les adages sont d’abord reproduits sous leur forme latine et, le cas échéant, leur forme grecque ; ils sont suivis d’autant de références qu'Érasme avait pu en recueillir chez les auteurs qu’il avait à sa portée. Les citations se présentent souvent accompagnées d’un renvoi précis à l'œuvre, au chapitre, au vers ou au verset. L’importance, au moins théorique, attachée à la précision des références est attestée par la préface de la nouvelle édition parue en 1526 dans l’atelier de Froben à Bâle (Allen, 1906, VI, 1659). Cependant, en dépit de la revendication d’un authentique travail d’écriture (negocium) aboutissant à une œuvre (opus), suivant une 6 Voir les différentes préfaces aux éditions des Adages. L’édition princeps des Adagiorum collectanea signale, dès 1500, la nouveauté de l’entreprise, du moins chez les Latins : « Porro apud Latinos nemo quidem ante nos, quod sciam, huiusmodi negocium tentavit » ; « Chez les Latins, personne avant moi, que je sache, n’a tenté une entreprise de ce genre » (Allen, I, 126, l. 95-96) ; dans la préface à la troisième édition, celle des Chiliades parue en 1515 chez Froben, Érasme réitère l’affirmation (Allen, I, 269, l. 58) ; enfin, la dédicace de la dernière édition à laquelle il met la main de son vivant, en 1533, est presque entièrement consacrée à la défense de sa primauté comme auteur de recueils d’adages : s’il reconnaît avoir lu l’ouvrage de l’Italien Polydore Virgile, initialement paru sous le titre de Proverbiorum libellus en 1498, puis réédité en 1500 au même moment que les Adagiorum collectanea avec un intitulé comparable — Adagiorum liber —, Érasme revendique néanmoins la première place. Négligeant l’édition de 1498, peut-être en toute bonne foi, il prétend avoir l’antériorité de la publication de ce type d’ouvrage et clame sa supériorité quant à la qualité et à l’ampleur de l’œuvre (Allen, X, 2773). ISABELLE DIU, « Une lecture des Adages d’Érasme » 35 méthode précise (ratio)7, Érasme n’impose aucun ordre à ce qui se présente comme une libre succession de citations ; l’ouvrage se veut miscellané, à la façon des Nuits attiques d’Aulu-Gelle ou des Saturnales de Macrobe, qui figurent d’ailleurs au nombre de ses sources. Cette mosaïque de références et de commentaires n’offre, dans le corps du texte, aucune explication didactique sur le genre de l’œuvre ou sur la nature de l’adage. Pour trouver la définition du proverbe selon Érasme, le lecteur doit se reporter à deux textes liminaires : la préface de la première édition des Collectanea, en 1500, dédiée à lord William Mountjoy (Allen, I, 126), et l'introduction, intitulée Quid sit paroemia, souvent désignée sous le titre de Prolegomena, qui précède le texte des Adages à partir de l’édition aldine de 1508 (ASD, 1969, II, 1, p. 45-82). Deux caractéristiques distinguent, selon Érasme, les expressions qu’il recueille et auxquelles il accorde valeur proverbiale : leur notoriété et leur originalité8. Ainsi Érasme peut-il orienter son ouvrage comme il l’entend, fonder ses choix sur sa conception du langage et de la rhétorique et ne se cantonner ni à une nomenclature de type lexicographique ni à un recueil de pensées gnomiques. C’est dire toute l’importance que revêtent ces discours théoriques, lors même qu’ils sont apparemment relégués en dehors du texte, dans le discours paratextuel. Outre la définition des adages, le but de l’ouvrage s’y voit également précisé : s’il s’agit de transmettre au public 7 Allen, I, 126, l. 96 et l. 199 : « Reliquum esse puto ut in opere nouo quid secuti simus rationem reddamus » ; « Il me reste, je pense, à rendre compte de la méthode que j’ai suivie dans un ouvrage d’un genre tout nouveau ». 8 « Paroemia est celebre dictum, scita quapiam novitate insigne », Quid sit paroemia, ASD, II, 1 ; p. 46, l. 44-45. La traduction qu’en donne Claudie Balavoine (p. 13) est d’une parfaite précision uploads/s3/ 612-texte-de-l-x27-article-940-1-10-20120817 1 .pdf
Documents similaires







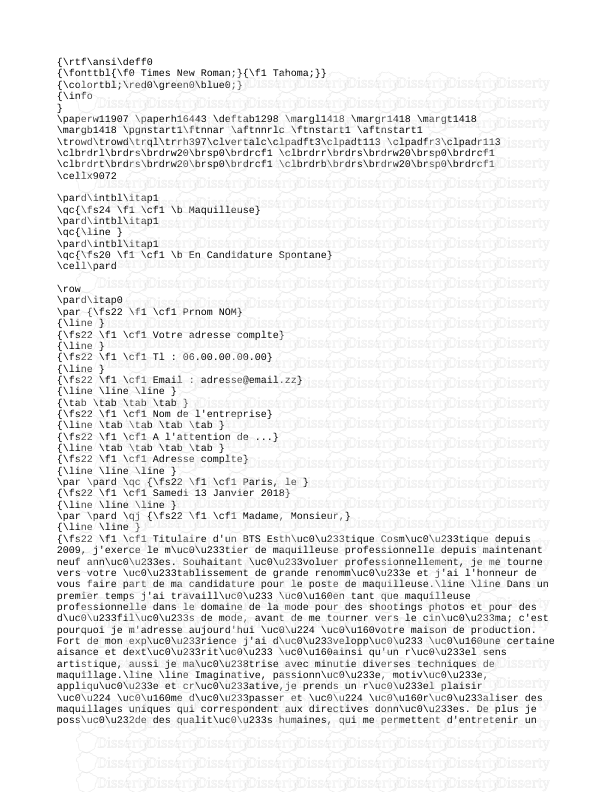


-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 01, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5840MB


