! 1 “D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé l’art.” Inutile de vo
! 1 “D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé l’art.” Inutile de vous mettre en quête de l’origine de cette citation grandiose : j’en suis l’auteur. C’est par ce lieu commun affligeant que j’envisageais de débuter mon écrit avant d’être saisi par le remords et d’effacer cette première phrase. Car il s’agit bien là d’un lieu commun, n’est ce pas ? Tout le monde aime l’art. Qui oserait lever la voix pour clamer son rejet de toute forme d’art, quelle qu’elle soit ? Il peut s’agir de musique, de peinture, de littérature, d’arts plastiques, de cinéma, de théâtre, de danse ou de n’importe laquelle des formes d’expression que nous avons coutume de regrouper sous cette bannière. Mais notre irrésistible attraction pour l’art s’étend bien au delà de ces disciplines canoniques et il peut aussi bien s’agir de toute activité de création, qu’importe sa banalité apparente ou sa simplicité supposée. De cette affirmation découlent naturellement plusieurs questions: Qu’est ce que l’art ? Quel est son but (s’il s’avère qu’il en a bien un) ? Quelle est l’origine de l’élan créateur ? Qu’est ce que créer ? C’est de ces questions - complexes mais non moins fondamentales - que j’aimerais traiter dans cet écrit. Mais comment parler d’art et de création sans parler du créateur ? Pour me lancer dans ce questionnement, il me fallait choisir un artiste afin de disposer d’un exemple concret de processus créatif. Mes affinités avec l’univers musical m’ont fait opter pour le compositeur russe Alexandre Scriabine qui, s’il ne jouit plus aujourd’hui de la renommée d’un Mozart ou d’un Beethoven, fut en son temps un compositeur reconnu. J’ai découvert Scriabine par le biais d’une de ses oeuvres pour piano que j’ai travaillée il y a quelques années et, si l’esthétisme de son travail ne m’avait alors pas frappé, je gardais néanmoins le souvenir de son caractère novateur. Je ne devais découvrir que quelques mois plus tard à quel point mon instinct m’avait guidé vers le sujet idéal. Si vous tapez le nom de Scriabine dans un moteur de recherche quelconque et que vous ouvrez la première page venue, vous y lirez probablement qu’il s’agissait d’un compositeur gravement mégalomane et animé par une inquiétante mystique. Mais vous n’y lirez pas qu’il s’agissait d’une personne incroyablement habitée par la vie. Ni qu’il était profondément humaniste et qu’il aimait sincèrement chaque être humain. Ni qu’il était mû par un élan créateur d’une telle intensité qu’il en rayonnait de bonheur intérieurement. Ces aspects du personnage font partie de son intimité la plus profonde et pourtant, ils sont indubitablement les moteurs de toute son oeuvre artistique. Tous sont gravés dans chacun des caractères de son journal philosophique, journal de pensées qu’il tenait au jour le jour dans ses moments de solitude. Aucun fait marquant de sa vie réelle ne figure dans ce journal, mais il consiste en une verbalisation à la fois poétique et philosophique de ce qu’est l’élan créateur qui l’habite. L ’ ART DE CREER ou la place de la création dans notre vie 3 4 ! 2 “Je n’apporte pas la vérité mais la liberté.” 5 ! 3 Voici un premier extrait du journal philosophique d’Alexandre Scriabine. Ces pages ont été rédigées alors que le compositeur n’avait encore qu’une trentaine d’années et pourtant, elles sont frappantes de par leur profondeur et de par le recul qu’avait Scriabine sur sa propre activité de compositeur. En effet, ainsi que je l’expliquais dans l’introduction, aucune page de ce journal (et certainement pas ce feuillet) ne saurait être méprise pour une page d’un quelconque journal intime relatant les péripéties prosaïques de l’auteur. Au contraire, ce journal est imprégné d’une intensité poétique palpable et si la première lecture de ces quelques pages semble donner crédit à l’hypothèse de la mégalomanie (“Je suis Dieu”), nous verrons bien vite qu’en apportant quelques éclaircissements, cette ode à la création et à la vie prendra tout son sens. Pour pouvoir appréhender la doctrine de Scriabine, je vous propose d’en examiner quelques aspects fondamentaux. Le découpage proposé dans cette partie n’est pas du fait de Scriabine lui même qui ne rédigeait pas là un journal destiné la lecture mais il est le résultat de mon analyse du document. 6 ! 4 7 ! 5 Dès les premières pages de son journal, Scriabin annonce son échec. Car c’est bel et bien par un échec que s’est soldée la quête dans laquelle il affirme s’être lancé dans sa “tendre jeunesse”, quête d’une révélation, d’une vérité absolue qu’il a recherchée aussi bien auprès de hommes que dans les cieux. Comme tant d’autres, Scriabine a d’abord cherché à atteindre l’absolu, “l’éternelle beauté”, à travers le prisme de l’art. Mais à la différence des autres, il admet rapidement son échec et porte alors un tout autre regard sur l’action de créer dont la finalité était jusqu’alors masquée par cet autre (“toi qui m’as tourné en dérision, qui m’as jeté dans un cachot ténébreux…”) qui aspire à ce que nous ignorions l’étendue de notre puissance créatrice. Paradoxalement, la conscience de cet échec, loin d’abattre Scriabine, le réjouit et amplifie son amour pour la vie et pour les hommes auprès desquels il se fait prophète de cette révélation. Il me semble que la vie d’artiste de Scriabine prend un tournant alors qu’il découvre toute l’étendue des possibilités créatrices qui s’offrent à lui, alimentées par son propre désespoir. Si l’aspect créatif inhérent au tragique ne présente pas de grande originalité (les lamentations d’Orphée, ce héros musicien, n’ont elles pas donné naissance au premier opéra ?), on peut aussi lire cet extrait comme un témoignage de l’effort permanent nécessaire à l’artiste pour surmonter son angoisse d’être privé de sa capacité de créer ou de ne plus être capable de qui se distingue de la rigidité des cadres établis, une oeuvre originale qui exprime la liberté de son créateur. N’est ce pas en effet ce que Scriabine s’attelait déjà à faire lorsqu’il composait, durant la même période où il écrivait ces lignes, des oeuvres telles que sa 4ème sonate ou sa 2ème symphonie ? Cette liberté créatrice ne saurait se résumer à quelques mots griffonnés dans son journal pour lui seul. Nous verrons dans la seconde partie que la liberté de composition de Scriabine est visible et même flagrante lorsqu’on examine son langage musical et les formes novatrices qu’adoptent ses oeuvres. 8 ! 6 Ce qui me semble frappant dans cet extrait est son aspect profondément didactique qui peut sembler incongru étant donné que Scriabine enfermait son journal sous clé pour en défendre la lecture à tout autre que lui même. Mais le compositeur semble ici éprouver le besoin de justifier (auprès de lui même ?) cette idée qu’il a développée jusqu’alors selon laquelle il n’existerait pas de vérité mais que la simple conception d’un tel absolu s’oppose fondamentalement à toute forme de liberté créatrice (“la vérité exclut la liberté, et la liberté exclut la vérité”). Pour autant, Scriabine sait combien cette révélation est douloureuse, car si sa connaissance de sa toute puissante liberté créatrice le remplit d’une joie immense, il est lui même d’abord passé par la souffrance d’avoir été torturé par la recherche de cette absolue vérité. C’est pour cela qu’il cherche à nous consoler en ouvrant nos yeux à de nouvelles perspectives soumises à notre seule volonté qui, si elles restent assez mystérieuses pour l’instant, prendront tout leur sens après les explications portant sur un second point de l’idéologie Scriabinienne. Dès lors, Scriabine n’a de cesse de manifester l’intensité du désir créateur qui l’anime et qui doit lutter contre les “spectres terribles de la vérité pétrifiée” qui correspondent à cet état d’immobilité de l’esprit de l’homme qui cherche dans l’absolu dans la création artistique au lieu de la comprendre comme le moyen d’expression ultime de notre liberté mise au service de l’humanité. Et, en effet, Scriabine ne demande pas mieux que de faire le don de toute son énergie créatrice au monde entier, de “charmer par (sa) création, par (sa) merveilleuse beauté” ou encore “d’éclairer l’univers de (sa) lumière”. 9 ! 7 “Le monde est le résultat de mon activité, de ma création, de ma volonté libre.” Dans ces quelques lignes, Scriabine commence à développer ses réflexions sur le processus de création qu’il aborde ici d’un point de vue théorique. En effet, le compositeur me semble troquer l’habit de poète, qu’on l’avait vu revêtir jusqu’alors lorsqu’il prêchait avec exaltation la liberté créatrice qui est la nôtre, contre l’habit de philosophe, désireux de réfléchir à l’action même de créer. Scriabine part du fil de sa conscience au sein de laquelle il distingue toute une suite d’évènements et aboutit finalement à cette conclusion : “le monde est le résultat de mon activité, de ma création, de ma volonté libre”. On retrouve ici le motif surprenant qui se dessinait depuis les premières pages de son journal et par lequel Scriabine prétend “créer le monde” et ira même jusqu’à écrire “Je suis Dieu” à plusieurs reprises. Mais c’est à travers le prisme de l’expérience individuelle de la conscience uploads/s3/ alexandre-scriabine-etude-du-processus-creatif-par-pierre-ucla.pdf
Documents similaires





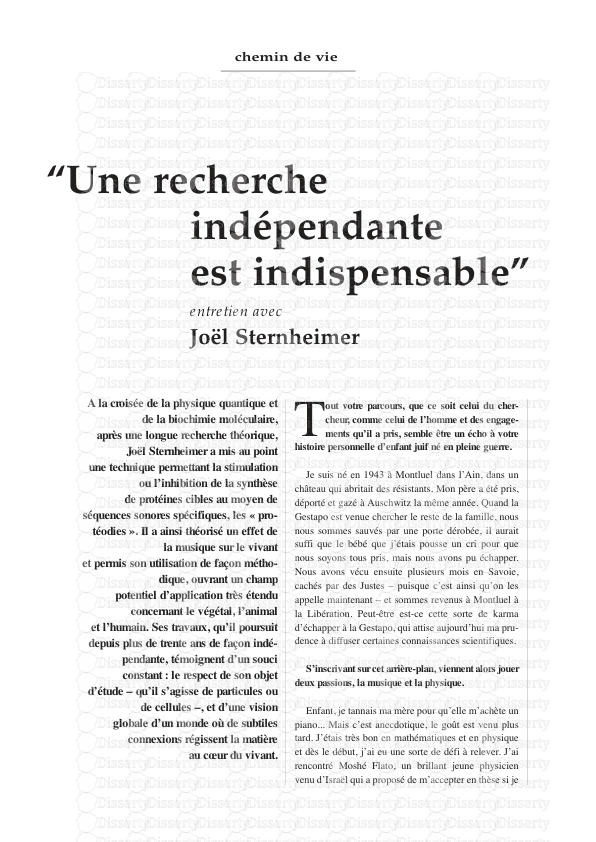




-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 3.1612MB


