• fW- /£-3ï Anthologie d'Art français LA PEINTURE = XX e SIÈCLE DU MÊME AUTEUR
• fW- /£-3ï Anthologie d'Art français LA PEINTURE = XX e SIÈCLE DU MÊME AUTEUR Anthologie d'Art français : La Peinture (XIX e siècle) . 2 vol. Chaque vol., broché. 2 fr. 50 Relié toile 3 fr. 50 Édition de luxe sur papier mat, broché . . 5 fr. » Librairie Larousse. IL A ETE TIRE DE CET OUVRAGE 200 EXEMPLAIRES DE LUXE SUR PAPIER MAT ERRATUM. — Interversion de gravures entre les pages 66 et 68 : La Grande Côte, de M. Maufra, est reproduite page 68 ; l'œuvre de M. René Ménard, Les Bergers, est donnée page 66. MA > U 1974 û£- Anthologie d'Art français LA PEINTURE = XX e SIÈCLE Par Charles SAlimÉTi 128 GRAVURES 0. M. I. i Bibliothèque Larousse ^ Paris. — j 3-i 7, rue Montparnasse BIBLiOTHECA tîav!ens\* ^D "5^% mJ D /f/i £46, Dans cette Anthologie sont presque exclusivement repré- sentés ou mentionnés les artistes qui ont produit, à partir de 1889, des œuvres significatives. Les artistes dont la répu- tation est antérieure à cette date figurent dans VANTHO- LOGIE DU XIX e SIÈCLE précédemment publiée. STEINLEN CROQUIS V L% Peinture française ©btuj XX e siècle * as M ANTAGONISME DES ECOLES D'ART A LA FIN DU XIX* SIÈCLE Les opérations du jury constitué à l'occasion de l'Exposi- tion universelle de 1889 avaient mis en contact des artistes d'origines diverses et de tendances opposées. Deux partis se formèrent. Le premier comprit l'Institut et les professeurs de l'École des Beaux-Arts; le second, les Modernistes, divisés en pleinairistes, réalistes, impressionnistes. Les discussions ne s'éteignirent pas après la fermeture de l'Exposition univer- selle, au contraire. Il en résulta, en 1890, un événement d'im- portance qui passionna le monde des arts : la scission en deux groupes non pas d'une élite, mais de la totalité des artistes français. Ceux-ci avaient jusqu'alors coutume de présenter leur effort annuel dans un unique Salon. Les académiques et les techniciens timides qui demandaient la consécration aux récompenses officielles continuèrent à exposer au Salon des Artistes français. Les modernistes, groupés en Société Na- tionale des Beaux-Arts, fondèrent un second Salon. Le premier, dirigé par Gérome, G. Boulanger, J. Lefebvre, Bonnat, T. Robert-Fleury, Français, Harpignies, pour la pein- ture; Cavèlier, Falguière, Ernest Barrias, pour la sculpture, LA PEINTURE FRANÇAISE AU XX* SIÈCLE vi devait consacrer les talents de MM. Adler, Avy, Paul Chabas, Etcheverry, Ch. Hoffbauer, E. Laurent, H. Royer, Louis Cabanes, Zo, de Mlles Dufau et Delasalle; le second, qui se re- commandait de la présence de Meissonier, Puvis de Chavannes, Carolus Duran, Roll, Albert Besnard, Duez, Dagnan-Bouveret, Friant, pour la peinture; Dalou et Rodin, pour la sculpture; Bracquemond et A. Lepère, pour la gravure, devait mettre en lumière les productions de MM. Aman-Jean, Auburtin, Cottet, F. Guiguet, La Gandara, Lobre, E.-René Ménard, Lucien Simon, Raoul Ulmann, Le Sidaner, Wery, Morisset, Muenier, V. Koos, etc. Il y eut, certes, de l'arbitraire dans ces groupements, car les questions de personnes tenaient une large place. — Fantin- Latour, dédaigneux des coteries, demeura à la Société des Artistes français, alors que la plupart de ses anciens compa- gnons de lutte se ralliaient à la Société dissidente. Mais, cela noté, les deux Salons furent, tout ou moins les premières années, représentatifs d'idéals différents. D'autre part, les meilleurs parmi les artistes sentaient que l'art français avait besoin de se renouveler, c'est-à-dire qu'il ne pouvait vivre et prospérer que par la liberté. L'exposition Centennale organisée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889 corroborait cette opinion. Toutes les écoles, tous les genres avaient contribué au succès de la manifestation. Et voilà que, du fait de la présence de David, d'Ingres, de De- lacroix, de Corot, de Th. Rousseau, de Millet, de Courbet, de Manet, cet art français, que les groupements officiels avaient la prétention de représenter seuls, apparaissait d'autant plus significatif et vigoureux que les recherches étaient plus indé- pendantes. Les œuvres de tel méconnu prenaient, toutes pas- sions abolies par le temps, une signification qui était pour les artistes sincères, les jeunes enthousiasmes, un avertissement et un encouragement aux recherches neuves. Alors un ardent désir de liberté et un besoin de nouveauté envahirent les esprits. Ils entendirent être eux-mêmes, rien qu'eux-mêmes. Si l'on demanda des conseils, ce fut à quelques troublants maîtres anciens, tel le Greco, et aux réfractaires, aux tempéraments inquiets : Paul Cézanne, Gauguin, le Hollandais Van Gogh, dont les œuvres, malhabiles parfois mais sincères, avaient de l'énergie ou de l'imprévu. Bref, l'armée des novateurs grossit, s'imposa à l'attention des aînés, ébranla les convictions les mieux arrêtées. On la vit même manifester son influence là où toute libre audace sem- vu IMPUISSANCE DE L'ACADÉMISME blait condamnée : au concours de Rome. Ce mouvement inté- ressant, fécond par certains côtés, avait ses dangers. Il entraîna l'abandon des lois essentielles de l'art, des traditions qui avaient jusqu'alors assuré la vitalité de l'école française. Éclipse passagère, sûrement. Quoi qu'il en soit, des œuvres fortes sont nées de cette fièvre. Mais il en est sorti aussi un plus grand nombre de préten- tieuses et d'insignifiantes. Et les modes aidant, les amateurs n'ont pas toujours discerné le bon du mauvais, le sincère de l'adultéré, le curieux du détestable. IMPUISSANCE DE L'ACADÉMISME Autrefois, les groupes officiels, détenteurs d'une tradition et fortement constitués, donc bien armés contre toute révolte, eussent tôt fait de maîtriser des indépendances qu'une incom- plète initiation technique permettait de disqualifier. Ils eussent dirigé vers un idéal plus élevé, au moyen d'une discipline sage- ment entendue, les quelques tempéraments bien doués enivrés de liberté qui s'égaraient dans des recherches ou stériles ou dangereuse! Mais si affaibli était l'art officiel, si médiocres paraissaient ses réalisations, que, pour la première fois ce furent ses représentants qui, en dépit de leurs diplômes et de leurs médailles, durent céder à la poussée des jeunes audaces, se désagréger. Il est vrai que le mouvement des idées y aidait fortement. L'académisme et ses traditions répondaient naguère à un besoin. Lui seul semblait capable d'ordonner les compo- sitions qui ornaient les autels des églises et de rappeler, dans les palais, certaines allégories dont la présentation ne variait guère Or, l'accumulation des productions du passe suffisait maintenant aux temples dont le nombre demeurait station- nais Et, pour orner les établissements publics : écoles, mai- ries les nouvelles couches politiques, subissant l'influence du réalisme, préféraient aux épisodes fabuleux, dont la signi- fication était d'année en année moins claire à leur esprit, des scènes de la vie de chaque jour. L'Institut et ses élèves eurent contre fortune médiocre conte- nance et, ne pouvant plus évoquer Apollon, Moïse, Charle- magne, Louis XIV ou Napoléon, restreignirent leur activité à la représentation des rares cérémonies officielles, non plus avec la certitude technique de jadis, mais avec d'inintelligentes con- cessions au goût moderne. Et comme monnaie courante les LA PEINTURE FRANÇAISE AU XX* SIÈCLE vm mêmes praticiens se rabattirent sur les portraits. Là encore, au lieu de s'efforcer de rester dans la forte tradition de David et d'Ingres, ces mauvais bergers se plièrent aux exigences de la clientèle, en allant demander leur inspiration aux por- traitistes français et anglais du xvm e siècle, devenus à la mode. Mais combien ils restèrent loin de leurs modèles 1 INFLUENCE MOMENTANEE D'ÉLIE DELAUNAY ET DE GUSTAVE MOREAU Si l'Académie avait su mieux recruter ses dirigeants, si les coteries qui se recommandaient d'elle eussent tu leurs jalou- sies, le classicisme aurait pu regagner l'influence perdue et exercer sur les jeunes élèves une action efficace. Deux grands artistes étaient aptes à élever, dans une atmosphère de beauté n'excluant pas un certain libéralisme, des disciples qui au- raient, à leur tour, créé des œuvres fortes. Mais, entrés tard à l'Institut et appelés plus tard encore à la direction d'un atelier à l'École des Beaux-Arts, la mort ne leur permit pas d'achever l'œuvre de rénovation qu'ils avaient entreprise. Le premier, Èlie Delaunay (1828-1891), professa à l'École des Beaux-Arts de 1889 à 1891. Les élèves qu'auparavant il avait librement formés, ainsi Ary Renan et Georges Desvallières, té- moignaient de la perfection de sa science et de l'intelligence de son enseignement. Ceux qu'il initia durant son séjour à l'École des Beaux-Arts reçurent également une empreinte profonde. L'idéal n'était plus limité aux trucs d'atelier, à l'admiration béate des grands Italiens du xvi e siècle, dont la perfection de- meure inégalable. C'était vers la Grèce, les Bellini, Mantegna, qu'étaient dirigés les yeux des élèves ; c'est vers un dessin sin- cère, une composition simple mais émouvante que leur effort devait tendre. Après deux ans d'enseignement, Élie Delaunay mourait. Par bonheur, le successeur qui lui fut donné était prêt à continuer son œuvre, à la parfaire d'autres curiosités. Avec Gustave Moreau (1826-1898), l'initiation ne s'arrêta plus aux seules sources occidentales, mais s'étendit à l'Inde et à la Perse, qui fournissaient des fonds plus riches, des motifs dont la capricieuse beauté était susceptible de rendre plus pures encore les formes qui se détachaient sur eux. Les musées, bien délaissés depuis la mort des derniers élèves d'Ingres, retrou- vaient des copistes intelligents qui s'efforçaient, non pas au uploads/s3/ anthologie-d-x27-art-francais-saunier-charles-1865-pdf.pdf
Documents similaires









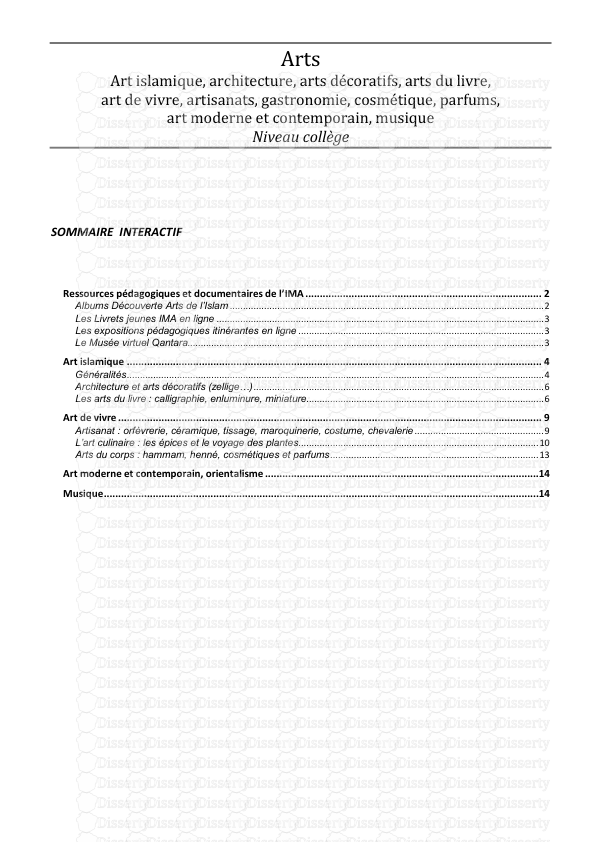
-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 09, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 23.2097MB


