MARIA NEYRA LÁZARO COMMENTAIRE DU TEXTE 2, LE VENTRE DE PARIS Le XIXème siècle
MARIA NEYRA LÁZARO COMMENTAIRE DU TEXTE 2, LE VENTRE DE PARIS Le XIXème siècle est un siècle de changement. La révolution de 1848 et la Commune de Paris de 1871 influencent si profondément tous les aspects de la vie en France. Le réalisme de Balzac se développe tout au long de la première moitié de ce siècle, aboutissant dans une nouvelle esthétique sous la plume de Zola (1840-1902), qui reprendre l’exemple de La Comédie Humaine de Balzac, en rédigeant son propre œuvre totale, voir Les Rougon-Macquart (1871-1893). Avec le naturalisme Zola veut aller plus loin que Balzac en s'attachant au monde des ouvriers. Fasciné par le succès de la méthode expérimentale dans le domaine scientifique, il veut appliquer cette méthode au roman et ainsi donner une nouvelle dimension au réalisme, grâce à une démarche censée fonder une analyse objective de phénomènes tels que l’hérédité et l’alcoolisme. L’extrait fait partie du troisième volume de Les Rougon-Macquart,ouvrage qui a pour but d'étudier l'influence du milieu sur l'homme et les tares héréditaires d'une famille, originaire de Plassans, sur cinq générations depuis l'ancêtre Adélaïde Fouque (née en 1768) jusqu'à un enfant à naître, fruit de la liaison incestueuse entre Pascal Rougon et sa nièce Clotilde (1874). Comment le malaise de Florent transparaît-il dans cet extrait ? Tout d'abord, il faut analyser la description des Halles et après, nous nous consacrerons à l'étude du point de vue de Florent. L’histoire se développe à Paris, lieu réel, et plus concrètement dans les Halles, élément que Zola introduit comme peinture de la réalité de l’époque. La richesse de la méthode zolienne est présente même dans le titre du livre, dans lequel il fait personnification de la ville de Paris, (personnification qu'on peut voir aussi dans le texte, à la ligne 41-43) en l’accordant un ventre, voir les Halle. L’association du ventre et de Paris s’explique à partir de la nourriture : Zola accorde un rôle important à ces Halles, qui contiennent la nourriture pour tout Paris. Zola a écrit : « l’idée général est le ventre, le ventre de Paris, et par extension le ventre de l’humanité. La bourgeoisie digérant, ruminant, couvent (…) ses joies. La bourgeoisie appuyant solidement l’Empire, parce que l’Empire lui assure son pâté, sa nourriture. Mais Rougon et Macquart sont des appétits. ». Le soucis de Zola est de faire un portrait sociologique centré sur la classe de la bourgeoisie. Le peuple du XIX siècle ne venait pas dans les Halles acheter de la nourriture. C’était la bourgeoisie qui avait l’argent nécessaire pour bien manger, et c’était 1 MARIA NEYRA LÁZARO les marchands qui étaient eux aussi des bourgeois, petits, mais bourgeois. Si les Halles c’est la personnification du ventre, alors de la nourriture, les Halles sont associées à la classe des bourgeois. Zola nous montre cette personnification et la description des Halles à travers de différents biais: à partir du mouvements des marchands, par le mouvement même de Florent, par les noms des rues etc. Le portrait que Zola fait des Halles se dessine au fur et à mesure que les verbes de mouvement concernant les marchands et les marchandises (“les marchands forains venaient” - ligne 12 -, “des grandes tapissières emportaient” - ligne 24 -, “des chars à bancs (...) partaient” - lignes 25 et 26 - “qui vont de porte en porte” lignes 47 et 48) et à Florent lui-même (“il alla” - ligne 6 -, “il rentra” - ligne 11 -, “il s’arrêta” - ligne 18 -, “il vint” - ligne 27 -, “il le suivit” - ligne 31 -, “il butait” - ligne 34) apparaissent dans le texte: ces verbes de mouvements se sont mélangés avec des énumérations des noms de rue (“la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo” - lignes 3 et 4 -, “la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles” - lignes 16, 17 et 18) et avec le champ lexical de l’abondance (“le déluge de choux, des carottes, de navets recommençait” - lignes 14 et 15). Tous ces différents procédés conforment une image des Halles vivante, plein de mouvement. Cette image des Halles provoquent en Florent quelques sentiments qui sont liées à la captivité: les verbes du mouvement qui se sont rapportés à Florent que nous avons déjà commenté se sont mélangés avec des expressions rapportés à la captivité (“libre” - ligne 3, “encombrées”- ligne 5, “infranchissables”- ligne 8, “il se heurta contre un tel embarras”- lignes 9 et 11, “sortir de ce flot”- lignes 15 et 17, “barricadaient”- ligne 36, “obstacle” - ligne 36, “repris par les Halles” - lignes 37 et 38), et avec de sentiments (“l'inquiétèrent” - ligne 4, “découragé, effaré”- ligne 17, “espérant”- ligne 31) pour nous donner une image du parcour de Florent travers les Halles. En mélangeant tous ces recours stylistiques et littéraires, Zola nous transmet l'angoisse et le sentiment de panique qui exprime le protagoniste à l'intérieur du marché. Ici, Zola revient une autre fois à l'idée d'un Paris personnifié, avec les Halles comme ventre, pour nourrir le sentiment de captivité de Florent, qui voit les Halles comme un grand monstre. En lui accordant l'image de “un grand organe central battant furieusement, jetant le sang de la vie dans toutes les veines” Zola fait allusion à comment une poison s'étend par le corps travers les veines, et c'est exactement le sentiment de Florent. Pour conclure, nous pouvons constater comme la disposition des recours littéraires et stylistiques que Zola emploi dans le fragment servent à dresser la malaise de Florent, en nous donnant une image des Halles très particulière. 2 MARIA NEYRA LÁZARO COMMENTAIRE DU TEXTE À REBOURS En France, le XIXème siècle est marqué par le bouleversement social, politique et économique. La défaite de Sedan dans la guerre franco-prussienne et la capitulation de Napoléon III, provoquèrent, le 4 septembre 1870, la chute du Second Empire, l'exil de Napoléon III et marqua la naissance en France d'un régime républicain pérenne avec la Troisième République. Tout cela uni à la Commune de Paris de 1871 marque si profondément l’écriture et l’art de nombreux artistes qui trouvent dans le mouvement décadent, l’expression de la dégénération de l’état de la société. C’est dans ce contexte où se situe cet extrait de À Rebours (1884), le roman de J.K Huysmans (1848-1907) considéré aujourd’hui comme la Bible du mouvement décadent. Disciple de Émile Zola, il prend conscience que l’esthétique naturaliste n’est plus suffisante, et c’est alors qu’il abandonne cette pensée pour se créer lui-même une nouvelle esthétique qui sera dite Décadence, c’est pourquoi À Rebours sera la bible du mouvement. Le titre À Rebours est un titre symbolique, mais dans ce cas, la signification réelle du titre vient du passage d’A Vau-l’eau à À Rebours: il marque le passage de naturalisme au mouvement décadent. En quoi Huysmans prouve un changement de mouvement vers le décadentisme ? Dans un premier lieu, nous étudierons comment Huysmans introduit les caractéristiques décadents dans son œuvre et après nous constaterons comment les différents discours qui se sont mélangés dans le texte dressent ces caractéristiques. Cet extrait se situe dans le chapitre 5, au début de l’histoire. Le roman raconte comme Des Esseintes, un duc qu’habite à Paris avec une vie plutôt dissipée, de femmes, d’alcool et de drogues, devient malade. Le médecin lui conseil de changer son style de vie (il a le mal de cette société, assez de vie parisienne) et il quitte Paris et il part aux alentours de Paris dans une maison qu’il a à Fontenay aux Roses. Il s’y enferme avec un seul domestique et il se met à préparer l’espace de sa maison d’après ses goûts: C’est l’action du roman. Il ne s’agit pas d’un roman d’action/d’intrigue au sens canonique du terme. Ici se trouve la première différence essentielle qui prouve qu’il a renoncé au naturalisme : dans les romans de Zola personnages sont des marchands, des ouvriers, alors que le décadent est un être très raffiné. Il y a un rapport très étroit entre le décadentisme et le dandysme (dandy: homme qui veut maintenir son apparence physique, qui est très raffiné, c’est-à-dire riche, quelque chose qui est 3 MARIA NEYRA LÁZARO capable d’éveiller tous les sens, ex.: Oscar Wild, qui portait toujours une fleur (clavel-“œillet”) de couleur verte qui n’existe pas, alors il devait colorier sa fleur, c’est un signe d’individualité). Dans les goûts de Des Esseintes on trouve la nouvelle esthétique: Ses goûts sont très raffinés, il est duc, et c’est le contraire du naturalisme, qui est la pauvreté, la misère. Il n’y a pas d’action au sens canonique : il y a réflexion au lieu d’action. Huysmans ne présente qu’un personnage. Dans ce sens, le roman se trouve à la limite de deux genres : le roman et l’essai. Critique d’art, on trouve la présence d’une autre manifestation artistique : le tableau de G. Moreau. On peut parler d'ekphrasis (terme ancien) ou d’inscription de la peinture dans la littérature ; terminologie d’aujourd’hui, préférable, parce que uploads/s3/ emile-zola.pdf
Documents similaires

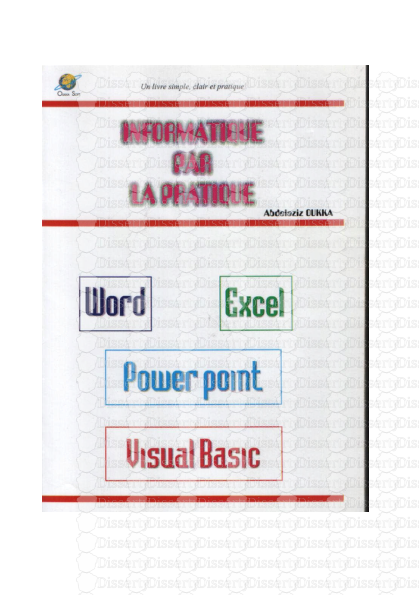







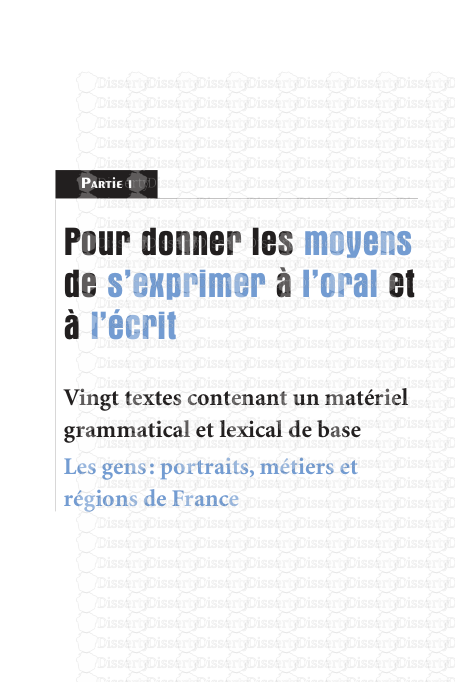
-
125
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 28, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1205MB


