LE DESSIN D’ENFANT, ENJEU TRANSFÉRENTIEL Paul Alerini Érès | « Essaim » 2015/1
LE DESSIN D’ENFANT, ENJEU TRANSFÉRENTIEL Paul Alerini Érès | « Essaim » 2015/1 n° 34 | pages 7 à 22 ISSN 1287-258X ISBN 9782749247304 DOI 10.3917/ess.034.0007 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-essaim-2015-1-page-7.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Érès. © Érès. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) Le dessin d’enfant, enjeu transférentiel Paul Alerini « L’intérêt pour les dessins d’enfants survivra-t-il à la mode ? » Daniel Widlöcher Les dessins d’enfants ne sont plus vraiment à la mode, pourtant, les enfants aiment toujours autant dessiner, y compris dans les bureaux de psychanalystes. Mais la tendance actuelle est de privilégier le jeu et d’offrir aux enfants un certain nombre de jouets ainsi que du papier et des feutres ; aussi, le dessin se présente comme un jeu parmi d’autres. C’est pourquoi les jeunes psychanalystes sont souvent surpris quand un contrôleur leur demande d’apporter les dessins ; ils réalisent alors que ces dessins sont les traces de ce qu’il s’est passé au cours des séances et qu’ils présentifient l’enfant dans un lieu et un temps tiers. De plus, les dessins sont des messages, rédigés par l’enfant dans une écriture qui lui est particulière. Ils sont adressés à l’adulte psychanalyste mais surtout à l’enfant lui-même. La psychanalyse permet de les déchiffrer et de faire retour vers l’enfant pour qu’il comprenne le sens de ce qu’il a exprimé et la situation de contrôle a pour effet de souligner la fonction de ce retour. Un système de signes employé par l’enfant qui dessine En 1913, G.-H. Luquet, professeur de philosophie, publie une monographie sur les dessins de sa fille Simonne, puis il poursuit sa recherche sur les dessins d’enfants français, belges, californiens. Il décrit quatre époques des dessins dont deux s’opposent, le réalisme intellectuel (spécifique de l’enfant) et le réalisme visuel (dernière étape chez l’enfant, qui deviendra caractéristique du dessin de l’adulte). Entre ces deux manières de dessiner il y a « la même relation que pour les langues verbales entre © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) 8 • Essaim n° 34 divers idiomes 1 ». Le réalisme intellectuel (ou logique) fait « figurer en même temps que les détails de l’objet représenté leurs relations réciproques dans l’ensemble constitué par leur réunion 2 ». Cela veut dire que tous les détails sont figurés, ceux qui sont visibles, ceux qui ne le sont pas et les qualités abstraites qui s’y rattachent. Syntaxe enfantine où Luquet repère une logique s’inspirant de la théorie des ensembles. Cette syntaxe conjoint des éléments qui constituent un vocabulaire. Daniel Widlöcher dit : « Le réalisme intellectuel ne peut être interprété que comme un système d’écriture déterminé par les aptitudes motrices et le contrôle visuel 3. » Cette écriture qui va disparaître à l’adolescence est faite de signes qui participent de l’image, des icônes, des pictogrammes, elle est baroque, non tempérée, elle se déploie dans tout l’espace de la feuille ou tout autre support. Elle est mobile, dynamique, elle évolue tout le temps. Elle est liée à la parole, car même lorsqu’il est tout seul l’enfant nomme ce qu’il dessine. Luquet parle de cette nomination comme d’une interprétation 4. Cette écriture est liée aussi à la gestuelle, car au départ le tracé est conséquence d’un geste. Elle se développe en suivant les étapes de la maîtrise du langage et de la motricité, pour finalement s’éteindre. Elle est complexe, doublement accompagnée d’amusement et de sérieux. C’est le jeu qui est déclencheur du dessin, puis le sérieux prend le dessus et l’enfant s’absorbe dans sa tâche (cf. le portrait de Jean Renoir dessinant, par son père Pierre Auguste en 1903). Quand il soliloque, l’enfant nomme ce qui naît de son crayon et il se raconte des histoires. Ce que l’on appelle réalisme est en fait de l’imagination, le dessin exprime ce que l’enfant croit qu’il existe, il vise moins à représenter qu’à signifier. Dans ce sens il permet l’expression de la vie intérieure. Piaget a mis l’accent sur cette expression autocentrée et il a contesté la notion de réalisme enfantin en objectant qu’il découle d’une perception égocentrique, par l’incapacité cognitive de l’enfant de comprendre les relations réciproques. Il a nommé la période qui va de 2 à 7 ans l’égocentrisme intellectuel 5, où s’exprime l’activité représentative égocentrique 6. Lacan a tourné en dérision la notion d’égocentrisme de Piaget : « Le discours égocentrique est une erreur de Piaget […] les enfants ne s’adressent pas à tel ou tel, ils parlent, si vous me permettez le mot, à la cantonade. Ce discours égocentrique c’est à bon entendeur salut. Nous 1. G.-H. Luquet, Les dessins d’un enfant, étude psychologique, Paris, Alcan, 1913, p. 248. 2. G.-H. Luquet, Le dessin enfantin (1927), Lausanne, Paris, Delachaux et Niestlé, 1991, p. 128. 3. Daniel Widlöcher, L’interprétation des dessins d’enfants, Bruxelles, Mardaga, 1998, p. 68. 4. G.-H. Luquet, Le dessin enfantin, op. cit., p. 30-44. 5. P. Wallon, A. Cambier et D. Engelhart, Le dessin de l’enfant, Paris, Puf, 2001, p. 36. 6. J. Piaget, La formation du symbole chez l’enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1968, p. 301. © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) © Érès | Téléchargé le 16/02/2022 sur www.cairn.info (IP: 197.238.251.168) Le dessin d’enfant, enjeu transférentiel • 9 retrouvons ici la constitution du sujet au champ de l’Autre 7. » Erik Porge a précisé ce que signifie « parler à la cantonade », terme de la comédie italienne, quand une tirade est adressée à quelqu’un qui n’est pas sur la scène, en coulisse par exemple 8. Erik Porge précise ainsi le rapport à l’Autre du discours de l’enfant : « Dans certains moments le message de l’enfant directement adressé à une personne implique que ce lieu tiers soit posé et soit une instance agissante afin que le message arrive à destination car ce lieu est celui de la destination véritable du message 9. » Les moments particuliers dont il est question appartiennent à la séance de psychanalyse et il s’agit là du transfert. De plus, le lieu tiers peut être matérialisé par le contrôle ou encore personnifié par un personnage, tel Freud pour Hans (Erik Porge y fait référence). Ce qui est dit à propos de la parole s’applique sans problème au dessin, qui est l’écriture particulière d’un message qui est une certaine forme de parole. En séance, ce message est adressé à l’enfant en même temps qu’au psychanalyste, dans la mesure où le dispositif psychanalytique implique ce lieu tiers, qui permet le retour à l’enfant de son propre message. On comprend que ce retour est ce qui fait interprétation, et qu’une analyse pourrait se dérouler sans interprétations du psychanalyste, c’est même ce que dit Winnicott à propos de ses consultations thérapeutiques : « Le moment clef est celui où l’enfant se surprend lui-même et non celui où je fais de brillantes interprétations 10. » Françoise Dolto, pourtant célèbre pour ses interprétations fulgurantes, disait en contrôle qu’il n’était pas forcément utile d’intervenir quand on avait compris, parce que l’enfant l’avait exprimé et donc qu’il l’avait déjà compris. L’analyse des enfants qui dessinent peut se suffire d’un accompagnement du travail de l’inconscient enfantin. Le dessin d’enfant comme formation de l’inconscient Françoise Dolto déclara à J.-D. Nasio : « Un dessin c’est plus que l’équivalent d’un rêve, c’est en lui-même un rêve, ou si vous préférez un fantasme devenu vivant 11. » Mais elle parle des dessins faits en analyse, qui sont spécifiques, et ne sont pas les mêmes que ceux exécutés à l’école pour la maîtresse ou à la maison pour faire plaisir, pour faire cadeau aux 7. J. Lacan, Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (27 mai 1964), Paris, Le Seuil, coll. « Points » (collection de poche), 1973, p. 232. 8. Il est facile de faire l’expérience de « la cantonade » de la parole enfantine, simplement en écoutant des enfants qui parlent à des adultes dans une autre pièce ; ils ont un ton de déclamation ou de récitation qui donne l’impression qu’ils savent que nous les écoutons. 9. E. Porge, « Le transfert à la cantonade », Littoral, n° 18, Toulouse, érès, 1986, p. 10. 10. D. W. Winnicott, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1971, p. 72. 11. F. Dolto, L’enfant du miroir, Paris, Rivages, uploads/s3/ ess-034-0007.pdf
Documents similaires





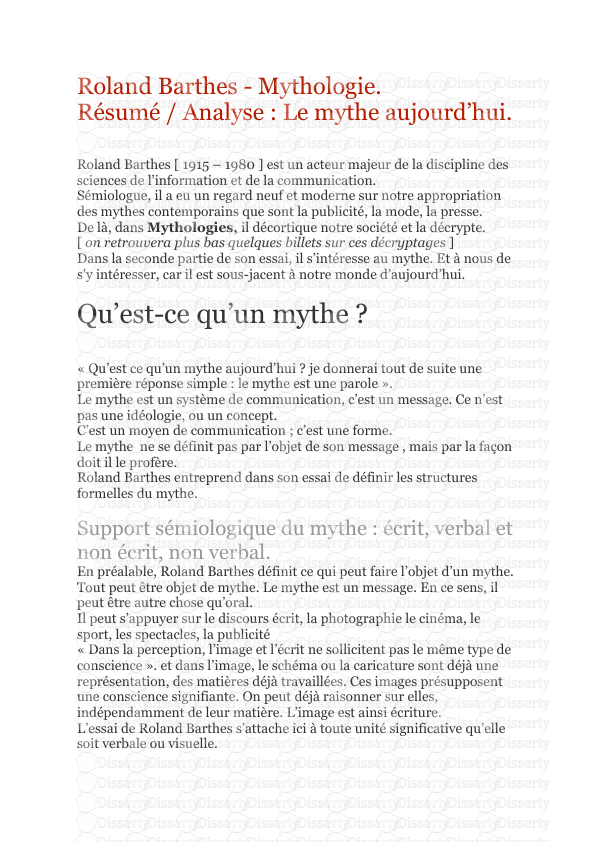




-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 08, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9874MB


