13/10/2021 18:40 L'épreuve de la mort au cinéma (I) – Hors Champ https://horsch
13/10/2021 18:40 L'épreuve de la mort au cinéma (I) – Hors Champ https://horschamp.qc.ca/article/lpreuve-de-la-mort-au-cinma-i 1/15 “La mort au travail” L’épreuve de la mort au cinéma (I) par André Habib 2002 “Puisqu’il avait voulu imiter le mouvement de la vie, il était normal, il était logique, que l’industrie du film se soit d’abord vendue à l’industrie de la mort”. (Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, épisode 2b) Comment rendre la mort ? Rendre, c’est, non pas simplement représenter, mais c’est, dans la plus haute fidélité, en faire don, la rendre sensible, la faire affleurer à la surface. Que serait une médiation digne de la mort ? Peut-on la rendre présente ? N’est-elle pas toujours- déjà-présente, ou n’est-elle pas, plutôt, malgré sa mass-médiatisation, cet irrémédiable non médiatisable ? Toutes les images d’Epinal qui défilent sur nos écrans ne font, au fond, que commodifier la mort en rendant son spectacle ordinaire. Elles ne nous montrent que la mort commune, qui ne nous concerne pas (alors que rien d’autre devrait nous concerner). De nos jours, nous vivons entourés de morts abstraites (jouées ou non, documentaires ou fictionnelles), saturées d’un sens qui en elles s’abolit. Est-ce une manière de la contenir ? Que des hommes, de tous temps, ont tenté de domestiquer la mort en la contenant, en la niant, rien de nouveau sous le soleil. Mais dans l’ordre de la représentation du trépas, le cinéma a introduit une nouvelle donne, dans ces trois siècles qu’il enjambe depuis peu, et qui mérite notre interrogation. Capturant le passage du temps, le cinéma (et tous les mediums qui procèdent de lui), peuvent filmer le passage de la vie à la mort, filmer ce moment où la vie disparaît d’un corps. Comme le soulignait Bazin, “la mort est un des rares événements qui justifie le terme de spécificité cinématographique” . Mais cette spécificité s’exerce, dans les faits, très rarement, pour de vrai. Elle est, dans le cinéma de fiction, ce qui est leffi 1 13/10/2021 18:40 L'épreuve de la mort au cinéma (I) – Hors Champ https://horschamp.qc.ca/article/lpreuve-de-la-mort-au-cinma-i 2/15 plus difficile à rendre, voire même, ce qu’elle ne peut pas rendre. Elle marque la limite de sa puissance d’illusion (un acteur qui meurt ne meurt jamais vraiment). Or, les films peuvent documenter la mort, mais même dans ces cas (et nous y reviendrons), la mort n’est jamais visible, comme telle. Peut-être est-ce qu’elle n’a pas de lieu, de siège précis. Ces signes ont beau être lisibles, extérieurs, la mort n’est pas réductible à ces signes (plaies, chute, souffle coupée). Dans le règne des images télévisuelles, les images de la mort (comme au temps des exécutions filmées), sont ce qu’il y a de plus couru. De grands débats se jouent autour de la diffusion des mises à mort. Est-ce dans l’espoir de voir, pour de vrai, l’expérience de la mort ? Cette curiosité morbide est, dans nos sociétés, toujours suspecte, perverse, bien que terriblement répandue. La médiatisation de la mort est une forme assez sournoise de son instrumentalisation spectaculaire, et c’est pour éviter les commotions qu’elle engendre qu’on a assisté, en France, au tout début du siècle, aux premiers cas de censure. Souffririons-nous tous de ce “Complexe de Néron” dont parle Bazin ? Comment expliquer autrement, le succès des mises en scène de catastrophes réelles, d’accidents de voitures, de chutes en parachute qui échouent, voire la puissance d‘évocation (aussitôt censurée), de ces images des suicidés du World Trade (ces virgules dans le ciel enfumé, dont parle Charles Tesson). Est-ce, secrètement, dans l’espoir d’y voir quelque chose, qui ne peut qu’excéder toute visibilité ? Notre curiosité est alors tributaire de ce qui, dans son spectacle, échappe invariablement à sa représentation. Tenter de voir et de re-voir ce qu’on ne pourra jamais voir. S’il existe une “obscénité ontologique” dans tout spectacle médiatisé de la mort (reproductible à l’infini), il est possible de se demander si, dès lors qu’on a reconnu l’aporie de sa représentation, il n’y aurait pas une façon de révéler une expérience féconde de la mort, pour la vie : en faire le lieu sans lieu d’une médiation. Si la mort se situe justement à la frontière de la représentation, en relève la limite, n’est-ce pas sur cette limite, qui s’abolit aussitôt qu’elle apparaît, que s’exerce toute expérience audio-visuelle, comme inscription objective du temps humain, c’est-à-dire de la finitude. C’est dans le prolongement de ces questions que nous tenterons de distribuer, au filfl 13/10/2021 18:40 L'épreuve de la mort au cinéma (I) – Hors Champ https://horschamp.qc.ca/article/lpreuve-de-la-mort-au-cinma-i 3/15 des réflexions, quelques jalons, partiels et partiaux, qui essaieront moins d’y répondre (la tâche s’avère trop lourde), que de maintenir ce qui, dans leur interrogation, pose question. Mais d’abord, rappelons quelques généralités. – Disons d’abord ceci : la mort est ce qu’il y a de plus commun dans le règne des vivants, et à la fois ce qu’il y a de plus exceptionnel dans une vie. Il y a, bien entendu, autant de morts que de rapports à la mort, et ce, à travers les époques, et notre humanité n’a peut-être aucune autre question à se poser, que d’articuler son rapport au non-être. En elle se confond le temps intérieur de la conscience, le plus intime (“Je meurs”) et la durée objective des choses (“on meurt, comme toute chose qui meurt”). Seule certitude de notre être, à savoir qu’il nous échappera, en un instant fulgurant. La biologie, la clinique, malgré tous ses progrès (et peut-être à la mesure de ses progrès), ne peut rien nous dire de la mort, parce que son dire est déjà détaché de “mon temps”. Le discours scientifique discourt très peu avec “ma vie”. C’est toujours un “autre”, abstrait, qui meurt dans ce discours, pendant que dans les yeux, la vie de l’ami, du parent, la nôtre, persiste, veut, malgré toutes les résignations particulières. Peut-on rendre, en image, cette contradiction, cette fulgurance ? Et pourquoi, après tout, des images ? Toute image de la mort, précisément en tant qu’image, ne cherche-t- elle pas plutôt à nier la mort, en s’inscrivant dans un temps non périssable, soustrait à la corruption des organismes vivants ? Les stèles funéraires, les marbres, les premiers ornements qui couronnaient les sépultures, ont été faits dans le matériau le plus durable, représentant le mort via la mort éternelle, rendue immortelle par la matière, laquelle matière contenait, par transfert, l’essentiel du vivant, son statut statufié, récit inscrit dans la pierre, rien qu’une idée (roi, empereur, négociant). Tout tableau peint, tout bronze, bien que prélevé sur un modèle, ne nous émeut pas pour ce qu’il représente, c’est-à-dire tel être vivant que l’artiste a, un jour, voulu rendre, capturer dans un instant palpable : instant d’extase, heure du trépas. Un portrait, même le plus réaliste, le plus fin, ne nous dit pas, avant tout, “cette personne a été”. C’est que l’opération de représentation (la main de l’artiste) intercède entre le corps du modèle et le corps de l’artiste, transcendant la mort, rachetée par une toile, un moule, qui, lui, persistera. Les morts de Goya, du 13/10/2021 18:40 L'épreuve de la mort au cinéma (I) – Hors Champ https://horschamp.qc.ca/article/lpreuve-de-la-mort-au-cinma-i 4/15 Caravage, les naufragés de David, les évanouies de Claudel, sont des icônes. Leur valeur d’indice est, au mieux, anecdotique (ex. Velasquez a peint telle infante, telle fille de la cour). Dès lors, l’entreprise de rendre la mort, ne peut passer que par ce détour qui la nie, en quelque sorte. Et toute l’histoire des images en Occident, procède d’une telle négation. Si, selon Debray, l’art “naît funéraire”, c’est en “opposant à la décomposition de la mort la recomposition par l’image. ” L’image rend la mort en triomphant, en quelque sorte, sur elle, plus justement, sur son temps, sur le temps. Si les images ont pu servir, en un temps, de médiation entre les vivants et les morts, c’est en annulant la fracture entre les deux règnes, c’est en permettant aux morts d’entretenir des relations, des commerces avec les vivants. Bien entendu, nous avons depuis abandonné cette dimension magique que nous attribuions aux images, bien que l’essentiel, sur le plan du temps, demeure, dans tous les arts plastiques figuratifs. Le temps n’y est jamais immédiatement présent. S’il y a du temps dans une peinture, c’est un temps historique (prise de Constantinople), ou un temps contingent (datation), qui n’informe en rien, ou très peu, le coloris, la ligne du tableau, le fond de son expérience esthétique. Telle tache au pinceau nous dit bien “ceci a été peint”, mais ne nous montre pas le geste, seule la trace qui s’est dégagée du geste (c’est la trace, non le geste, qui demeure). C’est, soustrait au temps, une expérience d’un temps sans contrainte, sans fin, un temps non embarassé dans les rets du temps. D’ailleurs, à titre d’exemple, nous pourrions relever le fait que les modes vestimentaires de l‘époque ne nous gênent jamais dans un tableau. Personne ne trouvera à redire de telle robe de Crêpe dans un tableau de Renoir (ni dans un roman de Proust). Sa figurabilté est au-delà de l’autorité de sa figuration. Elle uploads/s3/ l-x27-e-preuve-de-la-mort-au-cine-ma-i-hors-champ 1 .pdf
Documents similaires




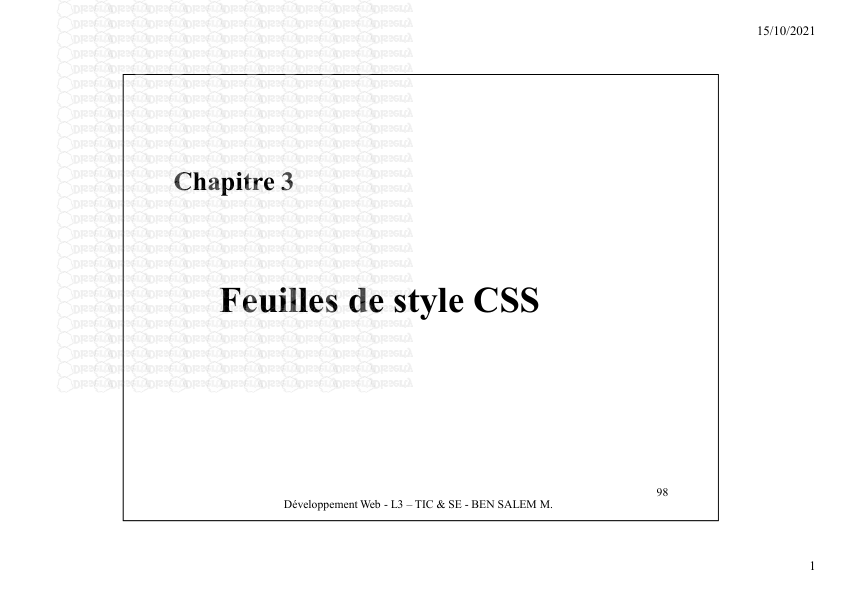





-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 30, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2158MB


