Chapitre 5: ARCHITECTURE D’UN MEMOIRE - Les conditions de fond et de forme évoq
Chapitre 5: ARCHITECTURE D’UN MEMOIRE - Les conditions de fond et de forme évoquées tout au long de ce cours se traduisent dans ce document appelé mémoire que chacun est contraint de rédiger, car: MÉMOIRE = FORME + FOND - Une forme agréable donne envie de lire le mémoire et engendre l’indulgence face à certains manquements; - Mais une forme quelconque avec un fond de qualité dévalorise l’ensemble du travail en suscitant la critique et le rejet; - Mémoire de 60 à 80 pages de corpus (de l’introduction générale – P.1 à la fin de la bibliographie - page allant de 60 à 80): • à moins de 60 pages, l’étudiant est taxé de paresseux et le travail perçu comme inachevé • à plus de 80 pages, on considère l’étudiant comme manquant d’esprit de synthèse - Mémoire: Sujet → 4 grandes séquences • Introduction générale • Développement • Conclusion générale • Bibliographie - La longueur du mémoire se situe entre 60 et 80 pages • Introduction générale: 3 à 5 pages • Développement: 54 à 72 pages ; c’est-à-dire * Première partie: 27 à 36 pages en moyenne * Deuxième partie: 27 à 36 pages en moyenne * Chapitre: 14 à 18 pages en moyenne • Conclusion générale: 2 à 3 pages • Bibliographie: à partir d’une page 1- La taille du mémoire 2 1- La taille du mémoire • Contraintes d’équilibre * Les parties doivent être en principe de même densité, mais des déséquilibres tout à fait normaux peuvent exister. Dans ce cas il faudra chercher à les minimiser. Un déséquilibre de 5 pages pour un mémoire de 60 pages peut être toléré, de même un déséquilibre de 7 pages pour un mémoire de 80 pages. A plus, il se pose un problème. * A l’intérieur d’une partie, il en est de même pour les chapitre. Eviter des déséquilibre de 3 à 4 pages entre les chapitres. * Ce principe est également valable pour les sections et à l’intérieur des sections. NB: Si un chapitre a moins de 11 pages, une partie moins de 23 pages, il faut s’inquiéter et chercher rapidement à corriger le déséquilibre pressenti. 3 1- Le nivellement de la pensée ou des idées - Se reconnait à travers: • La taille des introductions • La codification 1.1. L’introduction - La taille d’une introduction doit être proportionnelle à son positionnement, - Elle doit baisser au fur et à mesure que l’on rentre dans le développement. - Logique à respecter : Introduction générale > Introduction partie Introduction partie > Introduction chapitre Introduction chapitre > Introduction section NB: Les introductions sont obligatoires jusqu’aux sections car elles fournissent le fil conducteur de la pensée ou du développement. Après on peut s’en passer ou se limiter à proposer juste des chapeaux. 4 1.2. La Codification - 3 codifications: 1) Alphabétique: A, B, C; a, b, c; i, ii, iii; 2) Numérique: I, II, III; 1, 2, 3; I1, I2; 11, 12; 21, 22; 211, 212, 213 3) Alphanumérique: A1, B1; 1a, 2a; etc. • Une idée A ou B ou I, II; 1, 2, etc. suivant le modèle choisi est toujours une idée de premier niveau • Une idée I1, 11, 12, 21, 22, 31, 32 est toujours une idée de 2e niveau suivant le modèle choisi • Une idée 111, 121, 311, etc. est une idée de 3e niveau et 1111 ou 3125 une idée de 4e niveau. 5 - Dans la pratique, on obtient cette structure: Sujet Introduction générale Partie I (ou 1): TITRE EN MAJUSCULES Chapitre 1 (ou I) → Titre un peu plus petit Section 1→ Titre plus petit 1________ 1.1_______ 111 112 113 1.2_______ 121 122 1.3 ______ 131 132 2____________ 2.1 ______ 211 212 2.2 ______ 221 222 223 2231 (ou a) 2232 (ou b) Chapitre 2 (ou II): Titre un peu plus petit Section 2 → Titre plus petit 1______ 1.1_______ 111 112 1121 (ou a) 1122 (ou b) 1.2_______ 121 122 123 2_______ 2.1 ____ 211 212 2.2 ____ 221 222 2.3 ____ 231 232 Partie II (ou 2): TITRE EN MAJUSCULES - Elle obéit à la même logique de structuration Conclusion générale Bibliographie NB: La codification alphabétique est limitée, car n’autorisant pas des développements en profondeur • L’importance d’un titre se reconnait aussi par sa mise en évidence. 6 2. L’introduction générale: 3 à 5 pages - Contexte annonçant le sujet - Intérêt du sujet - Problématique et/ou question de recherche - Intérêt de la problématique et/ou du questionnement si intérêt du sujet non mis en évidence - Objectif - Démarche méthodologique - Plan (se limiter aux grandes parties et éviter absolument de parler des chapitres) 7 3- Le développement - Obligation de revenir sur la structure du travail - Nécessité d’une forte corrélation entre: le sujet, la question de recherche ou problème posé, les hypothèses ou propositions de recherche s’il y en a et le plan. Exemple: - Sujet: Gestion des carrières et implication des salariés au travail: cas de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) - Question de recherche: Comment la gestion des carrières peut-elle influer sur l’implication des salariés au travail? • Q1: Quelle est l’influence de la formation sur l’engagement des salariés au travail? • Q2: Quelle est l’influence de la mobilité sur la participation des salariés au travail? Proposition 1: La formation a un impact sur l’engagement des salariés au travail Proposition 2: La mobilité a un impact sur la participation des salariés au travail 8 Plan Première partie: Construction de la relation entre la gestion des carrières et l’implication des salariés au travail Deuxième partie: Effets de la gestion des carrières sur l’implication des salariés à la BEAC - Ces 2 parties recoupent parfaitement le sujet et sont complémentaires: une théorique, une autre empirique - Elles révèlent aussi l’intention de l’étudiant à répondre à la question posée (comment la gestion des carrières peut-elle influer sur l’implication des salariés au travail?) 9 - Approfondissement de la structure Première partie: Construction de la relation entre la gestion des carrières et l’implication des salariés au travail Chapitre I: Cadre théorique de la gestion des carrières et de l’implication Chapitre II: Lien théorique entre les pratiques de gestion des carrières et l’implication Deuxième partie: Effets de la gestion des carrières sur l’implication des salariés à la BEAC Chapitre III: Démarche d’investigation au sein de la BEAC Chapitre IV: La formation et la mobilité comme déterminants de l’engagement et de la participation à la BEAC 10 Approfondissement de la structure Première partie: Construction de la relation entre la gestion des carrières et l’implication des salariés au travail Chapitre I: Cadre théorique de la gestion des carrières et de l’implication Section 1: La carrière dans l’entreprise: ses déterminants Section 2: Les articulations de l’implication des salariés Chapitre II: Lien théorique entre les pratiques de gestion des carrières et l’implication Section 1: La formation et l’engagement des salariés Section 2: La mobilité de la participation des salariés Deuxième partie: Effets de la gestion des carrières sur l’implication des salariés à la BEAC Chapitre III: Démarche d’investigation au sein de la BEAC Section 1: Voyage au cœur de la BEAC Section 2: Les outils méthodologiques mobilisés au sein de la BEAC Chapitre IV: La formation et la mobilité comme déterminants de l’engagement et de la participation à la BEAC Section 1: Rôle de la formation et de la mobilité sur l’engagement et de la participation à la BEAC Section 2: Recommandations vers un modèle de gestion des carrières ancré sur la formation et la mobilité des salariés à la BEAC: Remarque: cette structure montre la détermination de l’étudiant à répondre à la question posée et à atteindre ses objectifs de recherche. 11 3.2. Les renvois - On est toujours amené à citer les auteurs ou à donner les sources des idées, et parfois apporter des explications complémentaires sur certains points, notions, contextes, etc. - 2 façons de faire les renvois: a) Directement à la bibliographie Cette présentation oblige à donner le nom de l’auteur ainsi que l’année du travail référencé dans le développement (et à préciser la (les) page(s) concernée (s) si c’est un ouvrage. Exemple: ‘’La notion de carrière qui examine ces problèmes telle que présentée par ROGER A. (1992) et SHEIN E. H. (1971) se veut désormais pluridisciplinaire … l’implication personnelle est le entre un sujet et un objet (RATEAU P., 2004; ROUQUETTE M. L., 1997, P. 28) 12 - Bibliographie dérivée - Rateau P. (2004), L’approche structurale des représentations sociales: Nouvelles perspectives intégratives, HDR, Université Montpellier 3. - ROGER A. (1992), La gestion des carrières, Tome 1, Encyclopédie du Management, Vuibert, Paris, P. 91-100. - ROUQUETTE M. L. (1997), La Chasse à l’immigré, violence, mémoire et représentation, sprimont, 420 P. - SHEIN E. H. (1971), The Individual, The Organisation and the Career: A conceptual Scheme, The Journal of Applied Behavior Science, vol7, n°4, P 401-427. 13 14 b) En notes de bas de page • Cette présentation amène le rédacteur à indexer les renvois (numéro de la référence) uploads/s3/ le-memoire 1 .pdf
Documents similaires


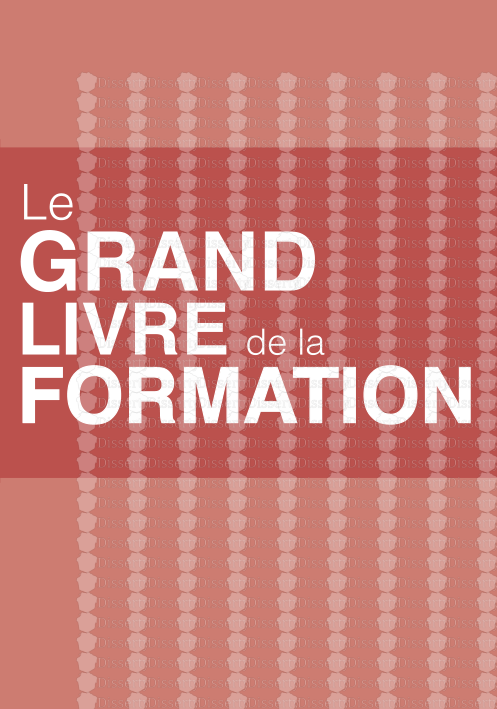







-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1573MB


