Par son rayonnement international, par sa longévité, le surréalisme occupe une
Par son rayonnement international, par sa longévité, le surréalisme occupe une place singulière dans l’histoire des avant-gardes du 20e siècle. Avec « Le Surréalisme et l’objet », première exposition d'ampleur consacrée aux pratiques sculpturales du surréalisme, le Centre Pompidou invite le visiteur à renouveler son approche du mouvement. Du premier ready-made de Marcel Duchamp aux sculptures de Miró de la fin des années 1960, l’exposition retrace, à travers ses différentes étapes, l’histoire de la « mise au défi » surréaliste de la sculpture par le recours à l’objet quotidien. Lors de sa fondation en 1924, le surréalisme trouvait en son nom même le projet d’un dépassement du réel. André Breton, dans son Manifeste fondateur, en appelait à une création avant tout tributaire d’un « modèle intérieur ». Le rêve et l’inconscient, l’automatisme dans la création, devaient inspirer une poésie destinée à nier, à affoler le réel. Un second chapitre de l’histoire du surréalisme s’ouvre en 1927, avec l’engagement de ses membres les plus actifs dans les rangs du Parti Communiste Français. L’adhésion des surréalistes à cette idéologie politique impliquait la prise en compte d’un réel qui constitue le socle théorique et philosophique du communisme. Breton en appelle alors à fonder une « physique de la poésie ». L’objet surréaliste affirmera cette prise en compte durable du réel. Il s'imposera, pour le surréalisme militant, comme la réponse à ce nouveau contexte politique et philosophique. À travers plus de 200 œuvres, l’exposition rend compte des moments clés de cette réflexion, ainsi que de sa postérité féconde dans l’art contemporain. LE SURRÉALISME ET L’OBJET 30 OCTOBRE 2013 - 3 MARS 2014 www.centrepompidou.fr READY-MADE ET MANNEQUINS Dix ans avant la création du surréalisme, en 1914, Giorgio De Chirico et Marcel Duchamp inventent deux objets appelés à connaître une fortune durable dans l’imaginaire du mouvement. Le premier introduit l’image du mannequin dans sa peinture, le second fait l’acquisition d’un porte- bouteilles, appelé à devenir son premier ready- made. De La Poupée (1933-1934) de Hans Bellmer aux mannequins qui borderont les « rues » de l’« Exposition internationale du surréalisme » de 1938, les mannequins ponctueront les manifestations du surréalisme. Le Manifeste de 1924 les présente comme l’un des objets les plus propices à provoquer le « merveilleux » surréaliste, à faire naître ce sentiment « d’étrange étrangeté », inspiré à Sigmund Freud par sa découverte de la « poupée » d’un conte d’Hoffmann. En 1938, le Dictionnaire abrégé du surréalisme fera du ready-made de Duchamp un « objet élevé à la dignité de l’œuvre d’art par la seule volonté de l’artiste », le prototype d’un objet surréaliste cristallisant les rêves et les désirs de son « inventeur ». (Salle 1) OBJETS À FONCTIONNEMENT SYMBOLIQUE Dalí donne une première définition de ce qu’il nomme « objets à fonctionnement symbolique », dans Le Surréalisme au service de la révolution en 1931: « Ces objets, qui se prêtent à un minimum de fonctionnement mécanique, sont basés sur les fantasmes et représentations susceptibles d’être provoqués par la réalisation d’actes inconscients. […] Les objets à fonctionnement symbolique ne laissent aucune chance aux préoccupations formelles. Ils ne dépendent que de l’imagination amoureuse de chacun et sont extra plastiques. » Par son érotisme latent, sa forme qui relève plus du jouet pour enfant que de la sculpture traditionnelle, la Boule suspendue d’Alberto Giacometti, que découvrent Salvador Dalí et André Breton en 1930 à la galerie Pierre Loeb, annonçait cette définition. (Salle 2) ALBERTO GIACOMETTI À la fin des années 1920, Alberto Giacometti rencontre le cercle qui se forme autour de la revue Documents que créent l’historien de l’art primitif Carl Einstein et le philosophe Georges Bataille. Ses œuvres s’emparent alors des thématiques violentes, sacrificielles, qui caractérisent l’orientation que Bataille donne à sa revue. Les sculptures récentes de l’artiste, présentées au printemps 1930 à la galerie Pierre Loeb, impressionnent André Breton qui lui propose de rejoindre le mouvement surréaliste. Jusqu’en 1935, Giacometti participera aux manifestations du groupe, réalisant des sculptures-objets inspirées par ce « modèle intérieur » auquel Breton invitait les artistes du groupe à se soumettre : « Depuis des années, je n’ai réalisé que les sculptures qui se sont offertes toutes achevées à mon esprit, je me suis borné à les reproduire dans l’espace sans y rien changer. » (Salle 3) LA POUPÉE Au milieu des années 1920, Hans Bellmer entre en contact avec Lotte Pritzel, une créatrice de poupées de cire à qui le peintre viennois Oskar Kokoschka avait, quelques années plus tôt, demandé de façonner un mannequin, substitut d’Alma Mahler avec laquelle il venait de rompre. Au début des années 1930, un faisceau d’événements conduit Bellmer à mettre en chantier sa propre Poupée. À l’hiver 1932, sa mère lui expédie une caisse contenant les jouets de son enfance, dont quelques vestiges de poupées aux membres disjoints. Au moment où Bellmer se rapproche de George Grosz, le peintre des automates dadaïstes, il découvre dans un opéra d’Offenbach, mettant en scène les contes d’Hoffmann (L’Homme au sable), la poupée Olympia, qui réactive son souvenir du « fétiche » de Kokoschka. Il confectionne sa première poupée, qu’il met en scène dans des photographies, reproduites en décembre 1934 dans la revue Minotaure. Jalon essentiel de la mannequinerie surréaliste, La Poupée de Bellmer est investie de la dimension érotique qui, du mythe de Pygmalion jusqu’aux modernes poupées de silicone, est associée à ces effigies féminines. (Salle 4) OBJETS TROUVÉS / « EXPOSITION INTERNATIONALE DU SURRÉALISME », 1933 C’est dans l’exposition organisée en 1933 à la galerie Pierre Colle que le surréalisme affirme la place qu’occupe désormais l’objet dans l’imaginaire du groupe. Tristan Tzara rédige la préface du catalogue qui accompagne l’exposition : « Objets désagréables, chaises, dessins, sexes, peintures, manuscrits, objets à flairer, objets automatiques et inavouables, bois, plâtres, phobies, souvenirs intra-utérins, éléments de rêves prophétiques, dématérialisations de désirs […] Vous souvenez- vous encore de cette époque où la peinture était considérée comme une "fin en soi" ? Nous avons dépassé la période des exercices individuels. […] Le temps passe. Par le caractère affectif de vos rendez-vous. Par les recherches expérimentales du surréalisme. Nous ne voulons pas reconstruire des arches. Partisans sincères du mieux, nous avons essayé d’embellir un peu, physiquement et moralement, la physionomie de Paris. En tournant le dos aux tableaux. […] » (Salles 5, 6) « EXPOSITION SURRÉALISTE D’OBJETS », 1936 « L’Exposition surréaliste d’objets », présentée à la galerie Ratton en mai 1936, est vouée à la quintessence d’un surréalisme qui démontre sa capacité à transfigurer, à transmuter les objets et, par eux, le réel lui-même. Loin de tout savoir- faire, de tout génie artistique, c’est la puissance de désignation surréaliste qui constitue l’objet de l’exposition. Point d’orgue de la réflexion surréaliste appliquée à l’objet, elle est une forme d’apogée d’un surréalisme rendu à sa pureté à la fois poétique et théorique. Dans les vitrines, sur les murs, nulle trace du savoir-faire, du talent valorisé par l’esthétique bourgeoise. Ready-made sortis momentanément de leur anonymat fonctionnel, ces objets défient toute spéculation, tout fétichisme, à l’instar du Ceci n’est pas un morceau de fromage de René Magritte qui, à l’issue de l’exposition, est désassemblée : la cloche de fromage sous laquelle était présenté le tableau est rendue à son usage premier. (Salle 7) « EXPOSITION INTERNATIONALE DU SURRÉALISME », 1938 La contestation de l’œuvre d’art traditionnelle, le projet d’inscription du surréalisme dans le monde concret, dont témoigne la prolifération des objets, s’expriment aussi par une conquête de l’espace réel. Celle-ci prend la forme d’une mise en scène des expositions surréalistes, qui annonce l’art de l’installation. Marcel Duchamp, intronisé « générateur-arbitre » de l’« Exposition internationale du surréalisme », organisée en 1938 à la galerie des Beaux-Arts, conçoit la scénographie de l’exposition. Chacun de ses seize participants est invité à « habiller » un mannequin sorti des vitrines des grands magasins. Ces mannequins forment une haie de part et d’autre de la Rue surréaliste qui accueille les visiteurs. (Salle 8) LE SURRÉALISME EN EXIL : L’OBJET AU DÉFI DE LA SCULPTURE La Seconde Guerre mondiale conduit les surréalistes à l’exil. André Breton, Max Ernst, André Masson, Roberto Matta, Yves Tanguy, entre autres, s’installent aux États-Unis. Les années 1940 et celles qui suivront voient l’apparition d’une nouvelle génération de sculptures pour lesquelles l’objet ordinaire, quotidien, devient le matériau élémentaire d’assemblages dont la logique constructive s’apparente à celle du « cadavre exquis » (juxtaposition libre d’éléments hétérogènes). Max Ernst conçoit des créatures anthropomorphes en assemblant les moulages de plâtre de ses objets domestiques. En 1932, Alexander Calder rencontre Joan Miró, qui l’incite à élargir son vocabulaire formel à un registre inspiré du végétal et de l’animal. Apple Monster, de 1938, composé de branches de pommier ramassées aux abords de son atelier, évoque avec humour la fascination des surréalistes pour les monstres. Avec Tête de taureau, 1942, qui résulte de l’assemblage d’une selle et d’un guidon de vélo, Pablo Picasso est ici un protagoniste majeur de ce procédé. (Salle 9) EXPOSITION « LE SURRÉALISME EN 1947 » L’exposition « Le Surréalisme en 1947 », inaugurée le uploads/s3/ normal.pdf
Documents similaires



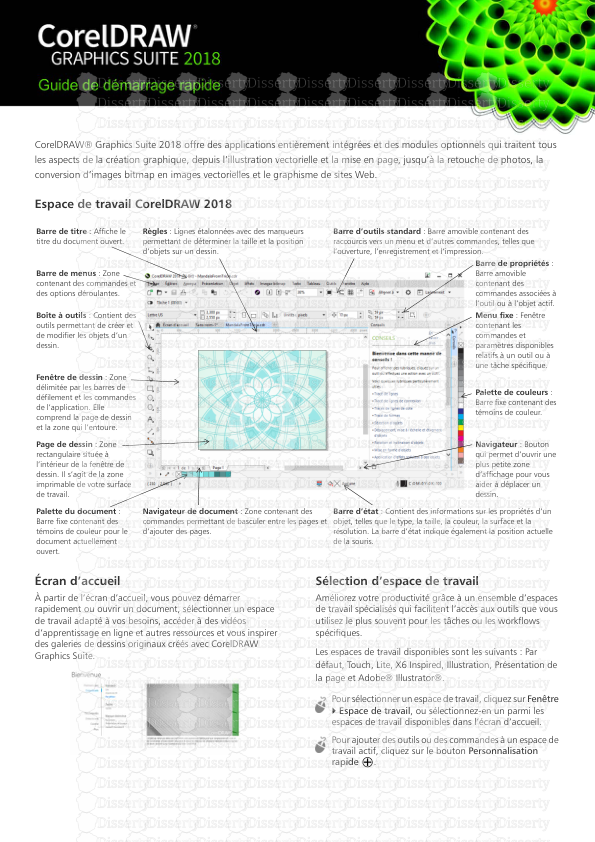






-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3858MB


