ECLAIRAGE PUBLIC LIEUX DE TRAVAIL STADES Les normes européennes de l’éclairage
ECLAIRAGE PUBLIC LIEUX DE TRAVAIL STADES Les normes européennes de l’éclairage Le présent cahier technique est consacré aux normes européennes sur l’éclairage. Il est d’autant plus important de les connaître qu’elles servent désormais de référentiel pour l’élaboration des cahiers des charges, de mode de preuve de conformité et de contrôle des projets d’éclairage et de spécifications d’éclairage pour gérer la maintenance des installations d’éclairage. Ces normes, volontaires par essence, peuvent devenir obligatoires dans leur application s’il y est fait référence dans le cadre d’un marché public ou dans un texte juridique à caractère réglementaire. Mais, avant d’entrer dans le détail des textes, Bernard Duval, délégué général de l’AFE et président de la commission X90X “Lumière et éclairage” de l’AFNOR, a souhaité répondre à ceux qui estiment ou bien que la normalisation les enferme dans un carcan peu créatif et les déresponsabilise ou bien, au contraire, qu’elle les menace sur le plan juridique. “Sans norme, il ne peut y avoir ni qualité ni sécurité” page 46 Norme européenne d’éclairage public page 47 Normes pour l’éclairage des lieux de travail page 48 Éclairage des installations sportives et normalisation page 49 45 LUX n° 228 - Mai/Juin 2004 46 LUX n° 228 - Mai/Juin 2004 Les normes n’ont pas toujours bonne pres- se. En éclairage, certains “créatifs” se plai- gnent des exigences normatives comme d’un carcan trop serré : trop “objectives”, trop “scientifiques”, s’opposant au ressen- ti, à l’esthétique et au – vrai – bien-être. Inversement, d’autres y voient une remise en cause par les éclairagistes du pouvoir des gestionnaires et des maîtres d’ouvrage. Qu’en pensez-vous ? BERNARD DUVAL – Ce que vous dites est assez amusant, parce que ce sont les bureaux d’études – notamment anglais –, concepteurs eux-mêmes d’installations d’éclairage, qui ont poussé, il y a longtemps déjà, à la normalisa- tion pour pouvoir prescrire des critères tech- niques permettant de construire leurs cahiers des charges techniques. Quoi qu’il en soit, tou- te norme contraint, en effet, puisqu’elle fixe un cadre. Elle peut avoir valeur juridique, même si ce n’est pas sa nature première. Définie de manière consensuelle, elle est égalitaire dans son essence parce qu’elle évite la prescription d’installations qui seraient dispendieuses sur le plan économique et permet d’exprimer des cri- tères de qualité en dessous desquels la visibili- té, la sécurité, la santé, les performances ergo- nomiques peuvent être gravement affectées. Mais c’est cela qui est très positif. La norme a le mérite de codifier suivant les études et recherches menées sur le plan de la visibilité et de l’ergonomie. Mais, minimaliste, elle ne contraint pas le concepteur, qui dispose d’un espace pour donner libre cours à sa créativité, en particulier sur le plan de la valorisation de l’environnement pour autant que la sécurité et les bonnes conditions de visibilité des usagers soient respectées. Sans norme, il ne peut y avoir ni qualité ni sécurité des produits, des installations, des systèmes mis en oeuvre. Chacun, autrement, construirait, choisirait, prescrirait ce qui lui plaît. Même si de bons éclairagistes, de grands bureaux d’études, des maîtres d’œuvre expérimentés se montrent compétents, l’on a trop vu d’installations coû- teuses, inefficaces, à la limite dangereuses, parce que des non-professionnels avaient géré le lot éclairage. Certains maîtres d’ouvrage aujourd’hui freinent également devant la nor- malisation parce qu’elle risque d’engager beaucoup trop, à leur goût, leur responsabilité. Ce débat reste ouvert, mais les risques encou- rus dans le cadre d’une procédure judiciaire par des installations conformes aux critères de la norme sont les mêmes que ceux qui résulte- raient des installations reconnues défectueuses. La norme ayant en plus l’avantage de consti- tuer pour le gestionnaire un garde-fou dans le cadre du maintien des niveaux d’éclairage de son installation. Mais n’est-il pas exact que les ingénieurs conçoivent les normes, et ceci n’entraîne-t-il pas parfois une façon de procéder qui trai- te l’homme en objet sans s’occuper de son vécu ? B.D. – Franchement, c’est, entre autres, contre de telles idées que nous nous insurgeons et que nous voulons défendre la normalisation. S’il est exact que des scientifiques et des tech- niciens président à la création des normes sur l’éclairage, il faudrait se rappeler comment ils le font ! Dès que l’on a mesuré la lumière, on a voulu décrire le luminaire et les grandeurs photométriques qui y sont associées pour qu’il fournisse aux usagers la meilleure visibilité et le meilleur confort. C’est cela qu’il faut retenir : visibilité et confort, que vous pouvez traduire par sécurité et bien-être. Les normes d’éclairagisme sont basées sur une série de critères qui doivent aboutir à ce résultat, en fonction des activités concernées. De là est issu un code de bonnes pratiques, qui est susceptible de se modifier au fur et à mesure que nos connaissances sur la physiolo- gie humaine ou que nos technologies progres- seront. Je ne pourrais que prendre l’exemple des travaux en cours sur les effets curatifs ou dépressifs de la lumière. Quand nous en sau- rons plus, les normes intégreront probable- ment les résultats de ces recherches médicales menées sur ce thème. Comme seront inté- grées, au travers des normes, les préoccupa- tions environnementales comme la protection de la nature et du milieu social et… de la san- té, voire de la survie humaine. L’élaboration des produits suivant les critères de l’éco- conception et leur mise en œuvre dans des projets d’éclairage en conformité avec les normes contribueront à réduire la quantité de déchets et de substances dangereuses. Est-ce qu’une notion nouvelle comme celle du développement durable est contenue dans les normes d’éclairage ? B.D. – Les rédacteurs des normes d’éclairage que nous présentons ici ont incorporé les pro- blématiques du développement durable qui, rappelons-le, se réfère, dans son concept, au progrès social et économique qui préserve les ressources naturelles et énergétiques. Mais les ingénieurs éclairagistes en charge de la norma- lisation sont de petits cachottiers : ils en ont intégré toutes les composantes sans véritable- ment les exprimer ! (Voir encadré.) Vous avez tout à fait raison de nous rappe- ler qu’une norme est un référentiel et un guide de conception d’installations de qualité. N’est-ce pas aussi un outil de communication, voire de formation ? B.D. – De toute évidence. C’est un outil de communication entre ceux que j’appellerais les “acteurs de la normalisation”. Autrement dit : les constructeurs (et leurs organisations profes- sionnelles), les donneurs d’ordres, les labora- toires d’essais, les consommateurs bien sûr, les certificateurs et les accréditeurs, les Etats, la Commission européenne, l’Organisation mon- diale du commerce et les ONG. L’ensemble de la filière économique est impliqué. La norme garantit la qualité des produits, des installa- tions, des systèmes, des prestations. Clients et fournisseurs peuvent s’y référer, les décideurs institutionnels ou non définir dans ces référen- tiels quels sont les bons usages, et, par exten- sion, comment assurer la sécurité de l’usager. La norme a une incidence directe sur des sec- teurs économiques comme le nôtre qui – par- donnez la métaphore – ont besoin de sortir de l’ombre. Elle est ainsi un moyen de « vendre » l’éclairage dans des secteurs où il est encore trop faiblement représenté (bureaux d’études thermiques, aménageurs de bureaux, voire fournisseurs d’énergie !). Nous avons, par exemple, les pires difficultés à introduire les notions de qualité de l’éclairage dans le bâti- ment ; lors d’une conférence au CSTB sur la réglementation thermique, nous avons pu constater l’enthousiasme des thermiciens, majoritairement présents dans la salle – qui ne connaissaient absolument pas les probléma- tiques énergétiques de l’éclairage et encore moins les progrès techniques accomplis par les équipements d’éclairage (ballasts électro- niques, système de gestion, nouvelles lampes…) et les moyens de les valoriser dans des projets d’éclairage par les normes d’éclai- rage. J’ajouterais, qu’à l’heure européenne, il est plus que jamais impératif de normaliser. C’est bien sûr lié à l’instauration du libre échange dans une Europe qui, maintenant, se construit à 25. Nous aurons de plus en plus besoin d’un langage commun pour gérer de façon harmonieuse les questions techniques, économiques, et politiques. I “Sans norme, il ne peut y avoir ni qualité ni sécurité” LUX cahier technique Mode d’application du développement durable à l’éclairage La qualité d’un éclairage peut s’exprimer par le modèle tri-dimensionnel classique qui incorpore le “bien-être” de l’individu, l’économie et l’environnement. La notion de “bien-être” est traduite dans ces normes par le niveau d’éclairement à prescrire et par le contrôle de l’éblouissement de l’installation d’éclairage qui apporte visibilité, confort, santé, ergonomie et sécurité dans les activités. Il faut y ajouter les critères d’indice de rendu des couleurs et, parfois, de température de couleur, pour restituer le confort et la qualité des ambiances lumineuses. Les valeurs d’éclairement propres à chaque type de lieux ou nature d’activité sont exprimées sous la forme de “valeurs minimales à maintenir”, ce qui implique une optimisation économique du projet d’éclairage et un choix approprié des équipements d’éclairage et des modes de maintenance et d’entretien des installations. On peut regretter que le normalisateur n’ait pas suffisamment insisté dans ses prescriptions sur les bénéfices économiques qu’apportent les systèmes de gestion de uploads/s3/ normes-euro-eclairage.pdf
Documents similaires


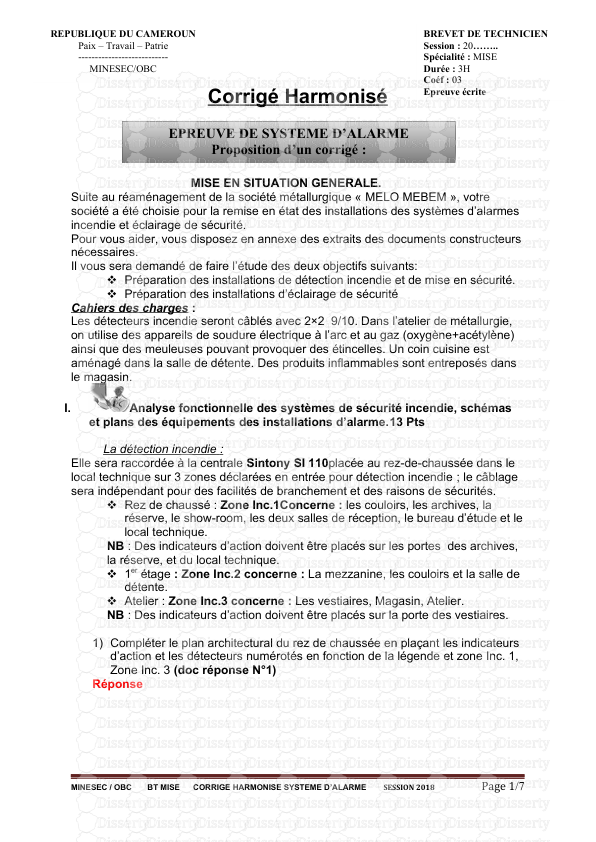







-
86
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 14, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1945MB


