Copie de conservation et de diffusion, disponible en format électronique sur le
Copie de conservation et de diffusion, disponible en format électronique sur le serveur WEB du CDC : URL = http://www.cdc.qc.ca/prospectives/l7/hebert-l7-3-1981 .pdf Article revue Prospectives, Volume 17, Numéro 3. * * * SVP partager I'URL du document plutôt que de transmettre le PDF * * * o u i . . . mais pourquoi ? par Bruno Hébert professeur de philosophie au Campus Notre-Dame-de-Foy Le Campus Notre-Dame-de-Foy offre, depuis 1975, un cours en art vestimentaire. Le programme, bien entendu, vise à la maîtrise d'une technique, mais aussi il fournit des occasions de réflexion et de créativité. Jusqu'au professeur de philosophie qui s'en est mêlé. Voici, sous forme d'abrégé, le fruit de sa recherche sur une question de base en philosophie du vêtement - on pourrait presque dire en philosophie de la communication. Le propre est un caractère qui appartient à toute l'espèce, et rien qu'à l'espèce. Voilà ce qu'enseigne la logique. Ainsi, le propre de l'homme, selon l'exemple classique, c'est d'être capable de rire. On pourrait ajouter: d'être capable de parler, de chanter de l'opéra, de compter, de transcrire, d'ironiser, etc. - tout comportement qui nécessite et manifeste l'opération de la raison. Autre propre de l'homme dont on parle peu : l'homme est l'animal qui se vêt, c'est-à-dire qu'il est doué pour le faire et qu'il est le seul à le faire. Encore faudrait-il définir cette potentialité, autrement on pourra toujours trouver dans l'inépuisable histoire des comportements animaux - songez à l'éléphant qui se défend contre l'ardeur du soleil en saupoudrant son dos de poussière -, de quoi affirmer que l'habillement n'est pas le seul fait de l'homme. Comme l'activité humaine manifeste son essence moins par la matérialité de l'acte que par la forme, c'est-à-dire, au fond, par l'intention, il serait intéressant d'orienter notre réflexion sur cette question première : qu'est-ce que se vêtir ? Ou, en prenant le mouchoir par un autre coin : pourquoi l'homme se vêt-il ? C'est, avant toute chose, ce qui intéresse le philosophe. Déjà, l'étymologie suggère de ranger l'habit sous l'habitude, et le costume sous la coutume. Vu la proximité du propre de l'homme à la raison, c'est-à-dire à quelque chose d'essentiel, peut-être notre étude nous conduira-t-elle à mieux saisir jusqu'à quel point le vêtement fait corps avec l'homme et le révèle dans ce qu'il a de caché. C'est, en tout cas, dans cette direction que nous allons. Dans la Genèse, il est écrit : << Et Dieu créa l'être humain à son image, il les créa mâle et femelle. >> Or, Erwin Reisner, dans sa Métaphysique de la sexualité', remarque qu'on peut traduire << mâle et femelle >> - sachar et nequebah -, par << convexe >> et << concave ». Puis, il insiste sur ce détail. Le convexe est un défi fait au plan, mais en défiant le plan, il se trouve à dessiner un espace qui l'enveloppe, un espace dont la forme est concave. De sorte que le convexe ne va jamais sans un concave correspondant, et vice versa. Cette corrélation, pour Reisner, constitue un modèle tout à fait universel. Il l'applique à la relation de l'homme PROSPECTIVES OCTOBRE 1981 151 et de la femme, de la mère et de l'enfant, puis, d'une manière plus générale, de l'homme à l'univers, du Créateur à la créature - le convexe étant ce qui « in-forme », et le concave, ce qui accueille la forme et répond de ce mouvement. Or, le même auteur applique ce schéma au vêtement quand il commente cette parole de l'Écriture où il est conseillé au chrétien de se « revêtir du manteau de Jésus-Christ » (Rom. XIII, 14)' c'est-à-dire de se laisser mettre en forme par Jésus-Christ d'une part, et de le réaliser en retour. Cette allusion, sans en avoir trop l'air, intéresse notre propos. Le vêtement a un dehors et un dedans; en ce sens, il est à la fois convexe et concave. Vu du dehors, il avance sa forme, il affiche ses couleurs, il prend l'initiative de « dire » des choses à l'oeil d'autrui. Sous ce rapport, il est convexe : il remplit, si l'on veut, sa fonction masculine. Mais, en tant qu'il enveloppe le corps, qu'il le réchauffe et le protège, on peut dire qu'il est concave, qu'il réalise sa fonction féminine. Cette attribution théorique des rôles trouve de quelque manière son écho dans la plupart des introductions d'ouvrages traitant du vêtement. Pourquoi l'homme se vêt-il ? On répondra tout de suite que c'est pour protéger son corps contre la rigueur des climats : le trop-froid, le trop-chaud, le trop-humide , le trop-sec . On dira aussi, à un autre point de vue, que c'est pour protéger son âme de la cupidité d'autrui - question de pudeur. Voilà qui satisfait à l'instinct de conservation et correspond à la fonction concave ou féminine du vêtement. On invoquera, ensuite, la question esthétique, c'est-à-dire la nécessité de paraître, d'arranger son signe pour autrui. Sous cet aspect, le vêtement participe au grand jeu de la communication dans la mesure où, conjointement avec la démarche, le geste, la mimique, le son de la voix, il contribue à l'expression corporelle et prend valeur de langage, ou, plus précisément, de co-langage. Le vêtement pris comme signe permet de connaître et de se faire connaître, c'est-à-dire d'établir le contact. Voilà qui satisfait plutôt à l'instinct d'exploration et correspond à la fonction convexe ou masculine du vêtement. Le vêtement remplit donc un double rôle : il protège et il signifie. Voyons de plus près le sens et les implications de cet énoncé général. Le vêtement, une protection Une question de bien-être L'homme n'a, pour se protéger, comme les autres animaux, ni fourrure, ni duvet, ni écaille, ni corne, ni couenne. II a la peau remarquablement lisse, fine et sensible. C'est un animal nu. Cette fleur de peau, pourtant, n'affecte pas son coefficient d'adaptabilité qui est très élevé. L'homme peut survivre à peu près sous toutes les latitudes, affronter la rigueur de tous les climats - le climat lunaire y compris. La cause en est qu'il est doué de raison et que cette faculté l'habilite à inventer des correctifs et à pouvoir affronter tous les temps, que ce soit par le moyen de l'habit ou par celui de l'habitat. C'est donc le souci de la santé qui pousse d'abord l'homme à se vêtir, à se donner, selon les circonstances et la nécessité, la cuirasse ou la toison qu'il n'a pas. Sans cette facilité d'adaptation et cette ingéniosité native, comment aurait-il pu progresser au point d'agrandir considérablement son aire géographique, au point d'établir sa domination sur les autres espèces ? Mais une fois sauvées la vie et la santé, il est assez étonnant de constater que la recherche du confort, l'hygiène, l'adaptation au climat, jouent rarement le premier rôle dans la conception et le choix du vêtement. Les impératifs esthétiques et moraux sont souvent plus déterminants. On n'a qu'à observer la mode telle qu'elle se porte ou telle qu'elle s'est portée pour s'en convaincre. Qui voudra jurer que le col empesé, les talons aiguilles, la robe fourreau, la mini-jupe en hiver, le veston en été, sont des modèles tout-confort ? C'est à croire que les besoins de l'imaginaire chez l'homme surclassent ceux du corps. Cette préférence non-avouée peut faire sourire, et il y a de quoi : elle nous instruit de façon si inattendue - alors qu'on pense chiffon -, sur le fond de notre nature qui est d'abord psychologique. 152 PROSPECTIVES OCTOBRE 1981 Une question de pudeur Le vêtement sauvegarde encore une autre sorte d'intégrité en préservant l'intimité sexuelle des personnes. Dans nos sociétés, c'est aussi par pudeur que l'on s'habille. Et la pudeur, avant d'être l'effet d'un héritage culturel ou une vertu, est un réflexe naturel commandé, semble-t-il, par l'instinct de conservation. La pudeur, au plan de l'espèce, ne se vit pas au détriment de la sexualité, mais se porte à son service, car cacher, c'est, dans ce cas-ci, se réserver pour une meilleure occasion. Cette proprension à se couvrir pacifie les relations humaines et libère l'esprit pour bien d'autres tâches -, c'est autant de gagné sur le désordre et l'incivilité. Mais n'oublions pas que c'est la pudeur qui permet le langage érotique, si utile en son temps, que ce soit pour choisir et conquérir l'être aimé, nourrir l'élan des beaux jours et assurer la fidélité nécessaire à la famille -, toutes choses qui intéressent au plus haut point l'avenir de la race. L'instinct, qui est, pourrait-on dire, 1' intelligence de la nature en nous, sachant bien que la survie de l'espèce n'irait pas nécessairement de soi, a armé les individus de bien fortes tendances pour encourager, comme dirait Molière, « la propagation ». Le réflexe de pudeur s'explique, en partie, par la nécessité de cette sorte d'économie du salut - du salut de la race, s'entend. Cette retenue dans le charme, cette modestie volontaire, revient pour chacun à ménager son pouvoir de fascination tout au long du voyage. Ce n'est pas peu de chose2. Curieux trait de caractère, I'homme est le seul animal uploads/s3/ oui-mais-pourquoi-par-bruno-hebert-professeur-de-philosophie-au-campus-notre-dame-de-foy.pdf
Documents similaires


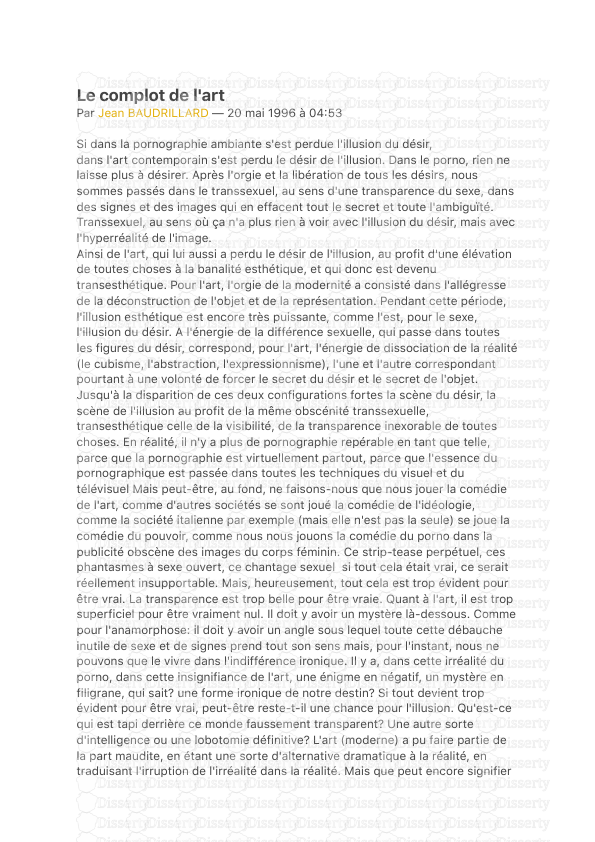







-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 30, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9181MB


