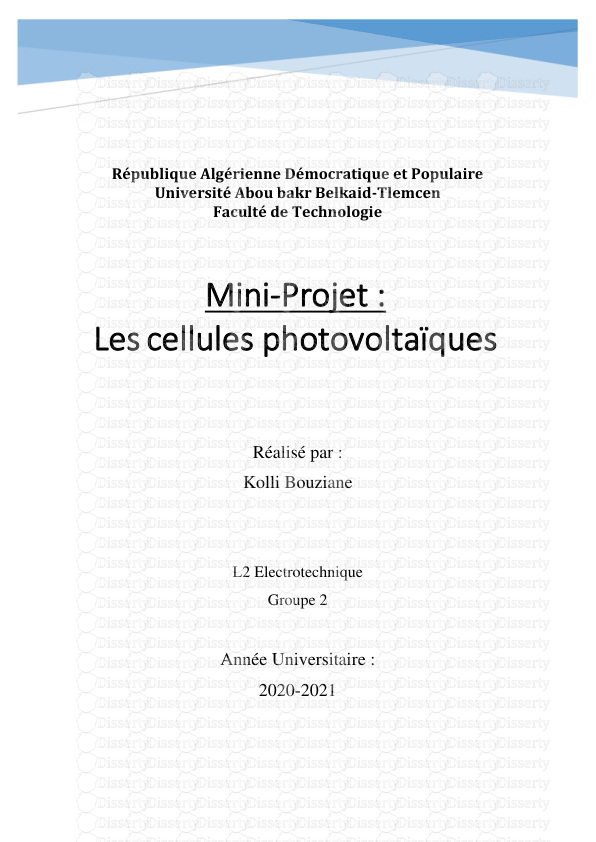République Algérienne Démocratique et Populaire Université Abou bakr Belkaid-Tl
République Algérienne Démocratique et Populaire Université Abou bakr Belkaid-Tlemcen Faculté de Technologie Mini-Projet : Les cellules photovoltaïques Réalisé par : Kolli Bouziane L2 Electrotechnique Groupe 2 Année Universitaire : 2020-2021 Une cellule photovoltaïque, ou cellule solaire, est un composant électronique qui, exposé à la lumière, produit de l’électricité grâce à l’effet photovoltaïque. La puissance électrique obtenue est proportionnelle à la puissance lumineuse incidente et elle dépend du rendement de la cellule. Celle-ci délivre une tension continue et un courant la traverse dès qu'elle est connectée à une charge électrique (en général un onduleur, parfois une simple batterie électrique). Principe de fonctionnement : Un électron à la matrice et crée ainsi un « trou ». En l'absence de dispositif supplémentaire, l'électron trouve rapidement un trou pour se recombiner et l'énergie apportée par le photon est ainsi dissipée. Le principe d'une cellule photovoltaïque est de forcer les électrons et les trous à se diriger chacun vers une face opposée du matériau au lieu de se recombiner en son sein : il apparaîtra une différence de potentiel et donc une tension entre les deux faces, comme dans une pile. L'une des solutions pour atteindre cet objectif, couramment utilisée, est de générer un champ électrique au moyen d'une jonction P-N, c'est à dire entre deux couches dopées respectivement P et N. Typiquement, la couche supérieure de la cellule est composée d'un semi-conducteur dopé Nb. Dans cette couche, il existe une quantité d'électrons libres supérieure à celle du matériau intrinsèque (i.e. non dopé), d'où l'appellation de dopage N, comme négatif (charge de l'électron). Le matériau reste électriquement neutre : c'est le réseau cristallin qui supporte globalement une charge négative. La couche inférieure de la cellule est généralement composée d'un semi-conducteur dopé Pc. Cette couche possédera donc en moyenne une quantité d'électrons libres inférieure à celle du matériau intrinsèque (i.e. non dopé), les électrons sont liés au réseau cristallin qui, en conséquence, est chargé positivement. La conduction électrique est assurée par des trous, positifs (P). Au moment de la création de la jonction P-N, les électrons libres de la région N diffusent dans la couche P et se recombinent avec les trous de la région P. Il existera ainsi, pendant toute la vie de la jonction, une charge positive de la région N au bord de la jonction (parce que les électrons en sont partis) et une charge négative dans la région P au bord de la jonction (parce que les trous en ont disparu) ; l'ensemble forme la Zone de Charge d'Espace (ZCE) et il existe un champ électrique entre les deux, de N vers P. Ce champ électrique fait de la ZCE une diode, qui ne permet le passage du courant que dans un sens : les électrons peuvent passer de la région P vers la région N, mais pas en sens inverse ; inversement les trous ne passent que de N vers P. En fonctionnement, un photon arrache un électron à la matrice, créant un électron libre et un trou. Ces porteurs de charge diffusent jusqu'à la zone de charge d'espace. Là, sous l'effet du champ électrique, ils partent chacun à l'opposé : les électrons s'accumulent dans la région N (qui devient le pôle négatif), tandis que les trous s'accumulent dans la couche dopée P (qui devient le pôle positif). Ce phénomène est plus efficace dans la ZCE, où les porteurs de charges (électrons ou trous) sont séparés immédiatement par le champ électrique. Le phénomène est aussi efficace à proximité immédiate de la ZCE : lorsqu'un photon y crée une paire électron-trou, ils se séparent et ont peu de chance de rencontrer leur opposé, alors que si la création a lieu plus loin de la jonction, le nouvel électron (respectivement le trou) conserve une grande chance de se recombiner avant d'atteindre la zone N (respectivement la zone P). La ZCE est très mince, il est ainsi souvent possible de fabriquer des cellules fines. D'un point de vue électrique, une cellule photovoltaïque est l'équivalent d'un générateur de courant auquel on a adjoint une diode. Il faut ajouter des contacts électriques (qui laissent passer la lumière en face éclairée : en pratique, on utilise souvent un contact par une grille), une couche antireflet pour assurer une bonne transmission des photons vers l'absorbeur. Pour que la cellule fonctionne, et produise le maximum de courant, on ajuste le gap du semi-conducteur au niveau d'énergie des photons. On peut éventuellement empiler les jonctions, de façon à exploiter au mieux le spectre d'énergie des photons, ce qui donne les cellules multi-jonctions, aussi appelées « cellules tandem ». Les différents types de cellules photovoltaïques : • La cellule photovoltaïque en silicium monocristallin Ce type de cellule photovoltaïque est l’une des plus répandues. Elle est obtenue à partir de silicium monocristallin, appliqué en une tranche simple. Elle permet de composer des panneaux solaires qui vont produire de l’électricité servant à alimenter une habitation ou le réseau public, par exemple. • La cellule photovoltaïque en silicium polycristallin Facilement reconnaissable grâce à ses cristaux bleus, cette cellule photovoltaïque se compose d’une seule tranche de silicium. Elle est de forme carrée. On la trouve souvent dans les installations domestiques, agricoles ou industrielles. • La cellule au silicium amorphe La cellule photovoltaïque au silicium amorphe est composée d’une couche fine de silicium, bien plus fine que les monocristallines ou les polycristallines. On la trouve essentiellement pour alimenter les appareils de faible puissance, comme les montres solaires, les éclairages de jardin ou encore les calculatrices solaires. • La cellule photovoltaïque tandem La cellule photovoltaïque tandem est quant à elle conçue à partir de deux couches semi- conductrices simples. Cela peut être une couche de silicium amorphe et une autre de silicium cristallin (mono ou poly) par exemple. Elle montre tout son intérêt pour une utilisation industrielle. • La cellule photovoltaïque CIGS Ce type de cellule photovoltaïque utilise un matériau semi-conducteur fait d’un alliage de cuivre, d’indium, de sélénium et de gallium. Ce mélange est disposé en couche très fine sur un support. • La cellule en couche mince de tellurure de cadmium Ce modèle de cellule photovoltaïque est composé lui aussi à partir d’un matériau autre que le silicium. Ici, c’est du tellurure de cadmium qui est employé en une seule couche scellée entre deux plaques de verre. • La cellule photovoltaïque multi-jonction La cellule photovoltaïque multi-jonction se compose de différentes couches de matériaux semi-conducteurs qui convertissent chaque rayon solaire, quelle que soit l’exposition. Les couches sont empilées, formant la cellule photovoltaïque multi-jonction. Pour l’instant, seuls les engins spatiaux en sont pourvus. Comment est fabriqué un panneau solaire photovoltaïque ? Aujourd’hui, la très grande majorité des panneaux solaires photovoltaïques sont constitués de silicium. Le silicium n’existe pas à l’état libre mais il existe sous différentes formes de minéraux tels que le sable ou encore le quartz. SARL AURES SOLAIRE- AIN YAGOUT, BATNA Le silicium est ainsi le deuxième élément le plus abondant sur Terre (si ce n’est pas un signe, je ne sais pas ce que c’est). La première étape est la fabrication de silicium dit “métallurgique“. Pour ce faire, il faut faire, ce que l’on nomme en chimie, une réduction à partir d’un mélange composé de morceaux de silice (généralement des morceaux de quartz) et de bois. Le mélange est ensuite porté à très haute température (autour de 3 000°) avant d’être purifié à 99,9999 %. On obtient ainsi du silicium solaire qui prend la forme de « petits cailloux » ou de cristaux. Ces derniers sont enfin cuits à près de 1 450° afin de créer des lingots de silicium. Une fois refroidis, les lingots sont coupés en tranches, d’une épaisseur ne dépassant pas les 200 microns. Soit l’épaisseur d’une feuille de papier. Les tranches de silicium, également appelées « wafers », reçoivent un traitement antireflet, qui leur donne cette couleur bleu caractéristique, afin d’augmenter la quantité de lumière absorbée. Elles sont ensuite dopées par l’ajout de phosphore ou de bore. Nous obtenons ainsi des cellules qui, une fois exposées à la lumière du soleil, produisent de l’électricité. Ces cellules ne sont toutefois pas encore utilisables. En effet, un circuit électrique doit encore être imprimé sur la surface du wafer pour que le courant recueilli puisse être transféré. Il ne reste plus qu’à connecter les cellules (entre 48 et 72), les souder, les encapsuler entre une plaque de verre et une couche de polymère puis les encadrer pour former un panneau photovoltaïque. La cellule CZTS : Les laboratoires technologiques sont sans cesse à la recherche de nouveaux matériaux semi-conducteurs afin de créer les cellules photovoltaïques de demain. La cellule CZTS n’est encore qu’un projet en cours d’élaboration. Elle marie du cuivre, du zinc, de l’étain et du soufre (ce qui forme le sigle CZTS). Ce sont des matériaux non toxiques et disponibles en grande quantité sur la surface de la Terre. Ces cellules sont composées de pellicules fines qui absorbent l’énergie solaire sur leur support (verre, plastique, etc.). Le rendement est toutefois moyen, tandis qu’on ne peut pas encore définir sa durée de vie, uploads/s3/ cellules-photovoltaique.pdf
Documents similaires










-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 26, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4004MB