U.3f RECUEIL DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNES
U.3f RECUEIL DE TRAVAUX RELATIFS A LA PHILOLOGIE ET A L'ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNES ET ASSYRIENNES POUR SERVIR DE BULLETIN A LA MISSION FRANÇAISE DU CAIRE FONDÉ PAR G. MASPERO ET PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE EMILE CHASSINAT DIRBCTEDB HONORAIRE DE L'IXSTITUT FRANÇAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE TOME TRENTE-NEUVIÈME PARIS LIBRAIRIE EDOUARD CHAMPION, ÉDITEUR 5, QUAI MAUQUAIS 1921 Tous droits réservés uHWtî^sini. PROVO LE CAIRE IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE ÉTUDES GRAMMATICALES" EDOUARD NAVILLE. IV. — L'AUXILIAIRE Jj'auxiliairc -=r>-, dont trop souvent on n"a pas reconnu le sens, rappelle beaucoup l'anglais do, lequel veut dire à l'origine a faire t». Ce n'est pas ici le lieu de développer les nombreux emplois de l'auxiliaire anglais. Je signalerai seulement le fait que sou- vent le régime qui dépend de do peut être autre chose qu'un simple infinitif. Ce peut être un membre de phrase entier comme dans cette expression : rrdo send me this bookn, et ce régime peut être précédé d'un article qui en fait une sorte de substantif : ctthe constant watching which I bave to dor. Nous trouvons des expressions tout analogues en égyptien : du verbe -«- dépendent des membres de pbrasc précédés d'un article qui donnent à ce membre de phrase l'apparence d'un substantif. Cela se voit aussi en copte. L'auxiliaire -*>- sert avant tout à exprimer les rapports de temps. En égyptien il n'y a pas proprement de temps de verbe. 11 n'y a pas une forme du verbe qui distingue le présent, du passé ou du futur. Les temps s'expriment par des particules, des au- xiliaires, et très souvent par ce que nous appellerions des prépositions. «>- exprime le passé, quelquefois le passé historique simple, plus souvent ce que nous appellerions le passé antérieur ou le plus-que-parfait. C'est par ce dernier emploi que je commen- cerai. Dans un travail précédent (-) j'ai déjà exposé ce qui me paraît la seule traduction possible d'un passage du conte des deux frères'^'. Au moment oi!i le frère aîné, pour- suivant le cadet, se voit dans l'impossibilité de l'atteindre parce qu'une rivière avait surgi entre eux deux, il est dit que l'alné se frappe deux fois la main <—'^*=^ ^ J^^<— I3)S- '^^"^ avons là un de ces membres de phrase précédé de l'ar- ticle, qui est devenu un substantif. 11 est le régime du verbe -»>-; mais ce membre de phrase est négatif, aie non tuer luir , ttthe not killing himn qu'il avait fait, which he had doner, de ce qu'il ne l'avait pas tué. |2) ^^t un pronom relatif; et, je le f Voir Recueil, vol. XXVII et XXXI. ''' Recueil, vol. XXVII, p. 5o. <') Pap. d'Orb., pi. VI, 1.8. Recueil, t. XXXIX. — ïrobième série, t. Vil. 2 E. NAVILLE. [2] répète, celte traduction est la seule possible au point de vue grammatical, et la seule aussi qui donne un sens raisonnable. Je ne puis donc adopter les traductions fort semblables de mes deux savants confrères M. le professeur Wiedemann^'' et M. Maspero'-^ : rtder eine sclilug zweimal mit seiner Hand oline den andern todlen zu konnen. Das tat en), «le grand frère par deux fois lança sa main pour le frapper, mais il ne le tua pas, voilà ce qu'il fitn. Et d'abord que signifient ces mots rrdas tat em, rr voilà ce qu'il Ulr, qui interrompent la narration? Ils sont absolument inutiles, ils ne font que retarder le récit. On nous raconte les péripéties de cette fuite du cadet devant la colère de son aîné, puis, tout d'un coup, après que nous avons vu les elTorts vains de l'aîné pour atteindre son frère, on nous dirait : rr voilà ce qu'il fitn; pourquoi n'en dirait-on pas autant du cadet? Ces deux frères sont séparés par un lleuve, par conséquent l'aîné a beau frapper deux fois avec sa main (Wiedemann) ou lancer deux fois sa main pour frapper (Maspero), il est clair qu'il n'atteindra pas le cadet au travers du fleuve. Cette phrase serait une naïveté, une de ces vérités qui relèvent du bon sens; il est bien inutile de la mentionner, et encore plus de la faire ressortir par ces mots : rr voilà ce qu'il fitn. Nous avons là. un trait de mœurs, ou plutôt l'indication d'un geste de dépit qui est la manifestation d'un sentiment intérieur. C'est un exemple d'une action physique qui est motivée par un mouvement du cœur ou de l'esprit. Pour l'Egyptien , se frapper la main c'est un acte provoqué par la colère ou le désappointement. Dans nos langues modernes nous sommes tellement habitués à des expressions de ce genre que l'acte ])liysique disparaît, n'est qu'une figure, et ne représente plus qu'une idée morale. On pourrait en citer un grand nombre : applaudir, qui est proprement battre des mains, veut dire donner essor à sa joie ou à son approbation. On ne pense plus à l'acte physique, qui ne se produit pas. Nous disons d'un écrivain qu'il se bat les flancs pour trouver de quoi remplir les pages d'un chapitre ou d'un livre, et certes dans ce cas ce geste serait bien inutile, sans parler de ce qu'il ne se comprend guère. Quel- que chose m'est-il indifiérent, je dis que je n'en tourne pas la main, et la main n'est pour rien dans le sentiment que j'éprouve. Il est évident que dans les langues anciennes les expressions de celte nature de- vaient abonder, et môme encore plus que dans les nôtres, puisque l'absence de mots abstraits obligeait à recourir à quelque chose tombant sous les sens, à une figure ou à une métaphore. J'ai montré ailleurs'^) comment la méconnaissance de la figure ou de la métaphore devait fatalement nous égarer dans nos traductions. Nous rencontre- rions dans un texte ancien une expression de ce genre : il lui a lavé la tête, nous n'hésiterions pas à donner à ces mots un sens purement matériel, et nous n'irions pas '"' Allœguplischc Sur^cn uiid Mfivchcn, p. 8i. '"' Maspero, Les coiit"s populaires , li° éd., p. 9. ''' Journal des savants, 11' année, n° 5. [3] ÉTUDES GRAMMATICALES. 8 plus loin. C'est de là sans cloute que viennent ces traductions bizarres, ces phrases qui ne sont que des mots français ou allemands mis à la place de l'égyptien, sans qu'il en ressorte aucun sens. Les textes des pyramides ou du Livre dea Morts fourmil- lent de ces passages dont nous n'avons |)as l'intelligence, qui à première vue nous paraissent enfantins ou, comme disait Renouf, aoutrageous nonsenser. Mais je reviens à la phrase du papyrus d'Oibiney. J^:^^"^]^,^''— "le non tuer luiii est une expression verbale précédée de l'article ^ qui est. traitée comme un véritable substantif. Le copte nous en présente aussi des exemples; en voici un que je lire de la grammaire de M. SteindorfT (§ ^Sy) : nTTiK-\-xA\v tiAii ftder Umsland uns nicht durchzulassenn. Le substantif est suivi du relatif |^ que, on ne peut rien de plus régulier. Arrêté subitement dans sa poursuite, voyant que ses eiïorts ont été vains, le frère aîné courroucé fait un geste que nous pourrions faire à l'occasion : il se frappe la main, et la violence de son dépit est indicjuée parce qu'il le fait deux fois. Nous tra- duirions donc ainsi : "il se frappa la main deux fois, de ce que, ou parce qu'il ne l'avait pas tué-. On remarquera que le récit se suit ainsi parfaitement, et supprime ce s voilà ce qu'il fitn, qui était à la fois inutile et hors de place. Cette expression verbale devenant un substantif, et suivie du vcr])e -*>- pour indi- quer un passé antérieur, n'est pas rare. En voici un exemple tiré d un tombeau. L'ins- cription est de la 3*= année du roi HoremliebO. Après qu'il eut offert des pains à son père Amon ^=^S^^=[^ lorsqu'il fut sorti de la salle dorée, les acclamations et les louanges retentirent dans tout le pays. On remarquera que quoique l'infinitif S ait la forme - appelée généralement féminin, l'article ^ est masculin. C'est une erreur de considérer toujours le - comme le signe du féminin. Ainsi que le fait res- sortir M. GolénischefT'-', plusieurs mois ont une forme simple et une forme en -. Je crois que le nombre des mots dans ce cas est très considérable, mais je ne saurais y voir toujours une différence de genre. Nous avons ici ^ ^ et nous trouvons souvent Ce même emploi de l'article au masculin avec l'infinitif en - se voit dans l'exemple suivant, qui est tiré aussi du papyrus d'Orbiney ' : 7J^^^^^ ^îv^T^lâl ^^>!^i^i—Aj^ J-^l p. Ici il y a deux auxiliaires : i^_i et •«>-. i—i est le causatif de ™^i «faire tuen^, et nous avons de nouveau ici l'expression verbale devenant un substantif Xlk^^i^i "^^ ^^^^^^ tucm ^^î? ^" '' '^^'^ ^"'^ """^ c^n ^^ '°'- Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'auxiliaire de temps -*>- est intercalé entre le causatif *"* et le verbe auquel il tient. L'idée du passé d'antériorité est clairement exprimée par la suite. )^^^ uploads/s3/ rt-39.pdf
Documents similaires


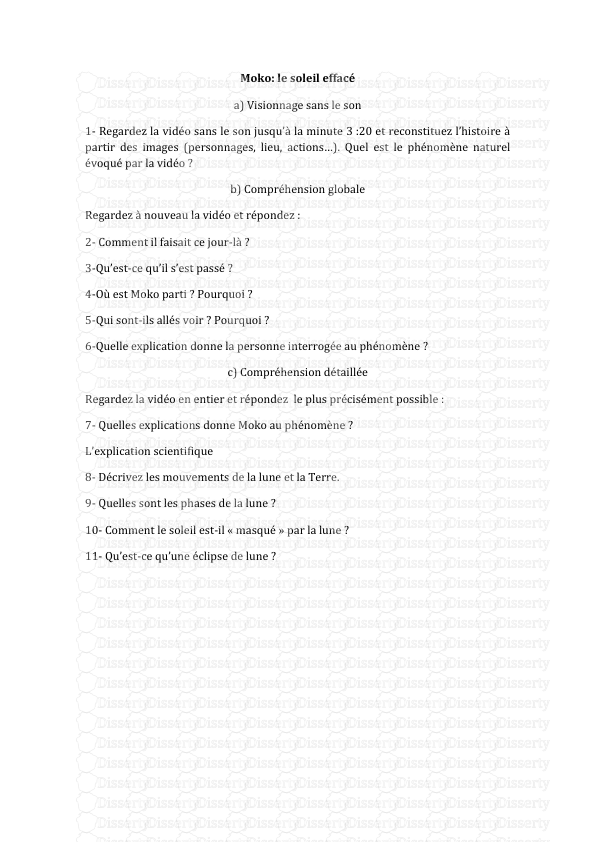







-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 02, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 6.1382MB


