L'INSTRUMENT DE LA VOLUPTÉ Une iconographie du luth Trecento I : Le luth de Dan
L'INSTRUMENT DE LA VOLUPTÉ Une iconographie du luth Trecento I : Le luth de Dante Résumé : Pour une des premières occurrences du leuto en italien, le corps du luth fait image. Il représente le ventre gonflé de maître Adam, le faux monnayeur de la Divine Comédie. De la cithare-poitrine au luth-ventre, Dante sollicite la métaphore complexe de la musique. Dans le chant XXX de l’Enfer, le luth est à la fois l’héritier et la parodie de la cithare des psaumes et de la lyre des Grecs. Abstract : The body of a lute is used as an image for one of the first occurrences of leuto in Italian. It shows the bloated paunch of Master Adam, the forger of the Divine Comedy. From his chest cithara to his belly lute, Dante derives the complex metaphor of Music. In the XXXth canto of the Inferno, the lute is both the heir and a parody of the cithara of the Psalms and the lyre of the Greeks. Plan : I. Adam le faussaire II. Le luth-ventre III. Dante et la musique IV. La musique de la Divine Comédie V. Leuto et chitarrino VI. La cithare-poitrine VII. Le luth héritier de la cithare VIII. Le luth parodie de la cithare IX. De la cithare-poitrine au luth-ventre. 1 Adam Mais chez qui du rêve se dore Tristement dort une mandore Au creux du néant musicien, Telle que vers quelque fenêtre Selon nul ventre que le sien Filial on aurait pu naître. Mallarmé Dans les années 1370, un illustrateur de l’Enfer de Dante (1265-1321) a représenté maître Adam, le faux-monnayeur du chant XXX, avec des chevilles dans le cou, pour accorder les cordes qui courent sur son torse en forme d’amande1. Il traduisait littéralement la terzina dans laquelle le poète voyait un homme qui, s’il n’avait pas de jambes, ressemblerait définitivement à un luth. Ainsi, pour une des premières et rares occurrences du terme leuto dans la littérature italienne, le corps du luth faisait image. Dante se servait donc de sa forme singulière pour rendre le gros ventre d’hydropique de maître Adam. Ce faisant, il convoquait tout un faisceau de correspondances entre le corps humain et l’instrument dans les champs de la médecine, de la musique et de l’allégorie sacrée. Ms XIII.C.4 f° 26v (1370-1375) ; Bibliothèque nationale de Naples On compte près de 500 manuscrits de la La Divine Comédie2. Ils sont souvent enluminés, et au moins 130 contiennent des scènes figuratives au début de chaque cantica. Les premières traductions françaises, au XVIe siècle, ont un peu de mal à rendre le texte de Dante3. Les hendécasyllabes de l’original sont rendus en 1596 par les alexandrins de Balthasar Grangier4 qui avertit qu’on ne trouvera pas dans sa traduction du poète « le plus difficile, obscur et concis » la « poésie délicate, mignarde, coulante & bien aysée comme elle est quasi de tous noz Poètes françoys » : Je vis un malheureux faict d’un Luth à la guise, Si la cuysse tranché il eust eu pour le moings, Du costé dont tout homme en fourche se divise, La griesve hydropisie aux membres de tous points Gardant disparité avec l’eau qui s’amasse Si bien que ne respond au grand ventre la face. Les lèvres luy faisoit ouvrir en ceste sorte Que l’hétique les tient qui de soif grandement Outré l’un au menton, & plus haut l’autre porte. O vous qui n’endurez supplice ny tourment, (Et je ne sçay pourquoy) en ce monde terrible, Il nous dict, regardez à la misère horrible Du pauvre Maistre Adam, comme je fuz en vye J’euz assez de ce bien que plus je désirois, Et or d’un gourgeon d’eau ma soif n’est assouvie. Les ruysseaux argentez qui des montz pleins de boys Du plaisant Cassentin bas en l’Arne descendent, En faisant leurs canaulx molz & froids, se respandent. … L’une est qui faulsement le bon Joseph accuse, L’autre est Sinon Grégeois qui trompe les Troyens, Et jettent pour leur fiebvre une chaleur profuse. Et l’un de ces deux là qui s’enfle de desdains Pour s’estre veu notté d’une trayson infame Avec le poing le ventre endurcy luy entame, Qui sonna tout ainsi qu’un tambour dont l’on jouë Et maistre Adam colère au visage le bat De son bras qui moings dur ne parut sur sa jouë, En luy disant encor que je n’aille à l’esbaz Pour mes membres qui sont lourds en telle besongne, J’ay le bras assez bon pour n’endurer vergongne. L’autre dict, Quand au feu tu courais misérable, Il n’estoit ainsi prompt, mais il fut bien plus prompt Quand tu frappois au coing ta monnaye damnable. En cecy tu dis vray, l’hydropicque respond Mais si vray tu ne fuz à porter tesmoignage Lors qu’à Troye tu tiens d’un thraistre le langage. Dans la dixième fosse du huitième cercle, sont réunis les faussaires, les imposteurs, les parjures, les séducteurs, les devins, les hypocrites ou les faux témoins. Comme pour les alchimistes (qui veulent transmuter le plomb en or), l’épisode d’Adam s’ouvre avec le visionnaire « J’ai vu » de l’Apocalypse. Le faux-monnayeur cherche d’abord à inspirer la pitié aux deux voyageurs5, en prenant les accents de Jérémie6 ou de Job (avec sa triste cithare …). Il se plaint mais il ne se repent pas et reporte sa faute sur les comtes de Romena, au service desquels il avait commis son forfait. Puis une rixe avec le perfide Sinon, le traître qui a fait entrer le cheval dans Troie, donne lieu à une comique scène d’invectives. Le personnage de Maître Adam est la combinaison d’une allégorie complexe du péché avec un personnage historique. En 1277, « magister Adam de Anglia » est cité comme familier des comtes Guidi7. Il est brûlé vif en 12818 par la seigneurie de Florence pour avoir contrefait des florins, en remplaçant trois des vingt-quatre carats d’or pur par un métal sans valeur. Dante, avait lui-même été condamné au bûcher pour concussion, à Florence en 1302. C’est dans son exil qu’il écrivit La Divine Comédie dont la première partie, l’Enfer, est rédigée entre 1306 et 1314. Dans la tenzone qui oppose Dante et Forese Donati (1250- 1296), le père du poète, Alighiero Bellincione, est encore accusé d’être un usurier9. Proche des thèses franciscaines, Dante ne pouvait rester indifférent à la question de la pauvreté (de l’homme de foi, de l’Eglise) ; l’épisode antithétique d’Adam constitue comme un miroir aux débats qui secouent alors la Chrétienté. 2 Le luth-ventre L’image du ventre du luth n’est pas isolée dans l’épisode. Quelques tercets avant la vision de maître Adam, Dante a déjà utilisé le vocabulaire du corps de l’homme et de l’instrument (avec son manche et sa caisse) lors de l’épisode où Capocchio est mordu par Gianni Schicchi au collo et où son ventre gratte le sol dur10. Ce corps, rongé par la lèpre est comme un alambic mal luté dans lequel le magicien cherche à transmuter le plomb en or. Plus généralement, Dante compare son périple dans l’Enfer à un voyage dans le corps humain11. Il se trouve effectivement dans le ventre de l’enfer. À l’intérieur de cette dixième fosse, les damnés ne sont pas torturés par des diables ou des centaures : c’est la seule fosse où ils sont tourmentés par leur propre corps. Le compagnon d’infortune d’Adam, Sinon, a permis au cheval de Troie (un autre ventre) de rentrer dans le ventre de Troie, pour sa ruine. Virgile, le guide de Dante, raconte dans l’Énéide que Lacoon jette sa lance dans le ventre de la bête de bois : « Elle s'y fiche en vibrant, les flancs du cheval en sont ébranlés, tandis que résonnent et gémissent ses profondes cavernes12 ». Et quand Sinon frappe le gros ventre de maître Adam, il résonne non comme un luth, mais comme un tambour. Quand les chants de la Comédie sont illustrés, c’est généralement la scène qui illustre le chant XXX13. De ce ventre gonflé, s’échappent des ventosités et des miasmes14, signes de décomposition. De même, quand Dante se laisse séduire par le chant de la sirène, Virgile découvre le ventre de celle-ci plein de puanteur15. Dante, enregistré en 1297 dans la guilde des apothicaires et des docteurs (qui était aussi celle des libraires et des poètes), montre dans cet épisode qu’il connaissait parfaitement le vocabulaire médical. Un de ses commentateurs (1335-1340), Guido de Pise, distingue quatre sortes d’hydropisie16. On appelle la première, dit-il, « flegmatique » ; c’est le gonflement de tout le corps, qui cède sous la pression des doigts. Il fait le rapprochement avec le luth autour d’une variante arcadienne leuton (λευτον) qui se rapproche de l’usuel leukos, blanc. Le flegme blanc (flegma leukon) caractérise donc cette subdivision de l’hydropisie. On se souvient que les Arabes associaient à chacune des quatre cordes du luth, une humeur (les deux biles, sang, flegme), une qualité (humide, sec, chaud, froid) et une couleur (rouge, jaune, noir, blanc). La quatrième espèce de la maladie décrite par Guido s’appelle, encore aujourd’hui, la tympanite car, quand le ventre est frappé, il uploads/s3/ trecento-i-le-luth-de-dante 1 .pdf
Documents similaires

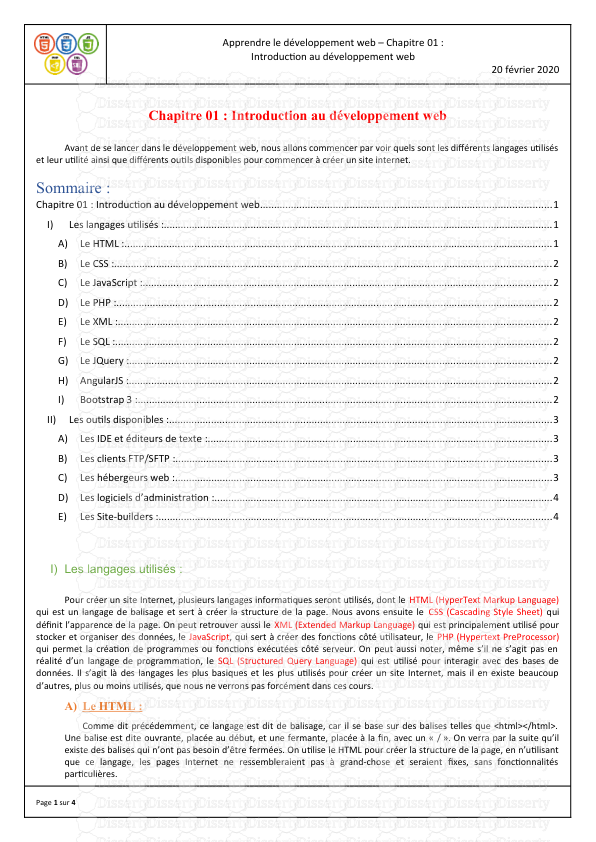








-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 26, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 8.4923MB


