Histoire de la notion de fréquence sonore Apparition du concept et développemen
Histoire de la notion de fréquence sonore Apparition du concept et développement des procédés de mesure Alain Boudet Dr en Sciences Physiques www.spirit-science.fr 31 aout 2017 Résumé: Ce n'est qu'au 17e siècle qu'on a compris le lien direct entre la hauteur d'un son et la vitesse de sa vibration (sa fréquence). Mais on était alors dans l'incapacité d'évaluer cette fréquence. Il a fallu le développement progressif, à partir du 19e siècle, de moyens techniques de mesure issus de recherches scientifiques - gravure et visualisation des vibrations - pour aboutir à la situation actuelle où la l'expression de la hauteur d'un son par sa fréquence en hertz nous est devenue familière et banale. • Fréquence de vibration d'un son • Objets sonores vibrants • Sensation de hauteur • Compter le nombre de vibrations • Recherches en acoustique • Rendre visibles les vibrations • Graver les vibrations • L'affichage électrique des vibrations sonores • Popularisation de la mesure des fréquences sonores • Annexe • Du mouvement, de la tension, de la force de la pesanteur, & des autres proprietez des chordes Harmoniques, & des autres corps • En savoir plus Il nous semble aujourd'hui banal de parler de la fréquence d'un son. Or c'est là une notion relativement récente. Nous savons aussi que la valeur de cette fréquence est en lien direct avec la sensation de hauteur du son, mais ce lien n'est apparu que peu à peu au cours de l'histoire. La nature des ondes sonores et leur composition en fréquences ont été découvertes au fur et à mesure des recherches scientifiques. La détermination de leurs caractéristiques a fait un bond spectaculaire avec l'invention des appareils électroniques, allant jusqu'aux ordinateurs et aux smartphones disponibles pour tous. Dans cet article, j'expose comment la notion de fréquence des sons est venue à la conscience des savants et comment en pratique les scientifiques ont inventé des procédés de plus en plus perfectionnés pour la mesurer. Fréquence de vibration d'un son Le mot fréquence lui-même existe depuis longtemps et prend un sens en-dehors du champ sonore. Par exemple, nous pouvons dire: La fréquence de parution du journal France-Spiritualité est de 4 fois par an. Le mot fréquence exprime la régularité de l'occurrence d'un événement dans le temps. La fréquence s'exprime donc en nombre de fois par unité de temps (seconde, heure, semaine, mois, année, etc.). Autre exemple: La fréquence moyenne des battements d'un cœur humain au repos est de 60 à 70 à la minute. Lorsque l'événement est un mouvement répétitif, cyclique, comme le battement du cœur, on peut aussi exprimer la fréquence en périodes/seconde ou cycles/seconde. Si je vois osciller le balancier d'une vieille horloge toutes les secondes imperturbablement, je peux dire qu'il oscille à une fréquence de 1 fois par seconde ou de 1 cycle/seconde. En 1930, la Commission Électrotechnique Internationale (IEC) a proposé de remplacer la terminologie de cycles/seconde par le mot hertz noté Hz. Il a été adopté en 1960 par la Conférence générale des poids et mesures. 1 Hz désigne donc une fréquence de 1 événement ou 1 cycle par seconde. Un kilohertz (kHz) correspond à 1000 vibrations par seconde et un mégahertz (MHz) à 1 million de vibrations par seconde. Le nom a été choisi en l'honneur du physicien allemand Heinrich-Rudolf Hertz (1857 - 1894) pour ses travaux sur l'électromagnétisme (voir article Concepts fondamentaux de la physique). Objets sonores vibrants Déjà dans l'antiquité grecque, on savait que le son est produit par un objet qui vibre (membrane, lamelle de bois, objet métallique, corde tendue...). Mais pour parler de la fréquence d'un son, il fallait se rendre compte que la vibration est un mouvement répétitif qui se produit régulièrement plusieurs fois par seconde. Lorsque nous regardons une corde de guitare pendant son émission sonore, elle vibre tellement vite qu'on ne voit qu'un fuseau. Il faut la filmer et passer ensuite le film au ralenti pour s'apercevoir de son mouvement d'aller et retour. De même les membranes des haut-parleurs vibrent très vite lorsqu'elles émettent des sons (voir articles Physique et perception du son et Son: Hauteur et fréquence). La fréquence de vibration est le nombre d'allers et retours que la membrane ou la corde effectuent par seconde. Sensation de hauteur Il fallait de plus comprendre que la sensation de hauteur d'un son est liée à la vitesse de sa vibration. Reprenons l'exemple de notre haut-parleur: lorsque le son émis est grave, les vibrations de la membrane sont lentes (fréquence faible). Elles deviennent plus rapides (fréquence élevée) lorsque le son monte dans les aigus (voir article Son: hauteur et fréquence). Au 16e siècle, pour expliquer la sensation de l'oreille, on imaginait que le son venait frapper le tympan par une série de coups très rapides, mais on ne faisait pas de lien avec la hauteur. Le rapport entre la sensation de hauteur d'un son et la vitesse de vibration du corps sonore qui le produit ne sera véritablement établi qu'au 17e siècle. Ce lien avait pourtant été proposé par le philosophe grec Platon (vers 428 – vers 374 av.J.C.) dans son ouvrage le Timée: Nous pouvons définir le son comme un coup donné par l’air à travers les oreilles au cerveau et au sang et arrivant jusqu’à l’âme. Le mouvement qui s’ensuit, lequel commence à la tête et se termine dans la région du foie, est l’ouïe. Ce mouvement est-il rapide, le son est aigu; s’il est plus lent, le son est plus grave; s’il est uniforme, le son est égal et doux, il est rude dans le cas contraire; il est fort grand, lorsque le mouvement est grand, et faible s’il est petit. Compter le nombre de vibrations Pour déterminer les valeurs de ces fréquences, il fallait compter le nombre des vibrations qui se produisent en une seconde. Combien de fois par seconde une corde de violon vibre-t-elle lorsqu'elle produit le son UT? La vibration est tellement rapide qu'il est quasiment impossible de la distinguer à l'œil nu. Pourtant le père Marin Mersenne (1588 - 1648), philosophe et savant français, y réussit en faisant preuve d'astuce. C'est l'un des premiers de notre période moderne à se pencher sur la question de la mesure des fréquences. Ses expérimentations sont exposées dans son Harmonie Universelle (1637) (voir en annexe). Il choisit une corde lâche et suffisamment longue pour qu'elle vibre lentement et qu'il puisse en voir les "tours et retours". Il comprend que la hauteur des sons de la corde est liée au nombre de ces tours et retours. Puis il extrapole ses résultats à des cordes tendues et courtes. La méthode est ingénieuse et novatrice, mais elle reste très imprécise, car il est bien difficile d'estimer ce nombre à l'œil nu. À la même époque, en Italie, le célèbre astronome et physicien Galilée (1564 - 1642) étudie aussi le phénomène sonore, par analogie avec ses études sur le mouvement pendulaire. Il avait constaté que plus le pendule était long, plus la durée d'une oscillation augmentait (proportionnellement à la racine carrée de sa longueur). Il en serait donc de même des vibrations des cordes. Galilée publie ses études sur le son en 1638, dans une dizaine de pages de ses Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles touchant la mécanique et les mouvements locaux. Observant les vaguelettes qui se forment autour d'un verre aux parois minces plongé dans l'eau lorsqu'il est mis en vibration sonore, il constate que si le ton du verre venait à monter d’une octave, [il voit] aussitôt chacune de ces ondes se diviser en deux: phénomène qui prouve clairement que le rapport de un à deux est bien la forme propre de l’octave. (cité par François Baskevitch, L’élaboration de la notion de vibration sonore: Galilée dans les Discorsi) Recherches en acoustique La période est scientifiquement féconde. Les savants font des émules et les expériences se multiplient. La contribution du physicien français Joseph Sauveur (1653 - 1716) dans le domaine de l'acoustique musicale est fondamentale. En 1700, il tire parti des battements d'intensité sonore qui se produisent lorsque deux notes de hauteur très proches sont produites simultanément pour déterminer la fréquence de certains sons musicaux. Sauveur trouva que la fréquence du LA de son clavecin était de 404 vibrations par seconde. Le physicien allemand Ernst Chladni (1756 - 1827) mit en évidence les vibrations de plaques métalliques lorsqu'elles sont excitées par un archet et émettent un son. Il les saupoudrait de sable qui se rassemble en lignes dessinant des figures. Elles donnent des indications précieuses sur les caractéristiques des vibrations sonores (voir de nombreux détails dans l'article Les sons créateurs de formes). Chladni étudia aussi la vibration des cloches et rédigea un traité d'acoustique. À la même époque, le physicien français Félix Savart (1791 - 1841) inventa un sonomètre et une roue appelée la roue de Savart, constituée d'un disque métallique muni sur sa circonférence de dents régulièrement espacées. Lorsqu'on place une lame souple contre les dents, le frottement produit un son qui s'élève d'autant plus qu'on tourne le disque plus vite (sa fréquence est proportionnelle au nombre de uploads/s3/ histoire-de-la-notion-de-frequence-sonore 1 .pdf
Documents similaires


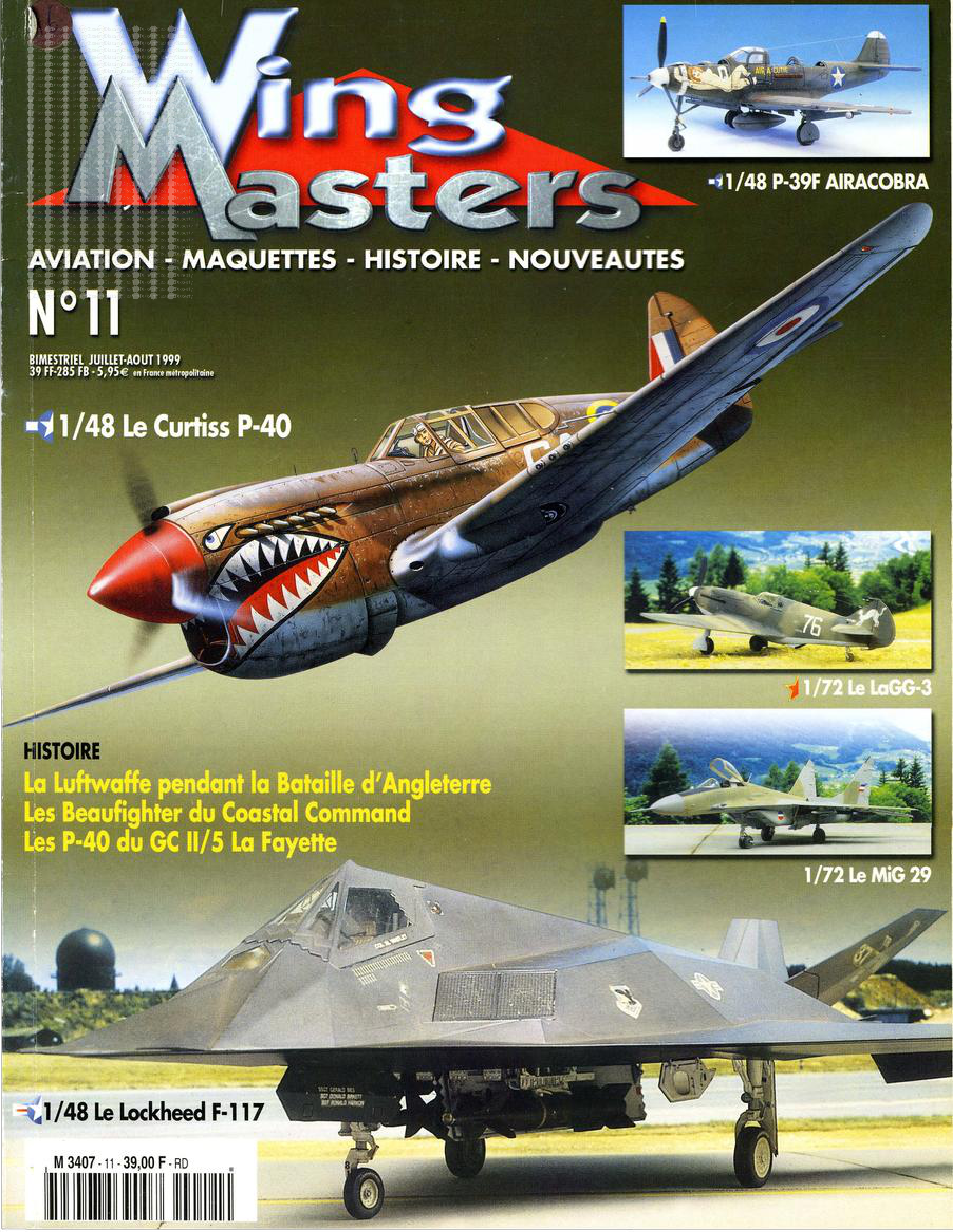

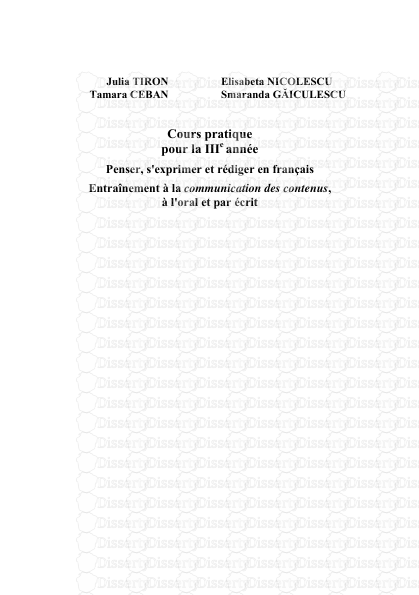





-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 12, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7363MB


