L'expressivité Author(s): Raymond Ruyer Source: Revue de Métaphysique et de Mor
L'expressivité Author(s): Raymond Ruyer Source: Revue de Métaphysique et de Morale, 60e Année, No. 1/2 (Janvier-Juin 1955), pp. 69- 100 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40899897 . Accessed: 16/07/2011 16:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at . http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=puf. . Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue de Métaphysique et de Morale. http://www.jstor.org L'expressivité L'effort pour comprendre va souvent de l'expressivité à la signification. Définissons provisoirement l'expressivité des choses : « Ce qu'elles ont l'air de vouloir dire, » La grâce attirante d'une fleur, les nuages qui se hâtent, un ciel menaçant d'orage, un arbre qui s'agite dans le vent, une file d'oiseaux qui s'étire dans le ciel, les hurlements d'un animal solitaire - ces manifestations sont expressives parce qu'elles ont l'air de vouloir dire quelque chose ; elles appellent nos questions parce qu'elles ont l'air elles-mêmes de réponses balbutiantes à des questions imprécises. Com- ment mettre au point, rendre claires ces manifestations confuses ? En les faisant passer, il semble, de l'expressivité à la signification. On est satisfait quand on sait, non plus seulement « ce qu'elles ont l'air de vou- loir dire », mais « ce qu'elles disent, ou ce qu'elles signifient réellement ». L'animal appelle sa femelle, les oiseaux sont en migration, la fleur attire l'insecte qui servira à la fécondation, l'électricité atmosphérique se décharge, le vent pousse les nuages et agite les arbres parce qu'il y a une dépression barométrique centrée sur les Açores. Dans un poème connu de Henri Heine S le jeune homme au bord *de la mer se tord les mains 4ans son désir violent de résoudre « la douloureuse et vieille énigme ». Mais « les vagues continuent leur éternel murmure, les nuages continuent à fuir dans le vent, les étoiles scintillent froides et indifférentes... et un fou attend une réponse ». Le jeune homme de Heine peut passer pour fou, non parce que ces questions sont folles - la nature visible a justement l'air de les poser elle-même - mais parce que la nature est bien décidée à ne pas répondre, <et que la sagesse conseille de ne pas s'obstiner à faire parler un muet. Si le héros de Heine était un peintre, et avait pris ses pinceaux pour représenter telle quelle l'expressivité des choses, personne ne l'accuserait de folie. Mais pour le spéculatif dévoré de curiosité devant l'énigme, ce serait là, il semble, une renonciation à comprendre, et le refuge dans l'art ne serait qu'une démission de l'esprit. La philosophie 1. Fragen, Die Nordsee. 69 Raymond Ruyer par définition, semble- 1 -il, ne doit pas, elle, renoncer à transformer les expressivités en significations. Elle doit imaginer les paroles que pro- noncerait le muet s'il consentait à parler. La philosophie, ou, du moins, la philosophie théorétique, postule que la signification est plus fondamen- tale ; elle postule que l'expressivité n'est qu'une signification sourde, confuse, mal mise au point. Sur ce postulat de la priorité do la signification, on peut avoir les doutes les plus graves. Cependant, avant de passer à l'exposé de ces doutes, il est bon de plaider un peu le faux pour savoir le vrai, et d'examiner ce qui donne de la force au postulat en question. On doit reconnaître que, souvent, l'expressivité n'est, en effet, que l'apparence d'une signification imparfaite. On trouve, par exemple, « un drôle d'air » à quelqu'un, tout simplement faute d'avoir bien compris ce que son attitude « voulait dire ». On pressent qu'il y a quelque chose à comprendre, mais sans savoir au juste quoi. L'enfance est l'âge de ces impressions à la fois vagues et frap- pantes, parce qu'elle est l'âge des demi-compréhensions. Les hiéroglyphes étaient beaucoup plus expressifs avant Champollion. On soupçonnait d'insondables mystères là où l'égyptologue lit aujourd'hui : « J'ai con- solidé l'ordre sur les deux rives du Nil. J'ai maintenu le fils dans le poste de son père. » Un aphasique, qui a perdu, selon l'expression de Golds- tein, P « attitude catégorielle », redevient aussitôt plus sensible à l'aspect expressif des choses. Un malade de Gelb appelait le B, « lampe à gaz », le M, « bonnet de carnaval » et le S, « araignée », parce que ces lettres, écrites par le médecin d'une façon d'ailleurs parfaitement lisible, dif- féraient un peu des lettres du malade. Une tâche, un souvenir à demi- oublié, qui ne laisse plus dans la conscience claire que son « aura », nous rend très perméable aux aspects qualitatifs de la situation. Nous éprou- vons « l'expérience contraignante d'une spécificité qualitative, vidée de son contenu représentatif » *. La signification est « épicritique », tandis que l'expressivité semble « protopathique », c'est-à-dire plus primitive, plus fruste, de niveau inférieur, liée au diencéphale, alors que la signifi- cation est liée au cortex cérébral. L'expressif paraît « psychique », tandis que le signifiant est « spirituel ». Il paraît suboonscient, tandis que le signifiant est conscience lucide. 11 paraît un état fascinant, intéressant, mais dont on aspire vite à se délivrer, tandis que la signification délivre, apporte une sorte de salut religieux à une âme prisonnière. L'esprit aspire à un dieu Logos. Un dieu Expressivité a quelque chose d'opaque, d'in- quiétant. Il paraît peu discernable d'une force naturelle déifiée. Il ne paraît pouvoir opérer aucun salut dans la pure lumière. Tout cela est vrai. Mais que peut-on conclure ? Une signification con- fuse ressemble incontestablement à une expressivité ;-mais cela ne prouve pas que l'expressivité ne soit qu'une signification confuse et mutilée. 1. F. Ellenberger, Le mystère de la mémoire, p. 120. 70 L'expressivité Normalement, l'expressivité est primaire, ou, du moins, distincte. La grâce absolument spécifique d'une rose, d'un bouleau, d'une phrase musi- cale, peut, lorsque nous sommes fatigués et sur le bord de la paramnésie, nous faire l'effet d'un souvenir larvaire, d'un mot à demi-oublié. Mais, raisonnablement, nous sommes bien sûrs qu'il n'y a pas de « mot » à trouver. On peut se servir ici d'un mythe comme critère parfaitement valable. Imaginons l'arrivée au Paradis catholique d'un Élu. Il a déjà été jugé, et il sait qu'il va être aimablement reçu par Dieu le Père en personne, après avoir été sur terre un homme à la fois sensible et curieux. Enfin, se dit F Élu, je vais tout comprendre, et le Mot de toutes choses va m' être donné. Mais à peine en présence de Dieu le Père, i'Élu apprend que la sensibilité ne peut être satisfaite de la môme façon que la curiosité. Dieu peut bien, pour l'intéresser, révéler d'avance à Archimède, dès son arri- vée dans l'autre monde, le système de numération do position. Il peut révéler à Newton, l'interprétation géométrique de l'attraction univer- selle. Il peut expliquer à Claude Bernard à quoi servent exactement les capsules surrénales. Il peut taquiner avec indulgence Marcelin Berthe- lot, non pour son anticléricalisme, mais pour avoir retardé, en France, le succès de la théorie atomique ; il peut lui montrer par anticipation quelque chose comme les photographies par réseaux cristallins, de Laue et Debye. Mais comment pourrait-il révéler à Marcel Proust ce qui se cachait derrière la « petite phrase » de la sonate de Vinteuil ? Comment pourrait-il lui « expliquer » les trois clochers qui semblaient jouer à cache- cache sur la route de Meséglise ? Il peut expliquer à un botaniste du xne siècle à quelle famille appartient la rose. Mais comment pourrait-il expliquer à un poète ce qu'exprime la rose ? Comment pourrait-il four- nir la signification des véritables expressivités, sinon en les faisant passer de l'expressivité à la signification, c'est-à-dire en les détruisant ? Il ne pourrait montrer à Beethoven les « grands êtres » que celui-ci soupçon- nait derrière ses thèmes les plus expressifs - sinon en lui permettant de créer des thèmes plus expressifs encore. Dieu pourrait révéler à saint Bonaventure s'il avait tort ou raison de croire que la feuille de trèfle sym- bolise la Trinité. Mais il ne pourrait révéler à Albert Dürer ce que celui-ci exprimait au juste en dessinant avec amour ses feuilles d'herbe. Dieu p« ut uploads/s3/ raymond-ruyer-l-x27-expressivite.pdf
Documents similaires








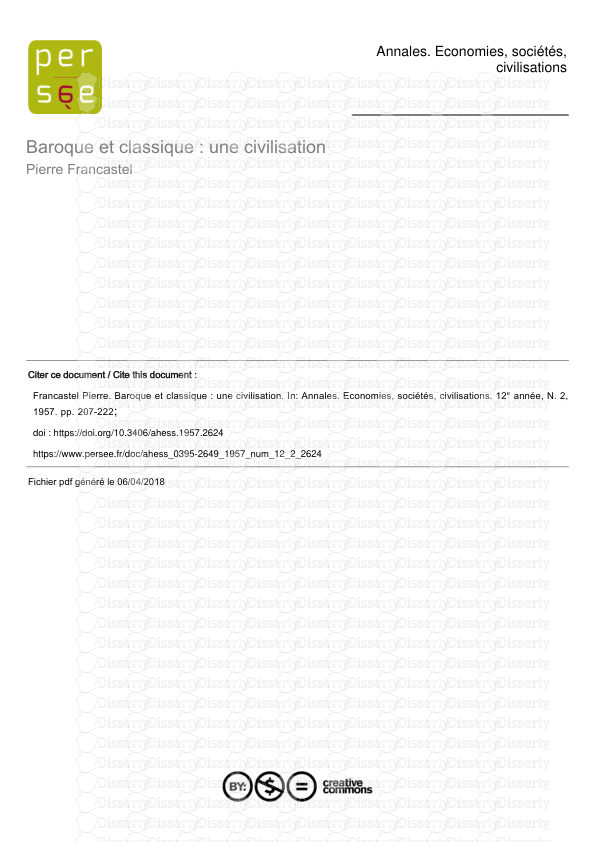

-
111
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 29, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.6478MB


