Chopin à Paris l’atelier du compositeur Cité de la musique - Paris | du 9 mars
Chopin à Paris l’atelier du compositeur Cité de la musique - Paris | du 9 mars au 6 juin 2010 Exposition et concerts Exposition du 9 mars au 6 juin 2010 Organisée par la Cité de la musique et la Bibliothèque nationale de France, à la Cité de la musique. Dans le cadre de l’Année Chopin 2010 et avec le soutien de l’Institut Polonais de Paris. Sommaire Introduction à l’exposition / Cité de la musique -------------------------------------------------p. 1 Introduction à l’exposition / Bibliothèque Nationale de France ---------------p. 2 Présentation de l’exposition ----------------------------------------------------------------------------------------------p. 3 Parcours de l’exposition -------------------------------------------------------------------------------------------------------p. 4 Liste des œuvres exposées ----------------------------------------------------------------------------------------------p. 16 Pour visiter l’exposition -----------------------------------------------------------------------------------------------------p. 21 Concerts à la Cité de la musique --------------------------------------------------------------------------------p. 22 Concerts à la Salle Pleyel --------------------------------------------------------------------------------------------------p. 23 1 L’exposition « Chopin à Paris, l’atelier du compositeur », présentée par le Musée de la musique et la Bibliothèque nationale de France à la Cité de la musique à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de ce compositeur, s’inscrit dans le cadre de l’Année Chopin 2010. Elle compte parmi les événements phares de cette célébration et met en avant ce compositeur exceptionnel qui personnifia aux yeux de ses pairs le génie même, ce poète qui « descend du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe » (H. Heine). L’exposition permet de situer la venue et l’installation de Chopin à Paris au cœur des cercles artistiques de l’époque, de comprendre son attachement indéfectible au piano, faisant ainsi « parler à un seul instrument la langue de l’infini » (G. Sand), et de pénétrer au cœur de l’atelier du compositeur, là où l’œuvre se crée. Si deux établissements publics collaborent autour de ce projet ambitieux, c’est avant tout parce que la Bibliothèque nationale de France et le Musée de la musique possèdent dans leurs collections de précieux témoignages de cette effervescence : manuscrits, correspondances, estampes et premières éditions des œuvres, instruments et objets relatifs à la facture constituent dès lors la part majeure de cette exposition. Des apports extérieurs la complètent, et notre reconnaissance va aux prêteurs privés et aux collections publiques – la Bibliothèque Polonaise de Paris, le musée Carnavalet, l’Institut national de la propriété industrielle, le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, le musée du Louvre, l’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, la Bibliothèque de l’Institut de France et la Royal Academy of Music de Londres – qui ont accepté de participer à ce nouveau regard sur le compositeur. Outre ces prêteurs, nos plus vifs remerciements vont à Jean-Jacques Eigeldinger, éminent spécialiste de Chopin, commissaire et initiateur du projet, ainsi qu’à Cécile Reynaud et Thierry Maniguet, co-commissaires de l’exposition. Leurs connaissance et leur enthousiasme ont permis de construire ce parcours original à travers l’œuvre d’un artiste unique. Nous remercions aussi chaleureusement Catherine Massip, directeur du département de la Musique à la Bibliothèque nationale de France, le département audiovisuel de la BNF, ainsi que l’ensemble des équipes des deux institutions organisatrices du projet. La célébration du bicentenaire de la naissance de Chopin inclut également de nombreux concerts donnés à la Cité de la musique (sur instruments d’époque) et à la Salle Pleyel, qui témoignent de la vitalité de l’interprétation de ce grand compositeur. Enfin, nous sommes particulièrement heureux d’annoncer qu’une « version légère » de l’exposition, sous forme numérique, sera présentée dans une dizaine de pays de par le monde, grâce au soutien des instituts culturels français à l’étranger, ainsi que dans le réseau des médiathèques de France. Ce projet pilote sera suivi à l’avenir d’autres projets itinérants, visant ainsi à accroître le rayonnement de nos activités. Éric de Visscher Directeur du Musée de la musique cité de la musique 2010, année du bicentenaire de la naissance de Chopin, année de célébration par excellence, offre l’occasion de mesurer combien la personnalité de Chopin domine l’histoire culturelle européenne. Par sa double ascendance polonaise et française, d’abord, par la diffusion de son œuvre qui fut immédiatement projetée dans l’espace européen, ensuite. Une exposition comme celle-ci, réalisée grâce à l’étroite collaboration entre le Musée de la musique et la Bibliothèque nationale de France, permet de créer un lien immédiat entre l’écriture, l’image et les sonorités qui composent l’univers d’un compositeur. Rappeler qu’il fut de son vivant tout à la fois adulé mais aussi l’emblème de controverses parfois vives, c’est aussi annoncer comment l’image du créateur fut modelée par ses contemporains et les générations suivantes, de Schumann – « Chapeau bas Messieurs, un génie ! » – à Debussy-Monsieur Croche – « La musique de Chopin est une des plus belles qu’on ait jamais écrites » (1915). Montrer les manuscrits de Chopin, c’est aussi rappeler les racines de son art, la rigueur de Bach, l’élégance du bel canto, son rapport complexe aux sonorités musicales, sonorités inventées dans l’élan de l’improvisation, sonorités recherchées dans les innovations de la facture du piano, enfin sonorités écrites puis transmises. Écouter Chopin, c’est aussi rencontrer les plus belles pages de l’histoire de l’interprétation, entre transmission, filiation revendiquée et recréation. Voir les images de Chopin ou de son œuvre dans quelques exemples de la production cinématographique, c’est aussi mesurer qu’il fut et reste le héros d’une histoire romanesque qui touche encore. La popularité universelle de Chopin, dans laquelle il faut d’abord voir la reconnaissance spontanée de son génie, est peut-être aussi le fruit de cette alliance entre l’esprit et le cœur et de cet accord inégalé entre une extrême sensibilité et son expression dans l’instrument le plus riche et le plus immédiat, le piano. Catherine Massip Directeur du département de la Musique Bibliothèque nationale de France 2 BiBliothèque NatioNale de fraNce chopiN à paris, l’atelier du compositeur préseNtatioN de l’expositioN Frédéric Chopin est né en Pologne en 1810 d’un père français et d’une mère polonaise. Enfant prodige, il joue régulièrement pour le grand-duc Constantin, vice-roi de Pologne et frère du tsar Nicolas Ier. Point d’orgue des années d’apprentissage à Varsovie, les concerts que donne le célèbre violoniste Paganini en mai 1829 confirment chez Chopin le désir de ne dédier son art qu’à un seul instrument : le piano. Célébré dans son pays, il quitte la Pologne en novembre 1830 pour parfaire son éducation musicale et amorcer une tournée européenne. Chopin se rend à Vienne où il apprend le soulèvement de Varsovie contre le pouvoir russe. Suivant les conseils de ses proches, il renonce à se joindre au combat. Alors qu’il fait le projet de se rendre à Londres pendant l’été 1831, c’est finalement à Paris, la ville même de l’effervescence musicale, qu’il s’établit en octobre. Il y demeurera jusqu’à sa disparition en octobre 1849, sans être jamais retourné en Pologne. Dans la capitale française, Chopin s’impose rapidement comme un artiste d’exception : Berlioz le décrit comme « un talent d’une toute autre nature » que Liszt, lequel dira qu’il fallait rechercher en lui « l’essence de la virtuosité ». Cependant, même célèbre et adulé, Chopin préfèrera toujours les salons et réunions intimes à la lumière des salles de concerts parisiennes et internationales. C’est là qu’il apprécie la compagnie de ses amis proches, émigrés polonais ou artistes romantiques. Son œuvre, imprégnée des souvenirs d’une enfance polonaise, transcende les genres romantiques et constitue un sommet de la littérature pianistique. Présentée sur 450 m², l’exposition convie à l’exploration de cet univers artistique selon un parcours en trois parties (« Pianopolis » ; « Les cercles artistiques et amicaux » ; « L’atelier de Chopin ») où s’entremêlent de nombreux manuscrits, éditions rares, tableaux, dessins et instruments. La visite se poursuit © BNF, BMO Frideryk Chopin 1849 mort à Paris, Teofil Kwiatkowski - 1849 3 « Galerie de la Gazette musicale. N° 2. Pianistes célèbres », Nicolas-Eustache Maurin - 1842 © BNF, Estampes Buste de Camille Pleyel, Jean-Pierre Dantan, dit Dantan jeune - 1856 © Musée de la musique / Jean-Marc Anglès dans le « Salon d’écoute », espace dans lequel le public peut entendre de larges extraits musicaux et assister à des concerts donnés tous les samedis sur le piano à queue Broadwood que Chopin a utilisé en 1848 lors de sa tournée britannique. Le parcours s’achève par le « Salon de cinéma », où sont présentés des extraits de films autour de l’œuvre de Chopin, comme La Règle du jeu de Jean Renoir, Sonate d’automne d’Ingmar Bergman ou Le Pianiste de Roman Polanski. Un film documentaire spécialement conçu pour l’exposition évoque comment le contexte historique et l’environnement personnel influent sur l’œuvre du compositeur, tout particulièrement lors de son installation à Paris. Le parcours est jalonné d’enregistrements de grands interprètes de la musique de Chopin que les visiteurs écoutent à leur gré à l’aide d’un audioguide. Ce sont ainsi plus de cinquante plages musicales qui sont proposées à l’écoute. g parcours de l’expositioN i. Pianopolis En 1830, Paris est la capitale européenne des arts, la ville qu’il faut conquérir pour faire carrière. À l’instar de nombreux artistes européens, Chopin est attiré par cette cité du piano, Pianopolis, comme fut surnommée la capitale française. Si le goût pour le uploads/s3/chopin-a-paris-2010.pdf
Documents similaires
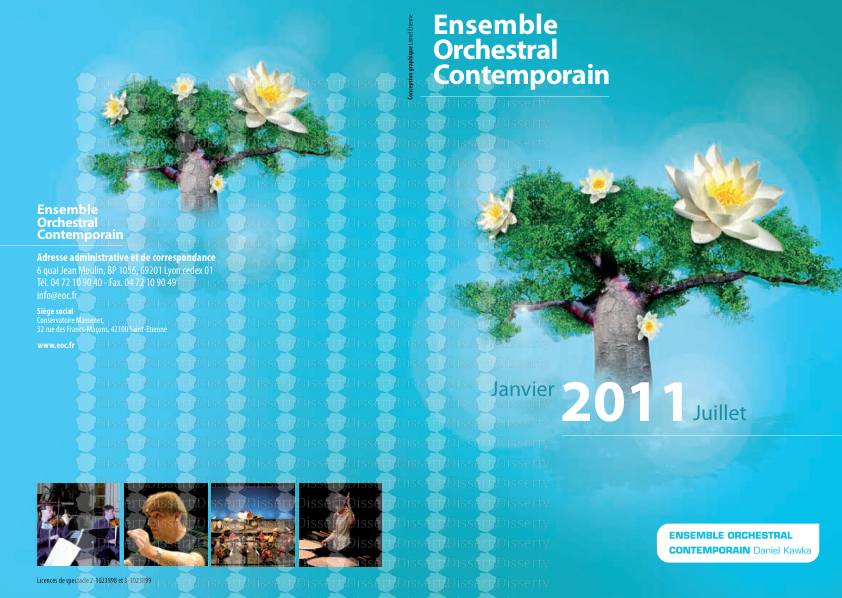









-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 16, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9676MB


