Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ? Date : octobre 2008 Mots clés : Amé
Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ? Date : octobre 2008 Mots clés : Aménagement du territoire – urbanisme – législation - CWATUP Auteur : Janine Kievits Fiche d’information théorique et pratique – Aménagement du territoire et urbanisme | n°5 Si l’appellation est connue de tous, ce qu’elle recouvre est souvent plus nébuleux. D’où l’intérêt de nous pencher sur le concept d’aménagement du territoire pour préciser ce qu’il recouvre, qui y fait quoi, comment et pourquoi. Fiche d’information en Aménagement du territoire | Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ? Fédération Inter-Environnement Wallonie, 150 associations au service de l’environnement page1 D ’entrée de jeu, le CWATUP nous brosse à grands traits un premier portrait de l’amé nagement du territoire wallon : en son arti cle 1, il fixe les grands objectifs de la matière et liste ses principaux outils. Ainsi formulé, l’article 1 §1 nous dit qui doit faire quoi, comment et pourquoi. Article 1 §1. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garantes de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. Qui... Les autorités publiques : la Région et les com munes, en coordination avec la Région. On se rap pellera que les Régions sont compétentes pour les matières liées au territoire, tandis que les Commu nautés sont compétentes pour les matières liées à la culture. Notons aussi que, dans un texte de loi, les autorités publiques rencontrent les besoins… signi fie en fait les autorités publiques doivent rencontrer les besoins… : en légistique (le langage des textes légaux), l’usage de l’indicatif présent signifie l’obli gation, non l’état de fait. Fait quoi... Ces autorités doivent rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environne mentaux de la collectivité, « de manière durable », c’est à dire sans compromettre les possibilités pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins. Pour rappel, la notion de développement durable est issue d’un rapport réalisé en 1987 par la Commission des Nations Unies pour l’Environne ment et le Développement, le rapport Bruntland ; elle a été popularisée par la Conférence de Rio en 1992, par laquelle le développement durable a été reconnu comme objectif par l’ensemble des nations. Elle recouvre les champs de l’économique et du social autant que celui de l’environnement. Comment... En gérant le cadre de vie afin d’en assurer la qualité, en usant de manière économe du sol et de ses res sources (c’est la « gestion parcimonieuse du sol »), en conservant et en développant le patrimoine régional. Pourquoi? Parce que le territoire régional est un patrimoine commun. Article 1 §2. L’aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de l’espace régio nal et du schéma de structure communal. Article 1 §3. L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont fixés par les plans et règlements suivants : 1° Les plans de secteur 2° Les plans communaux d’aménagement 3° Les règlements régionaux d’urbanisme 4° Les règlements communaux d’urbanisme. Ces paragraphes 2 et 3 du même article définissent les principaux outils de l’aménagement : l les schémas servent à inscrire, sous la forme de cartes et de textes, les intentions qu’ont les autorités publiques en matière d’aménagement ; ce sont des documents d’orientation, auxquels il n’est permis de déroger qu’à condition que l’autorité publique motive les raisons pour lesquels elle s’en écarte. l les plans sont des documents cartographiques qui ont une portée réglementaire : il est obligatoire de les respecter. l les règlements sont un ensemble de prescriptions écrites qui concernent principalement les bâtiments, mais aussi la voirie ou les espaces publics. Il est également obligatoire de les respecter. Depuis la rédaction de l’article 1, un nouveau document d’aménagement est apparu, le rapport urbanistique et environnemental. C’est un docu ment d’orientation, mais qui constitue d’une cer taine manière, nous y reviendrons, un schéma d’aménagement. Nous verrons dans les fiches suivantes ce que contiennent ces schémas, plans et règlements. Schémas, plans et règlements n’ont pas d’effets directs sur le terrain. Mais ils influencent profon dément le territoire et l’urbanisme de manière indi recte, dans la mesure où ils orientent et encadrent la délivrance des permis. Fiche d’information théorique et pratique – Aménagement du territoire et urbanisme page2 Fiche d’information en Aménagement du territoire | Qu’est-ce que l’aménagement du territoire ? Fédération Inter-Environnement Wallonie, 150 associations au service de l’environnement L’article 1 nous dit aussi que le territoire de la Région wallonne est un patrimoine de ses habitants ; il vaut la peine de s’arrêter à la signification de cette phrase. La notion de propriété a, dans l’histoire de nos lois, une importance considérable. Héritée du droit romain, elle a été remise à l’honneur dans le foulée de la révolution française ; l’un des grands acquis de celle-ci est en effet d’avoir donné à l’ensemble des citoyens le droit à la propriété. Ce droit est encore aujourd’hui fortement affirmé par notre code civil, qui le définit comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois. ».(article 544 du Code civil). L’attention portée dans nos sociétés à l’environnement, aux ressources naturelles et au cadre de vie, est venue non pas contrecarrer ce droit, mais plutôt le nuancer, en introduisant cette notion de patrimoine, qui a fait son apparition dans le CWATUP à l’occasion de la réforme de 1997, mais était déjà présente dans la législation française notamment. « Le code rural français fait par exemple référence au patrimoine biologique national, la loi sur l’eau française affirme que l’eau est le patrimoine commun de la nation, et le code de l’urbanisme affirme que le sol français est le patrimoine commun de la nation. Quand on regarde la doctrine française, on s’aperçoit que la proposition « le territoire français est le patrimoine commun de la nation » ne vise évidemment pas une appropriation, c’est plutôt une mission : la mission pour l’autorité publique de gérer ce patrimoine dans l’intérêt de la collectivité. La doctrine française nous dit que l’Etat apparaît comme chargé d’un droit de garde, comme un mandataire (…). Et la doctrine continue en disant que cette notion de patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage, légué par les générations qui nous ont précédées, et que nous devons transmettre intact, autant que faire se peut, aux générations qui nous suivront ; et que les espaces couverts par cette notion de patrimoine doivent ainsi faire l’objet d’une notion de protection renforcée » (J. Sambon, exposé au forum EGEP (A) ménager le territoire wallon du 23 novembre 1996). L’entrée au CWATUP de la notion de territoire comme patrimoine commun consacre donc une incontestable évolution des idées et de la loi : l’homme n’a pas que des droits sur le monde qui l’entoure, il a aussi des devoirs, celui notamment d’une gestion respectueuse et prudente du territoire et de ses ressources. Note : pour en savoir plus sur les rapports entre propriété et patrimoine, en particulier dans le droit de l’environnement, on peut lire « La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit » de François Ost (Ed. La Découverte, Ecologie et société, 1995). Évolution sociale, évolution des lois : de la propriété au patrimoine Le concept de développement durable est couché sur le papier pour la première fois dans le rapport Brundtland. Ce rapport a été publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement1. Le développement durable y est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à réconcilier trois pôles : l’économique, le social et l’environnemental. Le rapport note encore : le développement implique une transformation progressive de l’économie et de la société. (…) ; il ne peut être assuré si on ne tient pas compte, dans les politiques de développement, de considérations telles que l’accès aux ressources ou la distribution des coûts et avantages. Même au sens le plus étroit du terme, le développement durable présuppose un souci d’équité sociale entre les générations, souci qui doit s’étendre, en toute logique, à l’intérieur d’une même génération. Comment ne pas être d’accord avec de tels principes ? Toutefois le concept est à l’origine de nombreux désaccords, car il est interprété sous les modalités les plus diverses. Pour certains le système économique ne peut être durable si le niveau de consommation actuel des ressources persiste, et la pérennité de nos sociétés va de pair avec une remise en cause fondamentale de notre mode de vie. Pour d’autres le développement durable est indissociable de la croissance du PIB, source première de bien-être : il est avant uploads/S4/ amenagement-du-territoire.pdf
Documents similaires





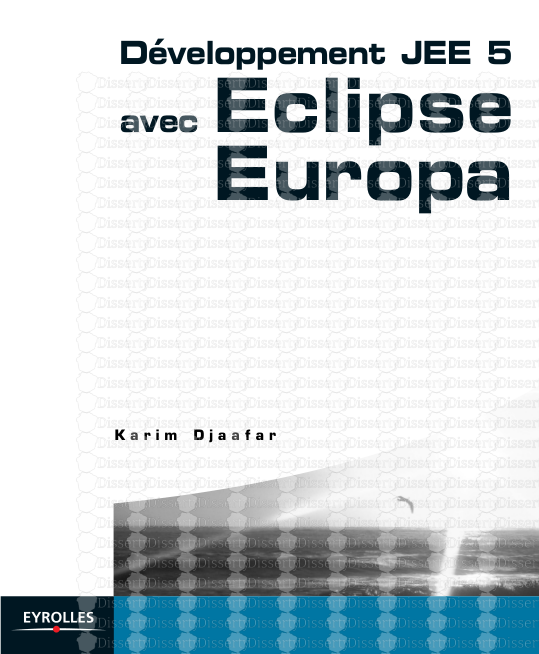




-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4029MB


